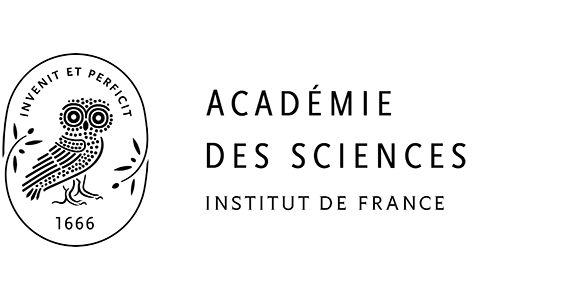1 Introduction
La question de l’enhancement, au sens de biomedical enhancement (celui qui sera mobilisé tout au long de cet article) est maintenant familière aux philosophes et aux bioéthiciens. Elle a, si l’on peut dire, pris son rythme de croisière depuis la fin des années 1990. Que faut-il, en premier lieu, entendre par enhancement ? On peut distinguer deux approches.
Pour certains, un enhancement est forcément quelque chose de positif : procéder à un enhancement, c’est améliorer. Le Britannique John Harris est particulièrement représentatif de cette façon de poser le problème : « En termes de fonctionnement de l’être humain, un enhancement est, par définition, une amélioration par rapport à ce qui existait auparavant. Si quelque chose n’était pas bon pour vous, ce ne serait pas un enhancement » ([1], p. 9). Pour d’autres, comme Ruth Chadwick et Allen Buchanan, on ne peut pas assimiler sans plus enhancement et amélioration ; en d’autres termes, procéder à un enhancement, ce n’est pas forcément apporter un bien. A. Buchanan a proposé un contre-exemple, devenu classique : augmenter les capacités auditives de quelqu’un qui travaille dans un environnement bruyant, ce n’est pas forcément lui apporter un bien ([2], p. 23). De même, ne pas augmenter une capacité, ce n’est pas forcément infliger un mal ou causer un dommage. Il s’agit, en fait, d’une conséquence a fortiori d’un fait bien connu : ne pas rétablir une fonction ou une capacité, ce n’est pas forcément nuire. Par conséquent, il faut une certaine naïveté – ou une certaine rouerie – pour dénoncer, comme l’a fait Marc Roux, « le tort causé par la traduction de l’anglais human enhancement par le terme réducteur “augmentation humaine”, au détriment de la notion d’“amélioration” » ([3], p. 168). L’emploi du vocable prétendument réducteur montre que l’entreprise consistant à améliorer l’être humain est directement intelligible (et, au demeurant, inscrite dans une histoire immémoriale), tandis que celle qui consiste à l’augmenter est nettement plus énigmatique, si même on peut lui conférer un sens quelconque.
On adoptera dans ce qui suit la définition de Buchanan : « Un biomedical enhancement est une intervention délibérée qui, par l’application des sciences biomédicales, vise à améliorer une capacité existante, capacité que tous les êtres humains normaux possèdent de façon typique, ou de créer une capacité nouvelle et ce par une action directe sur le corps ou sur le cerveau. » ([2], p. 23).
S’est également mis en place un débat relatif aux questions éthiques soulevées par la pratique (effective, possible ou simplement envisagée) de l’enhancement, tout spécialement de l’enhancement cognitif. David DeGrazia ([4], pp. 262 et [5]) en donne une liste exhaustive :
- • sécurité de cette pratique ;
- • autonomie des décisions individuelles en matière d’enhancement de soi-même ;
- • décision pour ses enfants ;
- • connivence avec des normes culturelles douteuses ;
- • renforcement des positions réductionnistes de la biopsychiatrie ;
- • encouragement donné à la passivité sociale ;
- • échec par auto-neutralisation d’un usage généralisé des différentes formes d’enhancement ;
- • transgression des limites de la médecine ;
- • problèmes de justice distributive (au cas où l’enhancement serait effectivement bénéfique).
Cette liste présente une allure familière : elle recense, en fait, une série de questions que l’on se pose toujours lorsqu’apparaissent de nouvelles biotechnologies. Ce qui s’est passé récemment, c’est que le débat s’est élargi à la question de l’enhancement en matière de morale (moral enhancement). Pour dire les choses très rapidement : on s’est demandé s’il serait souhaitable d’intervenir de façon délibérée pour améliorer, par l’application des sciences biomédicales, une capacité ou des capacités morales que tous les êtres humains normaux possèdent typiquement, le but de cette intervention étant de les rendre plus moraux. Beaucoup a déjà été écrit sur cette question et il sera ici seulement question de :
- • remettre ce débat dans son contexte ;
- • explorer de façon un peu plus détaillée un des thèmes qui ont le moins été développés dans le débat.
En conclusion, on précisera en quoi le débat semble fondamentalement mal orienté.
2 Mise en contexte du débat : les publications
En vertu d’une longue tradition selon laquelle quelque chose élève l’homme au-dessus de lui-même comme partie du monde sensible, ce quelque chose étant la liberté et l’indépendance à l’égard de la nature entière, certains pensent que l’on peut bien augmenter les capacités naturelles de l’homme, mais pas l’améliorer moralement par des moyens qui sont ceux de la biomédecine. Ces considérations autorisent une objection de principe : une entreprise de moral enhancement ne peut pas aboutir, parce qu’elle ne peut même pas être entreprise. En fait, certaines recherches tendent à montrer qu’il est possible d’agir, même si c’est de façon extrêmement tâtonnante et limitée, sur des dispositions qui ont à voir avec certains comportements des êtres humains, comportements que l’on pourrait qualifier de moraux.
C’est peut-être le cas de certaines stimulations intracrâniennes et aussi de substances pharmacologiques : une hormone comme l’oxytocine semble augmenter la disposition à la confiance envers autrui, mais dans un contexte assez limité de préférence pour le groupe. Il semble également qu’on ait constaté une corrélation entre un neurotransmetteur comme la sérotonine et l’agressivité : un faible taux de sérotonine est corrélée à une agressivité importante ; l’augmentation du taux de sérotonine semble favoriser la disposition à coopérer et à se montrer équitable (voir [6] pour une bibliographie). C’est la mobilisation de tels moyens qu’envisagent les partisans du moral enhancement. Il est certain qu’on a là, au mieux, une esquisse pour des interventions aux effets probablement assez limités et dont la mise en œuvre n’est pas pour demain. Mais le fait qu’il s’agisse de quelque chose de très lointain ne veut pas dire que la question soit purement et simplement dépourvue d’intérêt (ce qui serait le cas si l’on discutait à propos de quelque chose d’impossible en principe). Il n’est pas plus mal que l’on dispose à l’avance d’éléments de réflexion au cas où tout cela deviendrait réalité ; et si jamais cela devait rester à jamais du domaine de la spéculation, les arguments auxquels on aura eu recours pourraient peut-être trouver à s’appliquer ailleurs.
Ce qui semble plus intéressant, c’est de faire observer que le débat sur le moral enhancement ne s’est pas instauré dans le prolongement du débat classique sur la perfectibilité de l’être humain ou de celui sur l’amélioration de soi. Il s’est engagé à la suite de la publication d’un article d’Ingmar Perrson et Julian Savulescu, article devenu ensuite un livre [6,7]. Les deux écrits tranchent nettement par rapport à la littérature habituelle sur l’enhancement, au point que Marina Maestrutti évoque à leur propos la panique [8], une expression que Ruwen Ogien [9] emploie d’habitude pour qualifier l’inspiration d’une littérature plutôt différente. C’est d’autant plus paradoxal que J. Savulescu est réputé proche des transhumanistes, qui, d’habitude, envisagent les promesses du futur et le progrès de façon remarquablement enthousiaste.
Pour dire les choses de façon très synthétique, on y voit se manifester des raisons assez inédites de « prendre en charge » l’évolution des êtres humains. Cette thèse transhumaniste par excellence, depuis que Julian Huxley a mis le terme en circulation [10], est traditionnellement justifiée – comme chez F.M. Esfandiary alias FM-2030, par exemple [11–14] – par des considérations optimistes, voire utopistes ; chez I. Perrson et J. Savulescu, elles cèdent la place à des considérations prudentielles, exprimées sur un ton qui est celui du désenchantement, voire de l’apocalypse.
3 Mise en contexte du débat : les arguments
I. Perrson et J. Savulescu ont résumé leur propos en cinq points ([6], p. 174) :
- • il est comparativement plus facile de causer un dommage que d’apporter un bénéfice dans les mêmes proportions ;
- • l’enhancement cognitif, s’il se réalisait, accélérerait le progrès scientifique ; il deviendrait possible à de petits groupes, ou même à des individus, de provoquer d’énormes dommages à des foules de gens (en fabriquant et en utilisant des armes de destruction massives, par exemple) ;
- • même si un tout petit pourcentage seulement d’êtres humains est assez immoral pour se lancer une telle entreprise, il y en aura suffisamment, à moins que l’humanité ne soit moralement améliorée (nos deux auteurs envisagent certaines options, pour les écarter aussitôt, car ils pensent qu’il n’existe pas de moyens moralement acceptables de les mettre en œuvre de façon efficace ; ce sont, par exemple, une diminution massive de la population mondiale ou le lancement d’un programme de dépistage génétique de très grande envergure) ;
- • cet enhancement moral doit être d’une importance telle qu’il ne soit pas réalisable actuellement, ni dans un futur proche ;
- • les progrès scientifiques, en un sens, nous mènent au désastre (et ce d’autant plus qu’ils vont être potentialisés par l’enhancement cognitif), à moins qu’ils ne soient contrebalancés par des moyens efficaces d’enhancement moral (qui restent encore à découvrir et à appliquer).
L’intuition derrière ces affirmations est simple et assez familière : l’humanité a mis en route un processus qui accroît le hiatus entre ce qu’elle est capable de savoir et de faire, d’une part, et ce qu’elle est capable de contrôler, d’autre part. Dans le détail, les choses sont moins claires : étant donné des thèses aussi clairement exprimées, la conclusion semble quelque peu hésitante. D’une part, nos auteurs suggèrent que la poursuite de l’enhancement cognitif ne peut apporter que des bénéfices marginaux, pour une prise de risque très importante ; ils pensent que des individus malveillants devenus plus intelligents causeront des dommages bien plus importants que des individus malveillants médiocrement intelligents, ce qui reste à voir. À première vue, cela semblerait aller dans le sens d’un moratoire sur l’enhancement cognitif. Mais ce n’est pas leur conclusion ; mobilisant une métaphore assez inattendue, ils insistent sur le fait que les arts martiaux comme technique de combat ont toujours été accompagnés d’une éducation morale et spirituelle (un budoka est plus qu’un homme de main qu’on utilise pour de basses besognes). Ils affirment alors qu’un moral enhancement doit accompagner l’enhancement cognitif, attendu que celui-ci n’est qu’un moyen, que l’on peut utiliser en bien ou en mal ([6], p. 274). Cette conclusion est précisée de la façon suivante : « Un enhancement moral, s’il est sûr et efficace, doit être obligatoire. » ([6], p. 274). À qui demanderait comment rendre morale une intervention obligatoire sur les capacités morales, ils renvoient à l’éducation en général et à la fluoration de l’eau potable dans le cadre de la prévention des caries. Bien entendu, on le comprend aisément, chacun de ces points a été critiqué, discuté ou précisé. On répartira ces arguments en deux grands pôles, en étant bien conscient que cette répartition a quelque chose de réducteur ; mais, puisqu’il ne s’agit pour l’instant que de dresser un simple état de l’art, une telle simplification peut être tolérée. Certaines critiques visent surtout le diagnostic de I. Perrson et J. Savulescu et les conséquences politiques et sociales qu’ils tirent de ce diagnostic ; d’autres portent sur la conception de l’éthique sous-tendant le projet d’enhancement moral.
Ainsi, J. Harris [15] s’inscrit en faux contre la thèse selon laquelle il est plus facile d’infliger un dommage que de conférer un bénéfice. Darryl Gunson et Hugh McLachlan [16], ainsi qu’Elizabeth Fenton [17], critiquent l’évaluation des dommages et des bénéfices qui est celle de nos deux auteurs (ils ont sous-évalué les bénéfices et surévalué les risques). De son côté, Robert Sparrow [18], dans une perspective habermasienne, leur reproche de reconduire à des traits éternels de la nature humaine des problèmes politiques, donc contextuellement déterminés. Ce sont là des auteurs représentatifs du premier pôle.
Gravitant autour du second, D. DeGrazia [19] et Thomas Douglas [20], pas hostiles ou même plutôt en faveur du moral enhancement, soulignent ce que la formule « améliorer moralement l’humanité » peut avoir d’imprécis et ont distingué des niveaux d’amélioration possible (portant sur la motivation, sur les actes ou sur la clairvoyance morale). Adoptant une posture nettement plus critique, J. Harris [15] affirme que I. Perrson et J. Savulescu ne comprennent simplement pas le rôle de l’autonomie et de la liberté en morale. Fabrice Jotterand [21] propose d’envisager les questions soulevées par Perrson et Savulescu dans la perspective d’un éthique de la vertu (comprise au sens de Alasdair MacIntyre). Bernard Baertschi [22] relève que des questions de méta-éthique sont à l’arrière-plan du débat, I. Perrson et J. Savulescu ainsi que T. Douglas se rangeant dans le camp des « sentimentalistes » et J. Harris plutôt dans celui des rationalistes.
Ce sont des remarques relatives aux arguments du second pôle qui seront avancées ici.
4 Un thème peu développé, mais prometteur
J. Harris s’est élevé de façon véhémente contre le projet d’enhancement moral, ce qui semble d’autant plus paradoxal, tous les protagonistes du débat l’ont relevé, qu’il est un partisan non moins véhément d’autres formes d’enhancement (enhancement cognitif, allongement de la vie, augmentation des performances physiques, etc.). En effet, J. Harris n’est pas du tout ce qu’il est convenu d’appeler un bio-conservateur : il pense qu’être animé d’une passion qui vise l’amélioration de soi-même est une très bonne chose (ce n’est pas une tentative hubristique d’aller outre les limites de la condition humaine). Comment expliquer cette posture, qu’à première vue on pourrait tenir pour inconsistante ? T. Douglas [20] puis B. Baertschi [22] relèvent trois arguments dans l’article de John Harris :
- • l’enhancement moral, dépourvu de toute amélioration cognitive, serait inefficace ;
- • l’enhancement moral, dépourvu de toute amélioration cognitive, constituerait une restriction à la liberté ;
- • l’enhancement moral, dépourvu de toute amélioration cognitive, conduirait à un déclin moral.
Que signifie le troisième argument ? Notons d’abord que ce n’est pas J. Harris lui-même qui parle de moral decline. T. Douglas emploie ce terme pour désigner une objection avancée par J. Harris : d’après les partisans du moral enhancement, réduire l’intensité avec laquelle nous éprouvons certaines émotions ou agir sur nos dispositions à les éprouver est un enhancement. Mais, objecte J. Harris, il faut éprouver certaine de ces émotions ou être disposé à les éprouver jusqu’à un certain point pour que l’on puisse parler de vie morale. Par exemple, on voit mal en quoi la xénophobie contribue, si peu que ce soit, à la vie morale de l’individu ; mais il n’en est pas de même en ce qui concerne l’amour de soi (et c’est probablement le sens de l’illustre distinction de Rousseau entre amour de soi et amour propre) ; on pourrait dire la même chose du désir de surpasser les autres ou de la préférence que l’on a pour ses apparentés. Il est plutôt paradoxal de voir un conséquentialiste avoué, comme J. Harris, mobiliser des analyses qui n’ont de sens qu’en termes de réalisation de la vie morale, étant donné que ces analyses sont le plus souvent développées par les partisans d’un éthique de la vertu. Mais le paradoxe se lève facilement : les conséquentialistes et même les utilitaristes sont parfaitement à même d’articuler un discours des vertus. Simplement, c’est un discours qui s’adosse à une théorie conséquentialiste ou utilitariste des valeurs et des normes. On n’y considère pas le caractère de l’agent comme l’objet ultime de l’évaluation morale : cet objet ultime reste bien le plaisir, ou la satisfaction des préférences, ou tout ce qu’on veut ; le caractère de l’agent est alors évalué en fonction de sa contribution à la réalisation de ces valeurs. L’argument « décliniste » consiste donc à dire que l’on peut défaire les conditions mêmes de la vie morale si l’on agit sur certaines des émotions ou des dispositions de l’être humain.
C’est sans doute un argument plus intéressant que celui de la liberté ; en effet, Harris semble concevoir la liberté comme une pure capacité à se déterminer soi-même à agir bien ou mal (c’est-à-dire comme un libre arbitre). Cette capacité serait atteinte par un enhancement moral agissant sur les émotions, les dispositions, les aversions et les tendances de quelqu’un. Mais si tel était vraiment l’argument, il faudrait aussi condamner l’éducation morale au sens ordinaire du terme (celle qui passe par la lecture, l’expérience personnelle, bref le commerce des hommes et des choses). Or, J. Harris ne la condamne pas du tout, bien au contraire. En fait, son idée semble être la suivante : le moral enhancement affecte de l’extérieur la capacité à se déterminer soi-même, en défaisant l’autonomie de celui ou de celle qui en « bénéficie ». Mais une telle façon de faire renvoie à une conception héroïque de l’autonomie, qu’il est difficile, pour J. Harris, d’aligner avec l’affirmation, nettement plus modeste, selon laquelle l’évolution nous a dotés d’un sens robuste de la justice et du bien, c’est-à-dire d’un sens vertueux de la morale.
L’argument « décliniste » suggère plutôt que la vie morale consiste à équilibrer sur le long terme le côté sombre de la nature humaine, et son côté moins sombre (on verra sous peu la raison de l’emploi de ces expressions imagées). Les deux côtés sont indissociables : s’ils n’existaient pas tous les deux, il n’y aurait pas de vie morale au sens intéressant du terme. Intuitivement, et pour en rester à des exemples littéraires (qui offensent moins que des exemples réels) : le duc de Blangis (un des organisateurs des 120 journées de Sodome sadiennes) a une vision tronquée de la vie morale. Mais le prince Mychkine (l’idiot de Fiodor Dostoïevski) également, et pour des raisons peut-être symétriques. Cet équilibre n’est pas une chose bonne dont il serait souhaitable que chaque individu en possédât la plus grande quantité possible. C’est une façon d’agir, un mode de l’action, même s’il est souhaitable que le plus de gens possible en soient capables : ce qui veut dire que l’on peut agir éventuellement sur les gens qui en sont incapables (par des moyens chimiques, génétiques ou autres). Mais cela s’appelle soigner : en adoptant une approche comme celle d’I. Perrson et J. Savulecu, on a quitté subrepticement le terrain de l’éthique pour aborder celui de la pathologie.
A contrario, on pourrait mobiliser les analyses de Jonathan Glover. Celui-ci admet dans What Sort of People Should There Be? ([23], p. 55) et encore dans Choosing Children ([24], p. 87) qu’il est sans doute souhaitable de contenir par la génétique le côté sombre de la nature humaine et de préserver, toujours par la génétique, ce qui est capable de le contenir (on peut observer qu’il emploie les termes containment et preservation, pas development). Mais le même Glover a écrit un livre dans lequel il corrige nettement cette thèse [25]. Il y montre que des décisions catastrophiques en termes humains ont été prises par des décideurs qui n’étaient pas spécialement dépravés en termes éthiques, mais qui raisonnaient sur une base étroite de précédents, d’analogies, d’utilisation optimale de ressources, etc. Symétriquement, il montre que des dirigeants ont su prendre des décisions ayant évité des catastrophes, non sur la base d’une acuité éthique particulièrement développé, mais parce qu’ils avaient une intelligence fine de la situation et des rapports de forces, qu’ils avaient compris cet axiome élémentaire de la Real Politik selon lequel il est extrêmement dangereux de mettre son adversaire potentiel dans une situation d’où il lui est impossible de s’extirper de façon honorable, qu’ils avaient des lectures et une expérience personnelle leur permettant de se faire une image mentale du point de vue de l’autre, etc.
Ce sont là des exemples qui semblent donner massivement raison à J. Harris dans son inventaire des moyens traditionnels d’améliorer moralement l’être humain : être moralement meilleur, c’est, le plus souvent, y voir plus clair dans des situations confuses et complexes.
5 Conclusion
Il a été question ici de se saisir d’une suggestion de John Harris en l’adaptant de telle façon qu’il ne reconnaîtrait peut-être pas ses propres intentions : il s’est agi de montrer que le projet d’enhancement moral repose sur une erreur de catégorie qui consiste à tenir la vie morale pour une série de réalisations d’actes motivés par des émotions correctes. Il semble plutôt qu’elle consiste à réaliser un équilibre entre des émotions de toutes sortes ; on peut se rendre capable de réaliser un tel équilibre avec plus ou moins de facilité, ce qui revient à cette platitude qu’il y a des gens qui ont un meilleur naturel que d’autres. Mais quand on est capable de le réaliser, on ne peut pas le réaliser encore plus. Cela ne veut pas dire que des individus qui n’ont pas un bon naturel du tout ne peuvent pas bénéficier d’interventions de toutes sortes (chimiques ou autres) : mais cela s’apparente à un soin.
On pourrait en outre suggérer que la question, telle que formulée par I. Perrson et J. Savulescu, est fondamentalement mal posée. Les lecteurs de Hans Jonas et Jacques Ellul éprouvent, bien entendu, un sentiment de familiarité en lisant leurs publications. Il s’agit d’un thème classique, celui de la technique menaçant de se retourner contre ses utilisateurs. Une partie de la stratégie de H. Jonas consiste à mener une critique de l’utopie comme étant déjà « une critique de la technologie en prévision de ses possibilités extrêmes » ([26], p. 298). Mais avec I. Perrson et J. Savulescu, il semble que, devant les éventuelles menaces du futur, on se réfugie au contraire dans l’utopie : il n’est que d’essayer de se représenter ce que pourrait être, concrètement, la réalisation d’un programme de moral enhancement, à la lumière des précédents que l’on peut avoir en tête, spécialement si l’on considère que nos deux auteurs semblent considérer que c’est plutôt un programme pour les démocraties libérales ([7] chap. 3). Ceci vient de ce que, peut-être, ils négligent le fait que les technologies, bien loin d’être des moyens neutres en vue de fins axiologiquement déterminées par ailleurs, se développent dans un contexte social et économique qu’ils ne prennent pas en compte.
Déclaration d’intérêts
L’auteur déclare ne pas avoir de conflits d’intérêts en relation avec cet article.