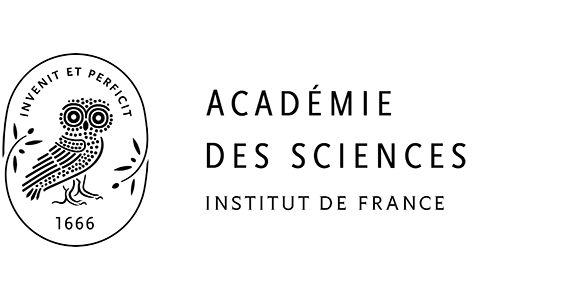« Qui auget scientiam, auget et dolorem » (Ecclésiaste, I, 18)
cité par A. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Book IV, § 56
ou : « Qui accroît ses connaissances, et les pouvoirs qui en résultent, accroît aussi sa responsabilité ».1 Introduction
1.1 L’appel à la responsabilité des savants
La réunion de Bruxelles marque le quarantième anniversaire de la conférence internationale qui, sous le titre : La biologie et l’avenir de l’homme/Biology and the Future of Man, s’est tenue à Paris du 18 au 24 septembre 1974. Cette conférence avait réuni à la Sorbonne 187 savants de grande qualité, appartenant à 38 pays différents. L’objectif était d’analyser les « nouveaux devoirs de l’homme » consécutifs aux « nouveaux pouvoirs de la science », dans les domaines de la procréation médicalement assistée, de l’agriculture, de la démographie, de l’environnement. De cette conférence naissait le Mouvement universel de la responsabilité scientifique (MURS), qui se donnait pour mission de contribuer à « la prise de conscience des problèmes qui peuvent résulter pour l’humanité du développement de la science et de ses applications ». Présidé par Robert Mallet (1974–1983), Jean Dausset (1983–2002), Gérard Mégie (2002–2004), Jean Jouzel (depuis 2007), le MURS vise à assurer la circulation des informations scientifiques, la réflexion sur les nouvelles orientations de la recherche et la concertation des hommes de science sur les risques liés aux éventuelles retombées humaines et sociales de leurs travaux. MURS : Mouvement universel de la responsabilité scientifique. <murs.france@wanadoo.fr> +33 1 47 03 38 21. website : http://www.murs-france.org. Cahiers du MURS : Science et devenir de l’homme [paper and online]. Directeur de la publication : Jean-Pierre Alix.
1.2 L’élan donné par la bioéthique
Le développement du MURS coïncide avec celui de la bioéthique. Jean Dausset, alors président du MURS, saluait en 1996 cette convergence, dans un discours intitulé « Bioéthique et responsabilité scientifique », dans lequel il déclare :
« L’émergence, puis la grande actualité de la bioéthique, est un événement d’une extrême importance dans la conscience de l’homme. Elle découle, en effet, de l’extraordinaire percée conceptuelle et technologique faite récemment grâce aux progrès éblouissants de la biologie et de la génétique ».
Dausset, 1996.Selon Dausset (ibid), la bioéthique nous rappelle opportunément trois aspects complémentaires de nos devoirs moraux : respecter « la personne humaine », respecter « l’espèce humaine » en préservant « l’avenir des générations futures », et respecter « la nature, donc la biosphère et la biodiversité nécessaire à toute vie humaine ». C’est dans cet esprit qu’il faudra réfléchir sur les récentes avancées des sciences de la vie, et tenter de « dégager une attitude commune à la majorité des cultures », sur des « problèmes concrets choisis parmi les plus controversés » : thérapie génique ; statut de l’embryon humain (diagnostic prénatal, interruption de grossesse) ; médecine prédictive ; et détérioration progressive du milieu naturel, dont « l’homme technologique » est responsable, et qui met en danger le futur de l’espèce.
1.3 Plan
On distinguera deux moments dans le devenir de la bioéthique. Autour de 1974 (année de la création du MURS), et jusqu’à la fin des années 1980, les chercheurs réussissent à endiguer la crise anti-science de 1968, et la bioéthique connaît un essor inespéré, qui soutient positivement le travail scientifique. Puis, autour de 1990, et jusqu’au début du xxie siècle, la bioéthique, qui s’est institutionnalisée, s’essoufle, se dilue dans les sciences humaines et sociales. La situation actuelle (en 2014) est celle d’une bizarre coexistence entre les emballements d’un enthousiasme prométhéen, admirateur des prouesses de la science, et la mise en doute de l’intégrité des chercheurs, auxquels on ne reconnaît plus aucune autorité morale.
2 Le grand essor
2.1 Le message du colloque de 1974
Parmi les rapporteurs qui ont contribué à écrire les Actes de la conférence de Paris, il y avait un philosophe-médecin : Georges Canguilhem. C’est à lui qu’a été confiée la rédaction du dernier chapitre du rapport final, intitulé « qualité de la vie, dignité de la mort/quality of life, dignity of death ». Il conclut ainsi :
« Finalement, l’objet le plus général de ce Colloque : Nouveaux pouvoirs de la science, nouveaux devoirs de l’homme, se transforme en celui-ci : nouveaux devoirs des hommes de science quant à l’exercice de leur pouvoir. Biologistes et médecins estiment-ils être, à leur manière, des hommes de pouvoir ? Reconnaissant leurs pouvoirs, veulent-ils les exercer ? Avec quels autres pouvoirs veulent-ils coopérer ? Le moment n’est-il pas venu, pour les scientifiques, de convenir que le discours scientifique est insuffisant pour résoudre les problèmes dont leur science leur donne la conscience lucide, mais qui les concernent eux-mêmes, en tant qu’ils sont des hommes, comme tous les hommes, nés et encore à naître. Nés sans certificat de parfaite correction génétique, sans garantie d’intégrité fonctionnelle permanente, et déjà promis à la mort ».
[1], p. 532.en anglais :« Finally, the more general theme of this Conference: New powers of Science, new duties of Man, then becomes: New duties of scientists as to the power they exercise. Do biologists and physicians think that, in their own way they are men of power? If they recognize their power, are they prepared to exercise it? Are they ready to cooperate with other power bodies, and which ones? Has the moment not arrived, for the scientists, to recognize that the scientific discourse is not enough to solve the problems of which, thanks to their scientific knowledge, they have a lucid awareness, but which concern them as men, like all men, already born and yet to be born – born without a certificate of genetic perfection, without guarantee of permanent functional integrity, and already destined to die. »
[1], p. 537.2.2 Le contexte de la conférence de Paris
La prise de conscience brutale des dangers inhérents aux pouvoirs conférés à l’homme par les conquêtes de la science a commencé, comme suite au projet Manhattan, avec l’indignation d’un groupe de physiciens, révoltés par l’usage de la bombe atomique lancée sur Hiroshima et Nagasaki en 1945 ; en réponse au manifeste de Russell et Einstein (1955), la première conférence Pugwash se tient en 1957, elle accueille 22 savants issus de dix pays différents.
L’inquiétude relative aux sciences du vivant est moins bruyante, mais elle couve depuis longtemps. Au début du xxe siècle le jeune P.-C. Bongrand écrivait dans sa thèse de médecine, à propos des essais médicaux : « Il y a des hommes qui se sont attribué le droit effrayant de se servir de la chair d’autres hommes comme d’un matériel de laboratoire » [2]. À l’issue du second procès de Nuremberg (1946–1947) des médecins sont condamnés, qui, pour étudier la résistance au froid de l’organisme humain, ont maintenu des prisonniers dans l’eau glacée jusqu’à ce que mort s’ensuive [3]. On se demande encore, quarante ans plus tard, s’il est acceptable de citer et utiliser leurs résultats (scientifiques), ou si la méthode par laquelle ils ont obtenu ces résultats est tellement immorale qu’il faut s’abstenir de les citer. La déclaration d’Helsinki [4], dans sa première version, paraît en 1964 ; elle sera maintes fois révisée. Elle montre que les médecins ont compris qu’il faut explicitement ériger des barrières à ne pas franchir :
« Il est du devoir des médecins engagés dans la recherche médicale de protéger la vie, la santé, la dignité, l’intégrité, le droit à l’autodétermination, la vie privée et la confidentialité des informations des personnes impliquées dans la recherche. La responsabilité de protéger les personnes impliquées dans la recherche doit toujours incomber à un médecin ou à un autre professionnel de santé, et jamais aux personnes impliquées dans la recherche même si celles-ci ont donné leur consentement » (Art. 9, version 2013).
En 1966, le New England Journal of Medicine signale des abus dans la recherche clinique [5], comme si les professionnels cherchaient à s’auto-discipliner. Mais, dans le sillage de la révolution culturelle chinoise (1966), puis de l’explosion mondiale des révoltes étudiantes (1968), la recherche scientifique tout entière est mise en accusation : usage des défoliants et des gaz au Vietnam, financement de la recherche universitaire par des crédits militaires… « il faut arrêter la recherche », entend-on, ou placer le travail scientifique sous contrôle démocratique : « science for the people! », « don’t leave it to the experts! ». Quelques philosophes contribuent à corriger l’image d’une science jadis révérée comme bonne, pure et intouchable [6,7].
2.3 Réponse à la contestation
La menace sur leur indépendance intellectuelle incite les scientifiques à s’ouvrir à l’idée que leurs travaux soulèvent des problèmes dont la solution n’est pas à chercher seulement dans la science. La conférence de Paris en 1994 n’est pas un événement isolé. De nombreuses initiatives se font jour, auxquelles les institutions internationales sont attentives. En 1968, l’OMS publie un guide des bonnes pratiques en matière d’essai de nouveaux médicaments sur des êtres humains [8]. En 1969, Conrad Waddington organise, avec l’aide de l’Unesco, un petit symposium où sont examinés les apports, et les nuisances technologiques, de la « Cendrillon des sciences de la nature » (ex. la biologie), une science qui détient les clefs de notre avenir [9]. En 1969 encore, Daniel Callahan et Willard Gaylin créent le Hastings Center (dont le Report est depuis plus de 40 ans une référence en bioéthique) ; le centre lance un groupe de travail dont la réflexion aboutit à la publication de quatre volumes sur le lien entre éthique et science [10]. En 1970 apparaît le mot « bioéthique » (chez le biochimiste van Rensselaer Potter [11,12]). En 1974, Paul Berg et Stanley Cohen proposent un moratoire sur les essais en ingénierie génétique, et la conférence d’Asilomar se tiendra en février 1975. En 1975 aussi, l’Unesco va organiser à Varna une rencontre entre biologistes et moralistes, visant à dégager les problèmes posés par les avancées des sciences de la vie ; cette conférence conclut à « l’urgence d’élaborer une nouvelle éthique ». Bruno Ribes a publié une réflexion approfondie sur cette rencontre [13].
2.4 La conférence de Paris : les thèmes
La conférence internationale qui s’est tenue à Paris en 1974, à l’invitation du recteur Robert Mallet, a fait l’objet d’une publication exhaustive, œuvre de son secrétaire général, Charles Galperin [1]. Son contenu est donc de consultation aisée. Douze thèmes de réflexion avaient été sélectionnés par le comité d’organisation : trois tenant à de récentes avancées médicales (transplantation d’organes impliquant prélèvement sur un « donneur », essais scientifiques sur des sujets humains, psychobiologie et manipulation des comportements par des médicaments psychotropes) ; quatre thèmes environnementaux (écotoxicologie, recyclage des déchets, équilibres marins, et rôle de la science dans l’augmentation des rendements agricoles – engrais, pesticides) ; deux thèmes relatifs aux équilibres sociaux (préservation du « patrimoine » génétique de notre espèce et de sa diversité, vieillissement des populations et déséquilibres démographiques) ; enfin trois thèmes d’allure plus philosophique (contrôle génétique via l’assistance médicale à la procréation, place des handicapés dans la société, droit de demander la mort). Plusieurs de ces thèmes sont encore d’actualité quarante ans plus tard.
Chaque thème avait fait l’objet d’un rapport préliminaire, communiqué aux personnalités invitées. Lors des journées de septembre, douze groupes de travail furent constitués, entre lesquels les participants se répartirent. La discussion sur le thème assigné au groupe, lancé par un président de séance, transcrit puis résumé par les « secrétaires de séance » (membres du groupe), dégageait l’état des problèmes dans chaque domaine. Le Rapport final, en sept points exposés par sept auteurs, donne une synthèse provisoire et très ouverte, le message étant que les questions soulevées par les avancées actuelles de la recherche ne peuvent pas être résolues par les scientifiques seuls.
Prenons un exemple : le groupe « Responsabilité et décision dans l’orientation et le contrôle génétique de la procréation humaine/Responsibility and decision in the orientation and genetic control of human procreation » prend d’abord connaissance d’un texte écrit par Robert Edwards, son rapporteur. Ce texte décrit les aspects physiologiques, éthiques et légaux, d’une nouvelle technique mise au point par Edwards, qui est la technique de fertilisation in vitro (FIV) d’ovocytes humains. Puis la discussion est ouverte, sous la présidence de Cyrus Levinthal, entre François Jacob (vice-président), Robert Edwards, Françoise Levinthal et Charles Galperin (secrétaires) et les autres membres du groupe : Theodosius Dobzhansky, Albert Jacquard, Jérôme Lejeune, Paul Marks, Jacques Monod, Arno Motulsky, Leo Sachs, Shinryo Shinagawa, Gunther Stent, et Raymond van de Wiele. Les secrétaires produisent le résumé. Ce que les membres de ce groupe ne savent pas (et qui est une évidence pour le lecteur d’aujourd’hui), c’est que le physiologiste britannique Robert Edwards réussira en 1978 la naissance (suite à une FIV) de la petite Louise Brown ; qu’en 2010 il recevra le prix Nobel « pour le développement de la fécondation in vitro », et qu’en 2014 il y aura plus de quatre millions d’enfants dans le monde qui seront nés d’une FIV.
2.5 L’écologie en 1974
Le rapport sur les thèmes environnementaux est fait pas Roger Gautheret, professeur à l’université Paris-6, membre de l’Académie des sciences et de l’Académie d’agriculture de France. Ce rapport commence par une constatation : la Terre reçoit du soleil de grandes quantités d’énergie, mais l’homme ne sait pas la stocker pour l’utiliser efficacement. « Il faudra pourtant bien qu’il y songe lorsqu’il aura épuisé, par son gaspillage, les réserves énergétiques que certains organismes ont accumulées pendant des millions d’années et qui se trouvent à présent sous forme fossile » [1, p. 497]. Suit un développement sur ce qui est présentement le « cœur du problème » : « la nécessité de nourrir une population de plus en plus nombreuse à partir de terres fertiles dont la surface s’est rétrécie ». On le fait en augmentant les rendements agricoles par des moyens industriels (engrais chimiques, pesticides), qui sont source de pollution, d’où la naissance d’une nouvelle science (écotoxicologie) où l’on s’essaye à distinguer les « signes précurseurs de catastrophes écologiques ». Le rapport se termine sur un appel aux chefs d’État pour qu’ils prennent conscience des menaces environnementales :
« Nous en avons parlé au cours de ce colloque et mes collègues se sont alarmés. Ils m’ont chargé de dire ceci : l’écologie est trop complexe pour que les hommes d’État puissent en avoir une connaissance vraiment objective. Le recours à des conseillers isolés, si brillants soient-ils, ne peut leur donner de garanties suffisantes ; les décisions qu’ils sont amenés à prendre lorsqu’elles sont susceptibles de mettre en question les équilibres biologiques devraient s’appuyer sur les avis d’assemblées nationales et internationales constituées des meilleurs spécialistes de l’écologie. La protection de la nature, qui est indispensable à la survivance de l’humanité, exige enfin une intensification des recherches, particulièrement dans le domaine de l’écotoxicologie, recherches que les gouvernements ont le devoir de favoriser. Si nous ne sommes pas capables de préserver la nature, nous nous acheminerons vers un sort misérable et les historiens porteront alors sur la science des jugements aussi sévères que ceux qu’ils ont formulés sur les hommes qui, par le passé, ont essayé d’asservir leurs semblables ».
[1], p. 500 – English translation, p. 503.2.6 Savoir et pouvoir
Le rapport de synthèse intitulé « Qualité de la vie, dignité de la mort » est rédigé par Georges Canguilhem. Ce rapport maintient un prudent équilibre entre la possibilité de détecter avant la naissance des anomalies chez le fœtus, qui peuvent conduire à l’éliminer (interdiction de naître) et l’obligation de respecter et d’aider à vivre les handicapés une fois qu’ils sont nés. Puis, avec la question : « le droit à la mort peut-il être reconnu par la médecine » ? (interdiction de mourir, découlant de la technicité croissante dans les services de réanimation), il critique la tendance des médecins à ne pas communiquer avec les non-médecins, et à décider seuls du moment où la personne va mourir. Cette façon de se retrancher dans un silence lointain, pour assumer soi-même un excès de responsabilité, est reprochée à tous les spécialistes des sciences de la vie : « leur savoir, conseiller du pouvoir, exerce en fait une fonction de pouvoir ». La critique est percutante : elle vise aussi bien l’inclusion d’une personne dans un essai clinique, la décision d’interrompre une grossesse, ou celle de débrancher un mourant, que le conseil dispensé aux États sur la politique agricole ou les quotas de pêche :
« On peut se demander si, dans toutes les questions concernant les responsabilités et les décisions à prendre à l’égard des vies humaines possibles, des vies humaines manquées, des vies humaines qui s’épuisent, le premier devoir des biologistes et des médecins ne serait pas de se demander de quel côté ils se trouvent ou, pour parler comme certains aujourd’hui, de quel lieu ils décident pour d’autres qu’eux-mêmes »
[1], p. 530.Autrement dit : la morale est au-delà de la science, et elle n’en découle pas.
2.7 Responsabilité des savants
« Un groupe de travail, animé par Robert Mallet, a siégé parallèlement au Colloque… afin d’essayer de définir les raisons et les conditions d’une action qui prolongerait celle du Colloque et serait basée sur la notion de responsabilité scientifique. »
[1], p. 543.Ainsi naît le MURS. Il s’agit de doter la communauté mondiale d’un organe permanent (une sorte de think tank) pour « chercher les solutions communes dont dépend le destin de l’espèce », « contribuer à la création de l’écosystème mondial », « stimuler une réflexion prospective rigoureuse sur l’homme et la planète et sur les mesures à prendre dès aujourd’hui pour garantir leur avenir » (ibid, pp. 541–543). Aucun doute n’est exprimé sur la possibilité de dégager des solutions consensuelles. Ainsi la session consacrée au recyclage des déchets se conclut par la constatation qu’un « très large consensus » s’est dégagé des débats « pour admettre que le recyclage des déchets résultant de l’activité humaine représente désormais une nécessité pour la conservation des ressources naturelles de notre planète » (ibid., p. 188), pourvu que cela se fasse d’une façon à la fois écologique et économiquement rentable. De même, la discussion sur les conditions auxquelles on peut prélever un rein sur un donneur vivant, pour le greffer sur un receveur, a été, selon Jean Hamburger, « un modèle de coopération internationale » (ibid., p. 22). Mais on est resté entre soi ! Paradoxalement, la conférence de 1974 dit que, sur les problèmes posés par l’industrialisation de l’agriculture, la procréation in vitro, ou la possibilité de détecter sur un fœtus humain des anomalies génétiques, les scientifiques ne devraient pas décider seuls ; cependant, le MURS est pensé sur le modèle d’une assemblée de sages, qui tiennent leur sagesse de leur science.
Par contraste, le mouvement bioéthique n’est pas élitiste. Les comités d’éthique (locaux, institutionnels, nationaux, internationaux) qui vont se multiplier au cours des années 1970 et 1980 se situeront plutôt dans la ligne de la Déclaration universelle des droits de l’homme, votée par l’Assemblée générale des Nations unies, à Paris, en 1948, et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, entré en vigueur en 1976. Le Pacte condamne tout savant qui ferait de la recherche sur ses semblables à leur insu : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. » (Article 7).
2.8 Émergence de la bioéthique
Dans le sillage des révoltes de 1968, l’idée s’impose que, la recherche biomédicale étant largement financée sur fonds publics, il faut instituer un contrôle démocratique des activités de recherche–d’autant plus que la grande presse américaine s’est indignée en rapportant des essais contestables conduits sur des enfants handicapés (Willowbrook), des personnes âgées (Brooklyn), des noirs américains (Tuskegee). En 1974, le Congrès américain crée une commission nationale « pour la protection des sujets humains de la recherche biomédicale et comportementale » [14], dont le rapport de synthèse (Belmont Report) énonce les principes fondamentaux qui doivent s’appliquer à la recherche sur l’être humain :
- • principe de respect de l’autonomie du sujet moral, et de protection des personnes vulnérables (impliquant le recueil systématique du consentement éclairé pour les actes de recherche) ;
- • principe de bienfaisance, ou de non-malfaisance (le médecin veut faire du bien à son prochain quand il le soigne, mais aussi quand il le sollicite pour se soumettre à un essai) ;
- • principe de justice (impliquant, par exemple, qu’un pays riche n’ira pas exploiter des volontaires d’un pays pauvre pour mener à bien une recherche sur un médicament que les pauvres ne pourraient pas se payer).
La bioéthique ainsi lancée est une philosophie morale, comme le dit Tom L. Beauchamp, qui a participé à la rédaction du texte fondateur : « l’idée nous est venue dans ces années-là que les principes universels issus de la philosophie morale peuvent être intéressants théoriquement et pratiquement utiles en éthique médicale » [15]. Peu importe ici que ces principes renvoient à des traditions morales différentes : ils font rapidement consensus, et ils sont repris par les directives internationales [8].
Au cours de ces mêmes années 1970–1980, la bioéthique s’institutionnalise. Les comités d’éthique poussent comme des champignons. Il naît ici et là des formations à l’éthique. À cette époque, le raisonnement éthique procède de haut en bas (top–down) : il s’agit d’appliquer les principes, ou de vérifier qu’ils sont bien appliqués (d’où le nom de principlisme donné à ce style de morale).
3 L’émiettement
3.1 Responsabilité : un concept flou
En plaçant le concept de responsabilité au centre d’une éthique « adaptée à la civilisation technologique », le philosophe Hans Jonas donne, semble-t-il, un cadre philosophique justifiant pleinement l’appel à la responsabilité qui a donné naissance au MURS [16]. Quelques années plus tard, cependant, un article de Paul Ricœur paru dans la revue Esprit introduit un doute [17]. Autant la notion de responsabilité (civile, pénale) peut avoir chez les juristes un sens précis, dit-il, autant en philosophie c’est une notion floue. Dans le même numéro de la revue, Yeshayahou Leibovitz déclare : « Il n’y a pas de moralité universelle et jamais il n’y en aura. Seule la science est universelle » [18, p. 68].
En 1994–1995, le MURS connaît des difficultés, et une baisse de son rayonnement. En 1996–1997, il réfléchit sur la violence (incivilités, rackets, racisme) qui pourrit les relations sociales. Il cherche à se rapprocher d’un public jeune avec ses Lettres aux générations 2000, en parlant du risque de surdité à l’écoute d’une musique amplifiée (1996, no 10) ou en recommandant aux « écocitoyens » la bicyclette pour leurs déplacements en ville (1997, no 13).
Dans le même temps, les politiques ne se contentent plus de consulter les savants, ou d’exhorter les chercheurs à se comporter de façon responsable. Ils légifèrent sur la recherche scientifique, chose que naguère le mathématicien Henri Poincaré jugeait impensable, disant par exemple de la vivisection : « le Parlement peut tout, dit-on en Angleterre, sauf changer un homme en femme ; il peut tout, dirai-je, excepté rendre un arrêt compétent en matière scientifique. Il n’y a pas d’autorité qui puisse édicter des règles pour décider si une expérience est utile. » [19, p. 39]. En 2004, le Parlement français interdit la recherche sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires (sauf dérogation) ; il interdit absolument le clonage humain, qu’il soit reproductif ou thérapeutique ; il met sous la surveillance d’une autorité publique (l’Agence de la biomédecine) la recherche sur les cellules souches humaines… Tout laisse à penser que les politiques, effrayés par les rapides progrès de la recherche, essaient fébrilement d’en limiter les retombées.
3.2 La science avance
La période 1990–2010 connaît de grandes avancées scientifiques : naissance de la brebis Dolly, premier mammifère issu d’un clonage (1997) ; travaux sur les cellules souches, qui soulèvent de grands espoirs de traitements régénératifs ; découverte d’une technique permettant de « rajeunir » une cellule, c’est-à-dire de produire des cellules souches à partir de cellules matures (induced pluripotent stem cells ou cellules iPS) [20] ; en 2012 Yamanaka et Gurdon obtiendront le prix Nobel de physiologie–médecine pour leurs travaux sur la reprogrammation cellulaire.
Ce n’est pas tout. Le séquençage complet du génome humain est achevé et publiquement annoncé en 2003 ; cela permet un repérage sur le génome d’anomalies qui peuvent avoir un lien avec des maladies humaines. En peu d’années, près de 6000 maladies monogéniques (liées à des mutations sur un gène particulier) sont identifiées, elles sont répertoriées en ligne sur Wikipédia : myopathies, mucoviscidose, polykystose rénale, chorée de Huntington, bêta-thalassémie, BRCA 1 et 2, hémophilies, anémie falciforme, etc.
Les promesses d’une biologie de synthèse en plein développement [21] autorisent à entrevoir que ces anomalies génétiques, qui présentement peuvent être diagnostiquées, pourraient un jour être corrigées dans l’œuf, c’est-à-dire au début du développement embryonnaire, ou même que des traits désirables pourraient être conférés artificiellement à des embryons humains qui bénéficieraient ainsi d’un génome amélioré…
3.3 La bioéthique prend un tournant empirique
Les recherches « empiriques » en bioéthique sont celles qui recourent « aux méthodes de recherche des sciences sociales (anthropologie, épidémiologie, ethnologie, psychologie, sociologie…) pour l’examen direct de problèmes bioéthiques » [22, p. 227]. À partir des années 1980, le champ bioéthique est peu à peu envahi par des publications construites à partir d’enquêtes de terrain et de statistiques. À l’aube du xxie siècle, l’enseignement de la bioéthique n’est plus l’apanage des philosophes, et il se fait souvent à partir d’études de cas [23] : adieu les principes, vive la casuistique !
La bioéthique première définissait clairement les rôles : philosophes, théologiens, juristes énonçaient les règles, tandis que les sciences sociales décrivaient les pratiques. Les sciences sociales étaient les auxiliaires de la réflexion morale menée par ceux qui maniaient des principes normatifs (par exemple, autonomie du sujet moral) dont découlent des règles de conduite (par exemple, le chercheur doit demander le consentement du sujet). Mais s’il est empiriquement démontré que la règle est inapplicable, le principe peut être bousculé par un raisonnement de bas en haut (bottom-up). Sur le modèle de l’EBM (Evidence-Based medicine – médecine fondée sur des faits bien établis), quelques empiristes exigent à présent une éthique evidence based… [24,25]. Quand le théoricien lance qu’il est par principe immoral d’imposer un traitement expérimental à un être humain malade sans explication et sans lui demander son accord, le chercheur en sciences humaines met en évidence des réalités permettant de dire, par exemple, que dans une majorité de cas les malades n’ont pas clairement compris ce qu’on leur a expliqué, donc leur assentiment a été manipulé. S’il en est ainsi, on sera presque tenté de regretter le bon vieux paternalisme médical, inspiré de la règle d’or : « fais à autrui ce que tu voudrais qu’on te fasse… et garde le silence ».
3.4 Émiettement/moral relativism
Introduire en morale une touche de relativisme, ou de diversité, peut être une bonne chose. On voit, au tournant du xxie siècle, des éthiciens de formation philosophique s’apprivoiser aux méthodes de recherche sur le terrain, et des éthiciens sociologues ou psychologues de formation essayer de légitimer leur intervention dans le champ des normes [26]. On voit émerger des styles d’éthique variés : casuistique (abhorrée jadis par Blaise Pascal, réhabilitée par Jonsen et Toulmin [27]), ou éthique narrative (à propension littéraire). Approche casuistique [28] : une situation concrète pose problème, cette situation est analysée en détail, puis on cherche des cas semblables (il se dessine un type de cas), et on raisonne par analogie, jusqu’à dégager la meilleure décision à prendre dans ce type de situation. Approche narrative [29] : en partie inspirée de Paul Ricœur (et de la psychanalyse), elle se pratique parfois en soins palliatifs, où il se confirme que le récit d’un fragment de vie douloureux peut apaiser et restaurer une identité personnelle chez une personne en fin de vie. On voit aussi se dessiner des territoires bioéthiques spécialisés : neuroéthique [30], roboéthique [31].
Mais l’aveu d’un pluralisme de la bioéthique est troublant, certains s’en inquiètent. Ainsi Leigh Turner s’interroge sur l’existence même de la bioéthique, quand les bioéthiciens sont en désaccord sur tout : théories, méthodes de travail, règles de décision, politiques publiques…
« If bioethics is capacious enough to include libertarians, communitarians, deontologists, neo-kantians, utilitarians, neo-aristotelians, virtue theorists, feminists, rawlsians, habermasians, narrative theorists, interpretivists, principlists, casuists, civic republicans, liberal egalitarians and religious ethicists of every persuasion, does bioethics exist as something other than a loosely connected assemblage of conflicts over norms, principles, practices and policies ? » [32].
3.5 De l’éthique à la politique
Quand les bioéthiciens ne parlent pas d’une seule voix, le législateur peut rétablir l’ordre. Quand la loi court-circuite la réflexion éthique, les comités d’éthique sont limités dans leurs options. C’est le cas en France, où des « lois de bioéthique » (sic !) ont été en cascade votées par le Parlement. La loi de 1988 (dite loi Huriet) autorise et réglemente les recherches bio- médicales sur des êtres humains. En 1994 sont votées trois lois, respectivement :
- • sur le traitement des données nominatives ;
- • sur le respect dû au corps humain ;
- • sur le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain, l’assistance médicale à la procréation, et le diagnostic prénatal.
En 2004, cette troisième loi est révisée, y sont ajoutées l’interdiction du clonage (reproductif ou thérapeutique) ainsi que l’interdiction de principe de la recherche sur l’embryon humain et/ou les cellules souches embryonnaires humaines. Par dérogation, cette dernière est autorisée pour cinq ans, à condition qu’elle apporte un « progrès thérapeutique majeur », une clause dont les chercheurs ont toujours dit qu’elle les oblige à mentir, parce que la recherche fondamentale ne saurait garantir des retombées bénéfiques précises. En 2011 enfin, une autre loi autorise la vitrification des ovocytes (nouvelle technologie), interdit l’accès à la procréation médicalement assistée des femmes homosexuelles, interdit l’accès à l’identité des donneurs de gamètes. Quant à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, elle met en évidence une dissension au sein même du pouvoir législatif, puisque l’Assemblée nationale tend à l’interdire (avec possibilité de dérogation), tandis le Sénat tend à l’autoriser (sous surveillance) (les textes de ces lois sont en ligne).
D’un pays à l’autre, les lignes politiques varient. En dépit des efforts de Bruxelles, aucun consensus européen n’a pu être dégagé sur les principes éthiques encadrant la procréation médicalement assistée, sur son versant recherche comme sur le versant des soins. Il arrive donc qu’il suffise de traverser la frontière pour obtenir du voisin ce qui est interdit chez soi : financement d’un projet de recherche audacieux, diagnostic préimplantatoire, fécondation in vitro, gestation pour autrui. Où est la morale ? Ici elle résulte d’un débat parlementaire, là d’une consultation citoyenne. En Grande-Bretagne, la haute autorité en charge de la régulation des activités de recherche sur l’embryon humain [33] autorise en 2008 des chercheurs à se servir de cellules embryonnaires hybrides (« cybrides » : noyau humain, cytoplasme animal) à la suite d’une consultation publique d’où s’est dégagée une majorité favorable à cette autorisation. (Voir aussi [34]).
3.6 L’éthique du soin
Le succès des éthiques du soin (ou du care) a pu laisser croire, à la fin du xxe siècle, au retour d’une éthique consensuelle, dont l’inspiration est très éloignée du néokantisme discret des premiers promoteurs de la bioéthique. D’inspiration féminine (mais non pas féministe), c’est une morale du sentiment, plus que de la raison, qui prend appui sur les travaux de deux femmes américaines [35,36]. Les femmes sont censées être plus dévouées à leurs proches, et plus attentives à leurs besoins, que leurs compagnons masculins. Elles ne raisonnent pas de la même façon que les hommes. Et ce sont les femmes qui inculquent la morale aux jeunes enfants. L’éthique du care est une sorte d’extension de l’entraide familiale à l’ensemble de la communauté humaine [37]. Souvenons-nous aussi de Hans Jonas, pour qui la responsabilité parentale est « l’archétype de toute responsabilité », le cri impérieux du petit enfant qui a faim étant appel à la responsabilité de l’adulte [16,ch. IV: III, 4].
Prenons un exemple. Une ville scandinave décide de s’organiser pour que toutes les personnes âgées, même atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres incapacités, puissent jusqu’à la fin de leur existence demeurer chez elles (dans leur logement), participer à la vie commune, et jouir de leurs droits citoyens ; cela, grâce à la solidarité de leurs voisins, qui s’occupent d’elles, et à une réorganisation communautaire de l’aide médicale, sociale, et ménagère…
Une manière éclairante de penser à l’éthique du care est de se souvenir du droit d’ingérence revendiqué par les organisations humanitaires : allons vacciner les Somaliens contre les maladies qui les menacent, bien qu’ils ne nous aient rien demandé. À ceux qui cherchent ce qu’il faut faire, il sera dit : « ne ratiocinez pas, suivez votre cœur ». En s’éloignant ici du paradigme égalitaire de la bioéthique initiale (autonomie du sujet moral), pour se rallier à un modèle inégalitaire du lien moral (amour et dévouement des parents pour leur progéniture, du médecin pour ses malades, des humanitaires pour les malheureux sans-abri, etc.), on risque des errements qui, pour être contenus, nécessitent l’intervention d’une politique d’aide rationnelle – d’où l’évolution de l’éthique du soin (seconde génération) vers une philosophie politique [38,39].
4 Conclusion
4.1 Le devenir « technologique » de l’homme
Compte tenu des avancées de la science, on ne se contente plus, au début du xxie siècle, de proposer des traitements novateurs aux malades (chirurgie exécutée par des robots, électrodes introduites dans le cerveau pour traiter les parkinsoniens), on envisage aussi d’améliorer techniquement les performances des humains en bonne santé. L’homme faisant corps avec ses robots multiplierait ses possibilités, depuis l’acquisition d’une capacité de vision nocturne, jusqu’au transfert direct de connaissances dans le cerveau via l’ordinateur sans effort d’apprentissage, etc. Gilbert Hottois [40] argumente judicieusement qu’à côté d’un transhumanisme quelque peu délirant qui rêve de rendre l’homme immortel, il y a aussi un transhumanisme ouvert et sage, dans la lignée de Condorcet [41] et de Julian Huxley [42], qui, plutôt que de condamner l’usage technologique des nouvelles acquisitions scientifiques, s’emploie à en imaginer le potentiel utile et positif pour notre espèce.
L’exploration des possibilités qui s’ouvrent a été menée au plus haut niveau, aux États-Unis, et en Europe. Le rapport commandité par la Fondation nationale de la science américaine [43] cherche comment la convergence accélérée de quatre types de sciences (les « NBIC » : nano, bio, info et robo) pourrait améliorer la communication entre les gens, la santé et les aptitudes physiques de tous, la vie sociale, et la sécurité nationale. Le rapport européen dont A. Nordmann a été rapporteur [44] aligne un plus grand nombre de domaines à faire converger (« nano-bio-info-cogno-socio-anthro-philo-geo-eco-urbo-orbo-macro-micro-nano »), examine à la fois les chances et les risques de la mise en route de telles convergences (les CTEKS : « Converging Technologies for the European Knowledge Society »), et conclut par seize recommandations, dont celle de toujours soumettre les projets de recherche « CTEKS » à un examen éthique. Plus récemment, le Parlement européen a commandité un rapport sur l’amélioration humaine [45]. Quelques philosophes se sont aussi essayés à penser ce que les récentes avancées scientifiques et technologiques vont changer dans nos vies (voir par exemple : [46]). Mais où en sont les savants qui produisent les découvertes qui sont à l’origine de l’évolution technologique humaine ?
4.2 Doutes sur l’honnêteté de la recherche
Les publications scientifiques aujourd’hui foisonnent, au point qu’un chercheur individuel ne peut plus prendre connaissance de tout ce qui se publie dans sa discipline : y a-t-il des procédures numériques pour résumer les travaux importants ? [47] La convergence est utile : quand il faut apprendre à traiter des masses de données (big data), comme c’est le cas pour l’étude du microbiote intestinal, l’informaticien vient au secours du biologiste. Et la pose d’un cœur artificiel mobilise tout un ensemble concerté de technologies. Nombreuses sont les avancées devenues familières en matière de prothèses : implants dentaires, jambes ou bras artificiels, pace maker, cell phone… Il est cependant des domaines où la technologie montre ses limites : le retour des maladies infectieuses est annoncé, avec la faillite des antibiotiques, dont on avait pensé qu’ils auraient raison de toutes les épidémies, et les médicaments que l’industrie pharmaceutique avait produits pour traiter la maladie d’Alzheimer se révèlent inutiles.
En 1974, les savants revendiquaient la responsabilité de veiller sur le devenir technologique de l’espèce humaine, qui découle des performances de leurs travaux de recherche. Quarante ans plus tard, cette responsabilité échoit aux politiques, qui vont jusqu’à guider le développement même de la recherche (par leurs appels d’offres).
La communauté scientifique, qui se voulait responsable, est soupçonnée de tricher. Elle avoue des manquements à la déontologie de la recherche. La très sérieuse revue Science soulevait la question de la fraude dès les années 1980 [48]. Depuis cette époque, une stratégie a été mise au point par les financeurs de la recherche, pour lier l’attribution de crédits de recherche à un engagement de « bonne conduite », consolidé par la souscription d’une assurance anti-fraude. Et la profession tout entière s’est mobilisée lors de trois conférences mondiales autour du thème de l’intégrité scientifique. La première conférence s’est tenue à Lisbonne en 2007 :
« The World Conference on Research Integrity was the first global forum convened to provide researchers, research administrators, research sponsors, journal editors, representatives from professional societies, policymakers, and others an opportunity to discuss strategies for harmonizing research misconduct policies and fostering responsible conduct in research »
online.La seconde conférence a élaboré des règles de conduite pour le chercheur individuel (Singapour Statement, 2010 : online), la troisième a formulé des règles de conduite pour les collaborations entre chercheurs (Montreal Statement, 2013 : online). Désormais, pour se protéger, les institutions de recherche affichent des chartes d’éthique, et pour éviter les accusations de conflit d’intérêts, elles proposent à leurs chercheurs des chartes de l’expertise. Le souci éthique a rejoint le travail scientifique.
Déclaration d’intérêts
L’auteur déclare ne pas avoir de conflits d’intérêts en relation avec cet article.