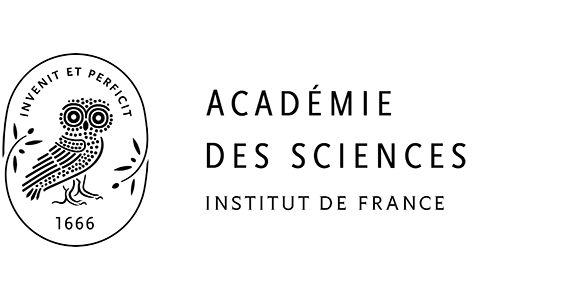1 Introduction
Depuis quelques années, on parle de « biologie synthétique » et parfois aussi d’« homme synthétique ». Que désignent ces termes ? Et la notion de « synthétique », qui intervient dans les deux expressions, a-t-elle la même valeur dans les deux cas ? Si oui, qu’est-ce qu’une pareille notion laisse présager de cet homme dit « synthétique » ? Ce sont les questions que nous poserons dans le texte qui suit. Ce faisant, nous montrerons que les notions de « biologie synthétique » et d’« homme synthétique » reposent sur une conviction philosophique commune. C’est cette conviction qu’il s’agira ensuite d’analyser.
Indiquons tout de suite le point où nous conduira cette analyse. À suivre les pronostics de certains commentateurs, la technologie contemporaine est sur le point d’entraîner une recomposition du concept même d’être humain : recomposition exaltante pour les uns, qui parlent de l’apparition d’un « homme nouveau » ; inquiétante pour les autres, qui parlent, quant à eux, plus volontiers, de la « disparition de l’homme » et de l’humanisme. Nous montrerons que, dans ces débats, le concept d’« homme synthétique » est, le plus souvent, abusivement confondu avec le concept d’« homme nouveau ». Cette confusion entraîne une orientation erronée des débats sur les progrès techniques à venir : l’homme synthétique, à parler rigoureusement, n’est ni un homme nouveau ni un surhomme, contrairement à ce que laisse entendre toute une partie de la littérature transhumaniste.
Mais avant d’y venir, suivons l’histoire d’une expression, d’une locution : celle de « biologie synthétique ». C’est elle qui nous fera mieux comprendre le sens que possède l’expression « homme synthétique ».
2 Histoire du concept de « biologie synthétique »
Le terme de « biologie synthétique » est apparu pour la première fois au début du vingtième siècle sous la plume d’un biologiste et chimiste français du nom de Stéphane Leduc, professeur de médecine à l’université de Nantes, qui a publié, en 1910, aux Éditions Poinat, un livre intitulé Théorie physico-chimique de la vie et générations spontanées [1]. Ce livre contient un chapitre intitulé La biologie synthétique. Leduc y présente l’idée selon laquelle la biologie aura un développement semblable à celui de la chimie. En 1912, Leduc publie un autre livre intitulé cette fois La biologie synthétique, étude de physique. Manifestement, la notion de « biologie synthétique » a fait dans son esprit, pendant l’intervalle qui sépare les deux publications, des progrès qui lui ont permis de passer du rang de simple chapitre à celui de titre d’un ouvrage. C’est devenu une formule – presque un slogan – que Leduc paraît vouloir promouvoir (sur Stéphane Leduc, voir [2,3]).
Dans ce livre, Stéphane Leduc développe à nouveau l’idée d’une similitude entre l’histoire de la chimie et celle de la biologie. La chimie, explique-t-il, est en avance sur la biologie, mais toutes les sciences suivent fondamentalement le même parcours. De sorte que la science la plus avancée nous permet de savoir ce vers quoi s’achemine celle qui l’est moins. Il y a dans cette affirmation tout un ensemble de postulats épistémologiques que Leduc affirme plus qu’il ne les démontre. De ces postulats, il conclut, en tout cas, que puisque la chimie est passée, au cours de son histoire, au XIXe siècle, de l’analyse à la synthèse, la biologie, qui en est, selon lui, encore au stade de l’analyse, en viendra tôt ou tard à l’époque de la synthèse, quand les biologistes seront à même de composer la vie comme les chimistes sont à même, au moment où il écrit, de composer des molécules à partir des atomes. Nous sommes aux temps des débuts de la science de l’hérédité, mais, rappelons-le, on n’a cependant encore aucune idée de la nature du support matériel de l’hérédité génétique. On n’en a encore moins, bien entendu, d’un éventuel moyen de manipuler ce support inconnu.
Entre le moment où un pronostic sur l’avenir de la science est émis pour la première fois et le moment où il commence à se réaliser dans les faits, il peut s’écouler tellement de temps que, lorsque ce second moment survient, on a entièrement oublié celui qui en avait émis l’idée. C’est ce qui s’est passé pour Leduc, qui meurt en 1939 sans avoir pu constater le plus petit succès de son innovation terminologique. Pourtant, le terme de « biologie synthétique » va renaître sans qu’on mentionne le nom de Leduc au moment de cette renaissance. Preuve, sans doute, que le terme était bien choisi : il n’était pas le produit de la fantaisie arbitraire de son auteur, mais correspondait à une nécessité intrinsèque de la langue dans ses rapports aux nouvelles réalités qu’élaborent les sciences du vivant. Le terme va ainsi revenir en 1974 et, chose peut-être plus étonnante encore, il va disparaître à nouveau.
C’est sous la plume de Waclaw Szybalski, un biologiste américain d’origine polonaise, que la notion de « biologie synthétique » réapparaît [4]. Même enthousiasme, même sentiment de se situer à un tournant que chez Leduc. Commentant la révolution du génie génétique, Szybalski annonce une nouvelle ère : « Jusqu’à présent, explique-t-il, nous travaillions sur la phase descriptive de la biologie moléculaire. Mais le vrai défi commence lorsque nous intégrons la recherche en biologie synthétique dans notre domaine. Nous allons pouvoir concevoir de nouveaux éléments de contrôle [génétique] et ajouter ces éléments aux génomes existants ou même construire entièrement de nouveaux génomes ». Ce sont effectivement des modifications envisageables dès cette époque pour ceux qui font usage des techniques d’ADN recombinant, comme on les nomme à l’époque. ADN recombinant, génie génétique, génétique in vitro : ce sont là d’autres termes qui font alors leur apparition. Figure, donc, au milieu de ces termes, celui de « biologie synthétique ».
Pourtant, l’expression n’aura pas plus de succès que lors de sa première formulation par Leduc. C’est donc aussi la preuve, sans doute, que si le terme était bien choisi, il ne pouvait néanmoins s’ajuster à n’importe quel état du savoir biologique et qu’il fallait attendre que ce savoir lui correspondît pour que le terme commençât à être repris, à circuler et à posséder une vie propre. Car si les techniques de recombinaison d’ADN se développent dans les années 1970–1980 au point de devenir des techniques de routine dans les laboratoires de biologie, elles ne seront que rarement désignées, si curieux que cela puisse sembler rétrospectivement, par le terme de « biologie synthétique ».
Les choses vont changer cependant en 2004. Le vocable de « biologie synthétique » va apparaître pour la troisième fois. Le terme n’est pas nouveau, on vient de le voir, et il ne désigne pas non plus quelque chose qui était nouveau à ce moment-là. Et, cette fois, on ne sait pas précisément à qui cet emploi (ce réemploi, plutôt) est dû. Lorsqu’une expression se généralise, elle entre, pour ainsi dire, dans le domaine public, et il arrive qu’il ne soit pas possible d’identifier celui qui l’a introduite. Tout au plus peut-on rappeler les emplois antérieurs, comme je viens de le faire, dont les auteurs restent identifiés en raison même du peu de succès qu’eut leur proposition terminologique au moment où ils la formulèrent.
Cette nouvelle apparition de l’expression « biologie synthétique » se fait dans un contexte qui, de son côté, est bien connu. C’est celui de la mise en place du premier « concours de génétique » destiné initialement aux étudiants de quelques universités américaines. Le concours s’appelle IGEM (International Genetically Engineered Machine, mais, à l’époque le I de « international » signifiait « interuniversitary »). Les participants au concours, qui se présentent en équipes, doivent concevoir et réaliser en quelques mois un dispositif génétique original à partir de fragments d’ADN standardisés nommés « biobricks », qui sont mis à leur disposition. Ces fragments ont la particularité d’être flanqués de sites de reconnaissance par des enzymes de restriction, ce qui permet de réaliser facilement, à partir d’eux, des assemblages génétiques variés. Aujourd’hui, le concours s’est étendu au monde entier et plusieurs centaines d’équipes y participent chaque année. Une équipe a, par exemple, réalisé des bactéries qui changent de couleur lorsqu’elles sont exposées à l’arsenic (ce qui peut s’avérer extrêmement utile pour repérer la toxicité de sources d’eau dans certains pays où les moyens de détection de particules toxiques sont difficiles d’accès). Les constructions génétiques réalisées dans le cadre de ce concours sont ensuite librement accessibles : le règlement du concours s’inspire ici des usages qui ont été adoptés par le mouvement du logiciel libre, lesquels ont conduit, comme on sait, à la multiplication de logiciels ou des systèmes d’exploitation (Linux) gratuits et souvent, néanmoins, extrêmement performants.
3 Fondements philosophiques de la biologie synthétique
On va donc parler de biologie synthétique pour désigner cette conception de la biologie très marquée par une approche d’ingénieurs. La biologie synthétique se veut aussi ludique. Elle entend « ré-enchanter » la science en y introduisant des ingrédients qui font le succès des compétitions sportives : à la fois le sens de la rivalité émulatrice entre les équipes et le sens de la camaraderie entre les membres de l’équipe. Voici un bref extrait d’une interview de Randy Rettberg, le fondateur du concours IGEM qui fut aussi longtemps son président : « Nous souhaitons imiter les compétitions sportives. Car le sport s’appuie sur un mécanisme humain qui génère de l’attention. Si vous regardez les personnes qui font du sport, vous verrez qu’il y a de nombreuses analogies avec ce que nous essayons de faire. La compétition IGEM est, d’ailleurs, une forme de sport. Voyez combien d’universités ont de superbes équipes sportives très bien dotées financièrement. L’un de mes objectifs dans le cadre d’IGEM est de faire quelque chose d’équivalent. […] Et si vous vous demandez, maintenant, pourquoi les gamins qui font du sport aiment cette activité, vous verrez que ce n’est pas tellement pour gagner la compétition, mais que c’est surtout par goût du jeu. Eh bien, l’ingénierie génétique est un jeu. C’est ce que nous célébrons avec notre concours ».
Donc, premier caractère de cette recherche : son côté ludique. Il s’agit de jouer, de s’amuser, de faire de la science un jeu, de s’exalter des perspectives qu’elle ouvre, de s’en réjouir avant même de les interroger.
Lorsqu’on demande aux organisateurs de ces compétitions s’ils ne craignent pas que les manipulations réalisées ne débouchent un jour sur un effet imprévu et dangereux, il arrive qu’ils répondent en évoquant avec une pointe de fatalisme l’argument (qu’on désigne parfois sous le nom de « principe de Gabor ») de Dennis Gabor, prix Nobel de physique, selon lequel tout ce que la technique humaine permet de mener à bien sera réalisé un jour ou l’autre, les précautions éthiques ne jouant, à l’égard de ces réalisations, que le rôle de ralentisseur. « Tout ce qui est techniquement réalisable sera réalisé, quoi qu’il en coûte moralement » [5]. Cette idée, qu’on pourrait qualifier de « fatalisme du progrès » constitue l’une des convictions inhérentes à ces approches. On ne la trouve, d’ailleurs, pas seulement exprimée dans ce domaine de la biologie synthétique, mais dans beaucoup de secteurs qui sont confrontés à la question des effets possibles des développements de la science et de la technique. Deuxième conviction, donc : l’éthique est inutile, elle n’est que le scrupule que crée le manque de lucidité sur l’avenir.
Mais je voudrais surtout m’arrêter sur une troisième conviction essentielle, qu’on trouve mentionnée de façon explicite par ceux qui réfléchissent sur la signification des développements de la biologie synthétique, comme le fait Robert Carlson dans son livre Biology Is Technology [6]. C’est la conviction la plus fondamentale qui se trouve au cœur de la biologie synthétique, et elle est tout entière exprimée dans le titre du livre. Le vivant, la vie, c’est de la technique. « Biology is technology » : cette affirmation apparaît comme une évidence à l’auteur du livre. Une évidence dont la biologie synthétique aurait, selon lui, pour tâche d’explorer les conséquences.
Carlson, remarquons-le, ne dit pas que les organismes vivants sont des machines, comme le faisait Descartes (dans la cinquième des Méditations métaphysiques [7]) ou, plus tard, La Mettrie (dans L’homme machine [8]). Technologie ne veut pas dire machine. Une machine est toujours conçue dans un certain but, avec une certaine intention. Rien de tel dans les êtres vivants qui n’ont pas de buts spécifiques, mais seulement des propriétés spécifiques, et notamment celle de se reproduire. Mais ce n’est pas parce que les êtres vivants ne répondent pas à un objectif déterminé qu’ils ne sont pas le produit d’une organisation technique de la matière.
On trouve donc au moins trois principes à la racine de la biologie synthétique. Ils reviennent de façon régulière dans les propos de ses promoteurs : un principe ludique, selon lequel la biologie peut se pratiquer comme un jeu créatif ; un principe de fatalisme du progrès, selon lequel tout ce qui peut se faire se fera quoi qu’il arrive ; et enfin une conviction technocentrique, selon laquelle toute vie est technologie. Ces trois éléments, pris ensemble, forment le système de légitimation de la biologie synthétique. On modifie des organismes vivants parce qu’il est possible de le faire, parce que ce sera fait de toute façon un jour ou l’autre, et par jeu, parce que c’est amusant, parce que l’homme aime jouer avec les possibles que la vie lui offre. Ces trois arguments ne sont évidemment pas indépendants les uns des autres. Ils forment un système interconnecté. Et l’idée centrale du système, l’idée la plus profonde, c’est l’idée selon laquelle la biologie est de la technologie : le principe que j’appelais, à l’instant, techno-centrique.
4 L’homme synthétique
La biologie synthétique concerne exclusivement des organismes simples. Elle ne concerne donc pas, ou du moins pas encore, les organismes plus complexes et, a fortiori, les humains (exceptionnellement le terme est appliqué à des opérations réalisées chez les plantes). Les enjeux éthiques sont évidemment moindres lorsqu’il s’agit de micro-organismes que lorsqu’il s’agit d’organismes comme des mammifères ou des humains. On connaît, déjà depuis l’époque de Claude Bernard, des ligues de défense des animaux et on voit se multiplier des discours parfois très élaborés qui visent à défendre l’idée d’un droit des animaux (voir, par exemple, à ce sujet, le livre de Peter Singer Animal liberation [9]). Mais nul n’a jamais proposé d’élaborer un droit des bactéries. On ne connaît donc, dans ce domaine, que des problématiques éthiques indirectes. On peut s’interroger, par exemple, comme on le fit à Asilomar au début des années 1970, sur l’impact que pourraient avoir des bactéries modifiées sur des organismes supérieurs. Mais on ne s’interroge pas sur l’effet que peuvent avoir ces transformations sur les bactéries elles-mêmes.
Il n’en va pas de même lorsqu’on applique le principe technocentrique que nous avons repéré dans la biologie synthétique à l’être humain. Là, des questions éthiques se posent directement, puisque c’est toujours l’homme qui est concerné par l’éthique et puisqu’il est le seul être capable (même si c’est de façon notoirement imparfaite) d’envisager les conséquences de ce qu’il fait. Il apparaît alors très vite que les réflexions sur la technique ne peuvent pas être limitées aux seules possibilités qu’elle offre ou pourrait offrir. On doit y adjoindre une réflexion sur les désirs humains. Car les techniques qui sont utilisées par l’homme ne le sont pas en raison du fait qu’elles sont simplement disponibles. Elles le sont en raison du fait que quelqu’un en désire les effets soit pour lui-même, soit parce qu’il pense pouvoir tirer profit de la mise à disposition de ces effets auprès d’autres personnes.
Or la première chose qui frappe, dès qu’on s’intéresse à la nature du désir chez l’homme, c’est sa variabilité. Ce que l’un désire, un autre l’exècre ; ce que l’un veut, un autre le redoute ; ce que l’un adore, un autre le déteste, etc. (La bibliographie, sur ce sujet, est immense [10]). C’est d’ailleurs précisément ce constat qui est à l’origine du fatalisme du progrès qu’évoque Dennis Gabor. En effet, sachant que les humains ne sont pas d’accord sur ce qui est bon et sur ce qui est mauvais pour eux, on peut en inférer comme une conséquence directe que, pour toute innovation, il se trouvera des individus pour la juger mauvaise ou dangereuse et d’autres pour la juger bonne et utile. On retrouve donc ici le principe de Gabor sous une autre forme. Il n’est plus énoncé comme une loi de tonalité pessimiste, mais comme une des conséquences de la diversité des désirs humains.
Pourtant, certaines situations permettent tout de même de faire un pronostic assez précis sur les désirs qui seront éprouvés par des individus, par-delà leur diversité de sensibilité. Si on demande à celui qui souffre d’une pathologie s’il désire ne plus en souffrir, on n’a guère de doute à avoir sur la réponse qu’il fournira. Il y a donc des désirs qui peuvent être prévus, anticipés, et c’est notamment le cas pour ce qui concerne les désirs portant sur la guérison des maladies. Ce sont ces désirs que la médecine prend en charge.
Or dans le domaine de la médecine, nous retrouvons certains des caractères que nous avons repérés dans la biologie synthétique : un certain fatalisme du progrès s’y exprime assez souvent (c’est le cas, par exemple, de Robert Edward, le père de la fécondation in vitro, qui, dans son livre Life before birth, reflections on the embryo debate, explique, en substance, que d’autres auraient mis au point la technique s’il ne l’avait pas fait lui-même [11]) et une forme de technocentrisme (l’homme–puisqu’il s’agit cette fois de l’homme–est une créature technique). Il y a cependant une différence importante : la dimension ludique y est remplacée par une dimension compassionnelle. En effet, la légitimation des opérations qu’on entreprend de réaliser lorsqu’il est question de médecine présente aucun caractère ludique, mais vise à venir en aide à des personnes qui sont atteintes par des maladies. Il ne s’agit pas, le plus souvent, de se réjouir des possibilités offertes par une connaissance technique du vivant, mais de s’appuyer sur cette connaissance technique pour porter secours à une personne.
Je dis « le plus souvent » et non pas « toujours », car le pôle ludique n’est jamais loin du pôle compassionnel. En effet, les techniques mises au point dans un but thérapeutique peuvent très facilement devenir des techniques d’amélioration de l’humain, qui seront, cette fois, utilisées dans un but d’augmentation des performances de l’homme, et donc dans une perspective plus proche du ludique que du thérapeutique.
Songeons, par exemple, aux traitements élaborés, dans les dernières décennies, pour soigner les maladies de la composition du sang qui sont connues sous le nom d’anémies. Ces techniques, devenues très efficaces, ont conduit à la mise au point de produits – l’érythropoïétine de synthèse notamment – qui furent utilisés ensuite dans un but d’amélioration des performances de certains sportifs (voir le livre d’Eugene Goldwasser, le biologiste qui a cloné le gène de l’érythropoïétine en 1985, A bloody long journey [12]). Or l’amélioration des performances relève du jeu de l’homme avec ses propres limites, même si elle est pratiquée avec le sérieux et la concentration qu’exige un engagement dans une compétition sportive. Le dopage est une forme de jeu avec soi-même et avec ses propres limites (voir La philosophie du dopage [13]). Son existence démontre, mieux que n’importe quel raisonnement, comme nous l’indiquions, que le ludique n’est jamais très éloigné du compassionnel. De l’homme réparé à l’homme augmenté, il n’y a qu’une différence d’accent : la différence entre le compassionnel et le ludique.
L’homme synthétique que j’évoquais en commençant, c’est donc cet homme qui se dessine sur les contours de l’homme réparé. C’est en effet sur ces contours que s’opère la transformation du compassionnel en ludique. Que va faire l’homme de ces nouveaux pouvoirs ? C’est la question que pose l’éthique quand elle tente d’envisager ces pratiques nouvelles. Ces pratiques sont si diverses qu’il est difficile de les envisager de façon générique et qu’il convient de raisonner sur des exemples qui ont, bien sûr, comme tous les exemples, leurs limitations. Je m’arrêterai sur un domaine spécifique de progrès des pratiques médicales dans lequel on trouve ce double aspect. Un exemple, comme on va le voir, particulièrement significatif et qui illustre bien la situation des sciences contemporaines.
5 Les interfaces homme–machine
Il se rattache à un domaine qui a pratiquement envahi la vie quotidienne d’un grand nombre d’individus depuis quelques décennies dans les sociétés occidentales : le domaine des interfaces homme–machine. De ces interfaces – l’écran d’ordinateur est une des plus courantes d’entre elles – nous faisons un usage quotidien. Mieux, même, nous ressentons, si on en croit certains sociologues, de plus en plus souvent le désir d’accroître ces connexions avec les machines [14].
Qui n’a, par exemple, au beau milieu d’une conversation, éprouvé le désir de vérifier une information ou de retrouver un mot qui lui manquait en faisant usage de la prolixité des savoirs qui circulent autour de nous sur le réseau Internet ? Ce dernier pourrait nous fournir l’information dont on sent cruellement l’absence. C’est l’expérience courante du « trou de mémoire ». Le nom d’une personne nous échappe, mais nous avons déjà commencé la phrase dans laquelle nous aimerions le faire figurer. Faut-il trouver un habile contournement pour désigner la personne qu’on a en tête sans la nommer ? Faut-il reconnaître humblement les imperfections de notre mémoire ? Le réflexe qu’on voit aujourd’hui se répandre est plutôt de s’emparer d’un « smartphone » pour retrouver au plus vite le nom à cet instant oublié. Une interface avec une machine qui pourrait fournir ce nom n’est, en effet, jamais très éloignée. Mais elle pourrait être encore plus proche de nous. Encore plus disponible et plus accessible. Elle pourrait être, par exemple, logée discrètement dans des verres de lunettes. Elle pourrait même être plus proche encore. Car le but de ces divers écrans est toujours de produire une image sur notre rétine. On pourrait donc envisager d’implanter directement sur la rétine de l’œil un dispositif qui permettrait de rendre accessibles en permanence des informations qui nous apparaîtraient comme sur un écran transparent. Nous aurions alors, à portée de neurones pour ainsi dire, la possibilité de voir apparaître les informations qui peuvent venir à nous manquer au cours d’une conversation. L’interface homme–machine serait intégrée dans l’homme même.
Ce faisant, on franchirait une étape décisive. Car même si le résultat visé par la mise en place d’un tel dispositif est virtuellement identique à celui qu’on obtient en regardant un écran, il faut, pour l’obtenir, réaliser un acte de chirurgie qui est bien différent du simple rapport avec un objet extérieur. Pourtant nombreux sont ceux qui envisagent que cette étape sera prochainement franchie. Ils vont même plus loin. La rétine est, à leurs yeux, une cible insuffisante : c’est encore un organe sensoriel qui reçoit des impulsions du monde extérieur, l’ultime organe qui précède l’entrée dans l’empire mystérieux du système cérébral. Ne pourrait-on envisager de mettre directement en contact une machine avec le cerveau ?
Non seulement on peut l’envisager, mais certains traitements médicaux le font déjà, remarquent ceux qui s’intéressent à ces possibles évolutions, comme pour insister sur le fait que le développement de ces techniques est inévitable. Ceux qui sont à l’origine de ces techniques sont désormais reconnus et célébrés. Ainsi le docteur Allim-Louis Benabid, un neurochirurgien français, vient-il de recevoir le prestigieux prix Lasker pour sa contribution à la mise au point d’un dispositif connu sous le nom de Deep Brain Stimulation : la stimulation cérébrale profonde [15]. Cet appareil produit des améliorations spectaculaires de l’état des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, maladie qui entraîne, comme on sait, des tremblements intempestifs handicapants. Ces tremblements cessent pratiquement instantanément lorsque les patients activent le dispositif de stimulation cérébrale préalablement implanté dans leur cerveau.
L’appareil est constitué de deux électrodes reliées à une source d’énergie, qui doivent être délicatement introduites dans les profondeurs de la substance cérébrale. L’intervention qui permet de mettre en place un tel appareil a un caractère invasif. Mais les bénéfices qui en résultent sont indéniables pour les patients atteints de maladie de Parkinson. Et pas seulement pour ces malades. Car si la technique a été initialement mise au point pour soigner cette pathologie, on s’est aperçu par la suite qu’elle pouvait aussi s’avérer efficace pour de nombreuses autres pathologies, comme le trouble obsessionnel, la dépression, la dystonie, la maladie d’Alzheimer, etc. Aujourd’hui, c’est environ 300 000 personnes dans le monde, atteintes de ces pathologies variées, qui sont équipées de ce type de dispositif.
On le voit, l’interface avec la machine (machine très simple, dans ce cas, puisqu’elle fournit simplement une stimulation électrique) ne passe pas par un organe sensoriel, mais communique directement avec le cerveau. Pourtant, si les effets thérapeutiques sont avérés, les médecins constatent aussi de curieux effets secondaires qu’ils ne savent pas très bien interpréter et qui montrent qu’on évolue ici dans un domaine encore très mal connu. Les philosophes commencent à s’intéresser de près à ces effets [16].
Certains patients, en effet, notent que leur « personnalité » se modifie sous l’effet du traitement. Certains, de plus, vivent ce changement comme favorable et l’apprécient, tandis d’autres l’éprouvent comme très désagréable. Certains, par exemple, ont vu leur mémoire des événements de leur propre vie, leur mémoire biographique, augmenter. Et ils prennent plaisir à ce nouvel état. D’autres estiment que leur créativité est accrue par le dispositif. Mais d’autres encore ne se reconnaissent plus eux-mêmes et souhaitent arrêter le traitement en dépit des bénéfices qu’ils lui reconnaissent par ailleurs. L’une des particularités de ce système est qu’il doit être alimenté par un courant électrique pour fonctionner. Son effet peut donc être arrêté ou réenclenché à volonté. Il est ainsi possible de faire, chez un même patient, des bilans très précis des conséquences de la stimulation : situation inédite dans le domaine de la psychiatrie.
Ces résultats (que je peux davantage détailler ici) montrent au moins deux choses : la première, c’est que ces interfaces directes entre une machine et la matière cérébrale ouvrent des perspectives très remarquables, même si leurs contours sont encore difficiles à cerner. C’est le point positif. La seconde, c’est que nous ne savons pas précisément comment elles fonctionnent, puisque des effets variés se présentent d’une façon imprédictible et ne peuvent, à l’heure actuelle, faire l’objet d’une interprétation complète.
Ces techniques ont été mises au point dans un but thérapeutique. Mais certains réfléchissent déjà à des demandes qui pourraient émaner de personnes ne souffrant d’aucune pathologie qui chercheraient à exalter leur créativité ou à stimuler leur mémoire [17]. Tout comme dans le cas des anémies évoqué plus haut, la médecine ne demande pas tout d’abord : « comment augmenter la mémoire ? » Elle demande plutôt : « comment guérir telle maladie ? » Et, en tentant de répondre à cette dernière question, elle élabore des techniques qui peuvent devenir des moyens d’augmenter la mémoire de tout un chacun. La pathologie joue ici, on le voit, le rôle d’un élément de légitimation de la recherche. Mais la recherche, une fois qu’elle a mené à des thérapeutiques efficaces, débouche sur des possibilités de modification qui dépassent le cas des pathologies.
Le dispositif mis en œuvre dans le cadre de la stimulation cérébrale profonde est, techniquement, relativement simple. D’une part, parce que l’interface ne fonctionne ici que dans le sens qui va de la machine à l’homme et non dans le sens qui va de l’homme à la machine (alors que la plupart des autres dispositifs d’interaction homme–machine que nous connaissons supposent un fonctionnement dans les deux sens). D’autre part, parce que l’interface en question est limitée à la fonction qui consiste à fournir des impulsions électriques. Pourtant, un tel dispositif, si rudimentaire qu’il puisse être par rapport à ceux qu’il est permis d’imaginer, ouvre une porte entièrement nouvelle à l’éthique du rapport à soi. Il représente une nouvelle possibilité d’agir sur soi. Or, agir sur soi est une très ancienne préoccupation philosophique. Rappelons les réflexions souvent amères des stoïciens sur les limites des capacités qu’a l’homme de se modifier lui-même : video meliora, proboque, deteriora sequor, « je vois le meilleur, je l’approuve, mais je fais le pire ».
Les stoïciens ont recherché des techniques efficaces pour échapper à cette contradiction inhérente à la nature de l’homme. Ce faisant, ils ont surtout été amenés à souligner la faiblesse de l’homme dans ses rapports à lui-même, le peu de pouvoir qu’il a sur ses passions. Certains d’entre eux auraient sans doute accueilli avec beaucoup d’intérêt une technique qui semble pouvoir promettre une plus grande maîtrise de soi. L’homme synthétique qui se dessine ici n’est donc pas un surhomme. C’est l’homme que nous connaissons. Ce n’est pas un homme qui peut faire des choses que les humains ne peuvent pas faire. Car les techniques des stoïciens fonctionnaient, dans une certaine mesure, même si, comme le souligna plus tard Spinoza, il fallait beaucoup d’efforts pour s’en rendre maître. L’homme synthétique qui se dessine est un homme qui pourrait faire un peu mieux ce que les hommes font depuis toujours en s’appuyant sur la connaissance imparfaite qu’ils ont d’eux-mêmes. Mais ce n’est pas un homme nouveau. Sa nature n’est pas modifiée dans ses principes par la technique. Et la meilleure manière de connaître cette dernière est encore de lire Plutarque, Montaigne ou Pascal.
6 Discussion
En traçant un parallèle entre la biologie synthétique et les perspectives d’un futur « homme synthétique » se dégage ainsi nettement le principe commun qui sous-tend ces deux concepts : l’idée que la biologie est de la technologie et que l’homme, lui aussi, est de la technologie.
L’idée selon laquelle la biologie est de la technologie n’est donc pas un simple slogan ou une formule élégante propre à fournir un titre pour un livre, même si elle peut aussi être cela. C’est une idée qui comporte d’importantes conséquences sur la conception que nous pouvons avoir des rapports de la technologie avec la vie. En effet, s’il est vrai que la biologie est de la technologie, alors il faut en conclure que la technologie n’est pas, contrairement à ce qu’on répète depuis Aristote, une invention de l’homme, mais que c’est l’homme, au contraire, qui est une invention de cette technologie initiale qu’est la vie, l’homme ne faisant, par les technologies qu’il développe, que prolonger la technologie dont il est lui-même un des résultats.
Nous ne connaissons encore qu’une toute petite partie de cette technologie. Certes, la différence entre notre actuelle connaissance du vivant et celle dont pouvaient disposer les stoïciens dans l’Antiquité, par exemple, est immense et elle peut laisser croire que nous en savons beaucoup. Mais, au milieu de nombreux autres exemples qui pourraient être cités, l’incapacité où nous sommes encore d’interpréter les résultats des expériences de stimulation cérébrale profonde prouve que nous ne savons encore que très peu de chose sur la nature de l’homme.
Pourtant, le fait d’affirmer que la biologie est de la technologie est souvent regardé comme l’expression d’une conception réductionniste de la vie par les philosophes et parfois aussi comme une provocation. Affirmer que la vie est de la technologie, remarquent, en effet, les philosophes, dire que le Dasein humain, l’être là de l’homme, est lui-même le résultat de cet assemblage technique complexe est contradictoire. Car c’est le Dasein humain qui a, de fait, inventé l’interprétation technologique du vivant. Il est nécessairement premier, puisque c’est lui qui analyse la vie et cherche à la comprendre, argumentent-ils. Il ne peut pas être le produit de cette compréhension, puisqu’il en est la cause.
Cette idée est rarement reprise ou analysée par les biologistes. Et ceci pour une raison simple : la plupart d’entre eux n’entendent pas précisément ce vocable de Dasein. Ils utilisent, à la place, des vocables plus traditionnels, comme la personne, l’homme, la conscience, l’individu, le sujet, etc. Les termes ne manquent pas pour désigner ce que les philosophes désignent, de leur côté, par le concept de Dasein. Ce faisant, les biologistes passent souvent à côté de ce que ces mêmes philosophes essayaient de leur signifier en utilisant ce terme (voir [18]). Ce que veulent dire ces derniers, c’est que l’homme a spontanément un rapport utilitaire à son environnement. Son être-là recherche autour de lui des appuis. Dès lors, affirment ces mêmes philosophes, il est toujours tentant de voir toutes choses sous ce même angle utilitaire. Lorsque cette façon de voir est appliquée au vivant, il se traduit par le préjugé selon lequel la biologie est de la technologie. Autrement dit, l’idée selon laquelle la biologie est de la technologie est renvoyée au rang d’un simple préjugé. Il ne s’agit plus d’une idée neuve qui serait le produit d’un savoir récemment acquis sur la vie, mais au contraire un préjugé très ancien, invétéré. Que ce préjugé semble ensuite se justifier par les succès auxquels conduit cette interprétation ne change rien, aux yeux du philosophe, au fait qu’il ne s’agit toujours que d’un préjugé.
L’objection peut être entendue. Elle repose sur l’idée que puisque le Dasein, l’être là de l’homme, est la condition de toute compréhension des choses, il ne saurait être lui-même considéré comme le produit de ce qui a été compris. Le Dasein ne peut que fournir des interprétations de lui-même. Il peut, à ce titre, s’interpréter comme technologie. Mais c’est là seulement une interprétation parmi d’autres. Et cette interprétation ne bénéficie d’aucun privilège parmi les façons de voir que l’homme peut développer sur lui-même.
7 Conclusion
La biologie a ouvert, au vingtième siècle, une compréhension nouvelle de la vie et il s’en est suivi une accumulation considérable de savoirs sur le vivant. Pourtant, ces savoirs ne représentent encore que très peu de choses. On estime connaître beaucoup par comparaison à ce qu’on connaissait dans le passé. Mais pour évaluer convenablement ce qu’on connaît, il faudrait établir une comparaison, non avec ce qu’on connaissait jadis, mais avec ce qui est encore à connaître. Cette dernière comparaison est évidemment impossible à effectuer. Cependant, certains indices, on l’a vu, montrent que l’ampleur de l’inconnu demeure certainement considérable. C’est cette ampleur de l’inconnu restant dans l’homme que les philosophes qui ont élaboré la notion de Dasein ont tenté de souligner.
Et c’est pourquoi leur objection – qui se concentre dans les propriétés du concept de Dasein – reste, dans son fond, valable. Elle peut être résumée de la façon suivante : l’homme peut bien devenir synthétique en s’attachant de plus en plus étroitement avec des machines diverses, il n’en augmente que très modérément sa connaissance de lui-même. Il ne fait que développer l’intuition selon laquelle sa nature est technique. Ce faisant, il ne devient donc pas un homme fondamentalement nouveau. Il est toujours guidé par une intuition philosophique. Certes, cette intuition est d’une fécondité étonnante. Elle captive et donne lieu des spéculations multiples. Mais en déduire que ce serait là les signes d’une entrée imminente de l’homme dans une ère nouvelle, les prodromes d’un « homme nouveau », ce serait s’abuser tout à fait sur les signes en question et céder à un mirage.
Le transhumanisme prospère en grande partie sur la confusion qu’il entretient entre « homme synthétique » et « homme nouveau ». Mais une analyse conceptuelle suffit à souligner la différence qui réside entre ces deux concepts. L’homme synthétique est en fait déjà là comme le montrent les nombreuses connexions que nous entretenons déjà avec des machines de toute sorte. L’homme nouveau, lui, n’est que le rêve illuminé de quelques penseurs trop pressés pour être attentifs aux objections des philosophes.
Déclaration d’intérêts
L’auteur déclare ne pas avoir de conflits d’intérêts en relation avec cet article.