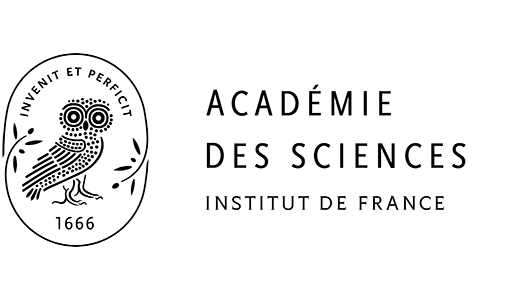Chimiothérapie ou psychothérapie ? Agirai-je au mieux par un médicament, ou par la parole ? C’est le classique dilemme thérapeutique du psychiatre. Aux âges avancés, les deux voies révèlent leurs limites : le cerveau âgé tolère mal les médicaments psychotropes, et proposer une cure psychanalytique peut sembler futile 〚1〛.
Il est communément admis qu’on n’entre pas dans la maladie mentale après 65 ans : le DSM-IV 〚2〛 ne mentionne aucune pathologie mentale spécifique du grand âge. La seule exception est celle des troubles délirants qui peuvent apparaître chez la femme avec la ménopause. Ils étaient naguère rangés dans le cadre nosologique (devenu désuet) de la psychose hallucinatoire chronique (PHC, aujourd’hui : « schizophrénie et autres troubles délirants »). Le traitement hormonal substitutif (THS) les améliore.
Ce cas mis à part, de deux choses l’une : ou la personne âgée a des antécédents de troubles psychiatriques, ou elle n’a pas d’antécédents.
Première hypothèse : la personne âgée a des antécédents de troubles mentaux, ces troubles sont chroniques ou récurrents. Paradoxalement, on a peu de données épidémiologiques sur la manière dont vieillissent les personnes atteintes de maladies psychiatriques : schizophrénie, maladie maniaco-dépressive, autisme, anorexie mentale, troubles de la personnalité. Faut-il continuer toujours le traitement (comme par exemple le lithium), diminuer les doses ? Les troubles tendent-ils à s’apaiser spontanément avec l’âge, ou l’inverse ? On n’en sait rien : on navigue à vue. C’est un des facteurs qui justifient ce qu’on appelle en anglais le community care: l’ouverture de la psychiatrie sur la communauté (par opposition à l’enfermement des malades à l’hôpital), le suivi au long cours des patients par une équipe qui n’hésite pas à se déplacer au domicile des familles.
Quand la personne âgée n’a pas d’antécédents de maladie mentale, le diagnostic d’un trouble étiqueté « psychiatrique » après 65 ans balance typiquement entre dépression et détérioration. C’est, par exemple, le cas de cette femme de 82 ans que son fils conduit aux urgences de l’hôpital, inquiet, parce qu’elle « perd la tête » (elle oublie de manger, maigrit, néglige de payer ses factures, etc.). S’il s’agit d’un état dépressif, c’est l’affaire du psychiatre, qui peut le traiter efficacement ; si c’est une démence débutante (par exemple la maladie d’Alzheimer), c’est l’affaire du neurologue, et la question du « placement » se posera un jour ou l’autre.
Le syncrétisme thérapeutique des psychiatres fait que, si le diagnostic de dépression a été posé (que la dépression soit autonome, ou symptomatique d’un état démentiel), ils peuvent être amenés à recommander l’alliance d’une chimiothérapie et d’une psychothérapie – tout en reconnaissant que la solitude et la pauvreté mettront en échec les meilleurs schémas thérapeutiques.
L’hypothèse d’une étiologie dynamique (c’est-à-dire, de l’origine psychique) des états dépressifs ou anxio-dépressifs du grand âge tombe sous le sens : il est triste d’avoir à se sentir décliner, de constater qu’on a des troubles de la mobilité, des troubles de mémoire... Certains analystes soutiennent le bien-fondé d’une intervention psychothérapeutique, individuelle ou de groupe, pour apprendre à vivre avec ces déficits. Pourtant, outre qu’on peut reprocher aux psychothérapies de « prendre du temps » à des personnes qui n’en ont plus guère, aucune méthode psychothérapeutique n’a fait la preuve de son efficacité à exorciser le découragement devant le rétrécissement existentiel, qualitatif et quantitatif, du grand âge. Les approches herméneutiques, relevant de ce qu’on appelle une « éthique narrative », en permettant aux gens, à travers un récit de leur vie, de donner une cohérence à celle-ci, semblent apporter quelque aide dans le cadre des soins palliatifs, à l’approche de la mort – mais on ne saurait qualifier de trouble psychiatrique l’angoisse de la mort que cette construction d’un récit de vie permet d’apaiser.
On notera que l’état dépressif du grand âge, pour être qualifié de trouble psychiatrique, doit être jugé anormal, ce qui est peut-être une injustice en soi ; cette impression d’injustice est tempérée par l’observation que les états dépressifs du grand âge s’accompagnent souvent de troubles délirants (par exemple, des sensations ou des idées persécutives), qui aggravent la détresse de la dépression. Cela nous renvoie vers la psychiatrie biologique et l’hypothèse d’une étiologie (au moins partiellement) somatique des troubles. Il est alors bien difficile de faire la part entre dépression et détérioration (la dépression faisant partie du cortège des signes de la démence). Les médicaments utilisés aujourd’hui (antidépresseurs ou neuroleptiques, inhibiteurs de l’acétylcholinestérase, ou simples vasodilatateurs périphériques) ont une efficacité modeste mais démontrée ; ils ont aussi des effets secondaires difficiles à gérer en situation de polymédication, ce qui est malheureusement une situation fréquente dans les pays développés, où il n’est pas exceptionnel de trouver sur la même ordonnance les trois grandes classes de médicaments psychiatriques (antidépresseurs, neuroleptiques, anxiolytiques). Aux antidépresseurs a été fait le même reproche qu’aux psychothérapies : ils agissent lentement, chez des gens qui n’ont pas le temps d’attendre. Au point que la sismothérapie a été préconisée dans la dépression grave du vieillard, parce que ses effets sont rapides. Mais prescrire une série d’électrochocs à une personne âgée qui exprime des idées de suicide, n’est-ce pas aller trop vite en besogne ?
Les suicides ne sont pas rares au quatrième âge. Certains de ces suicides sont des « suicides rationnels ». « C’est parfois un devoir pour le sage de quitter la vie », disaient les philosophes stoïciens 〚3〛. Cela renvoie aux approches psychothérapeutiques, entre autres aux psychothérapies dites existentielles. Il est finalement bien difficile de décider si un candidat au suicide doit être soigné, ou écouté.