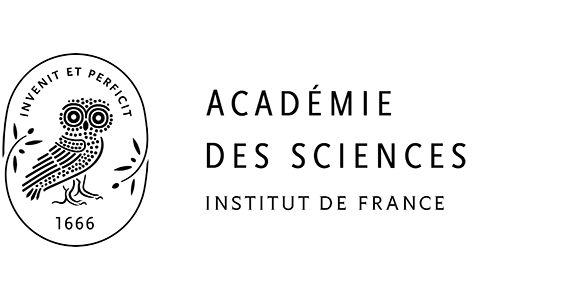Abridged English version
The year 2011 has marked the 250th anniversary of the creation of the first veterinary school in the world, that of Lyon. It has been celebrated everywhere as the World Veterinary Year and dozens of manifestations took place in the partner countries, with, as a backdrop, the tutelage of Claude Bourgelat, the founder of the first school and therefore of this new profession. However, beyond the speeches, which agreed on the vision of this man of the Enlightenment, the time is right to revisit that moment of birth of a veterinary education, breaking with centuries of practice of medicine by empirical skills.
The veterinary community has become used to link the epizootics of rinderpest, that marked the eighteenth century, with the creation of the School of Lyon. But many other important factors were, in fact, involved in the creation of this new approach to animal medicine. The development of court life in the late sixteenth century was accompanied by that of riding, a dressage involving long and difficult work with a high valued animal. The horse, this noble animal, was part of the royal majesty, a hunting companion, the actor of carousels, the accessory of a new sociability of the elite. He was no longer only cared for by the traditional marshals, but induced the interest of the equerries.
Claude Bourgelat was one of them. Directing the riding academy of Lyon, he created the first veterinary school in the world in 1761. This man had the capacity to understand and summarize the expectations of his time. Known for his skills in horsemanship and horse medicine, he was a man of connections, fully capable of understanding the issues of his day. Aware of the scope of the Physiocratic movement and the need to improve the health of animals in agriculture, he was able to understand the expectations of Henri-Léonard Bertin, minister of King Louis XV, in proposing the creation of an establishment breaking with traditional farriery. The creation of the Veterinary School of Lyon would mark a milestone: the consideration of livestock and the establishment of a new profession based on a scientific approach applied to all species. His communication skills, his European reputation and the opening of the first two schools to foreign students have ensured dissemination throughout Europe of this restored vision. This probably explains the respect that these veterinary schools retain in their creator in the world today.
1 Introduction
L’année 2011 aura marqué le 250e anniversaire de la création de la première école vétérinaire au monde, celle de Lyon. Elle a partout été célébrée comme l’Année mondiale vétérinaire et plusieurs dizaines de manifestations se sont déroulées dans les pays partenaires avec, en toile de fond, la figure tutélaire de Claude Bourgelat, le fondateur, l’Instituteur de cette première école et donc de la nouvelle profession (Fig. 1). Mais, au-delà du discours assez convenu sur la clairvoyance de cet homme du Siècle des Lumières, discours que l’on pourrait souvent qualifier d’hagiographique dans les milieux vétérinaires, le moment est propice pour revisiter cet instant clef où naquit un enseignement vétérinaire, neuf certes, mais fondé sur un long passé, souvent occulté aujourd’hui. Si les soins aux animaux étaient très anciens, la création de l’École vétérinaire de Lyon cette année là allait marquer une étape fondamentale : la prise en considération des animaux de l’agriculture et l’établissement d’un métier fondé sur une démarche scientifique appliquée à toutes les espèces. Si la communauté vétérinaire a pris l’habitude de lier de façon immédiate les épizooties successives qui ont marqué le xviiie siècle et la création de l’école de Lyon, cette vision, en partie juste, occulte néanmoins quantité de facteurs qui ont permis qu’une nouvelle conception de la médecine des animaux ne s’impose. La création de la version moderne du métier de vétérinaire est héritière d’un passé plusieurs fois millénaire dans lequel elle a puisé ses racines et ses références, et que nous évoquerons dans un premier temps. Nous envisagerons ensuite les facteurs qui ont participé, au cours des deux siècles qui ont précédé 1761, à la création d’un enseignement vétérinaire en France, dresserons un portrait rapide de Bourgelat et de son action et nous conclurons ce propos par l’évocation de la diffusion de cette vision médicale dans les pays voisins.

Portrait de Claude Bourgelat par Vincent de Montpetit. La scène a été peinte d’après nature en 1752, mais la tête a été réactualisée à Paris en 1776.
2 Une pratique très ancienne
La médecine et la chirurgie des animaux sont sans aucun doute des activités très anciennes, remontant au moins au moment de la domestication des espèces. Mais les sources exploitables à large échelle n’existent qu’à partir de l’antiquité tardive. Si des auteurs de l’âge d’or de la Grèce, tels Xénophon (445 à 354 av. J.-C.) ou Aristote (384 à 322 av. J.-C.), donnent quelques informations dans leurs œuvres en matière de soins aux animaux, et évoquent même parfois des maladies aujourd’hui identifiables, les corpus plus conséquents apparaissent avec l’empire romain et les œuvres des agronomes latins. Caton l’ancien (234 à 149 av. J.-C.) donne quelques traitements dans son De re rustica, tout comme Varron (vers 120 av. J.-C.) qui cite, dans un ouvrage du même titre, des maladies et surtout la présence, dans la Grèce antique, de vétérinaires, les medici pecorum. Le premier à utiliser le vocable veterinarius est Columelle, un agronome latin du ier siècle qui évoque dans son De re rustica la medicina veterinaria, littéralement « la médecine des bêtes de somme », bestia veterinara. Ce siècle et le suivant verront également se développer des corps de soignants des chevaux dans l’armée romaine, les mulomedici.
Mais le premier corpus thématique vraiment spécialisé est hérité d’auteurs qui vivaient dans l’Empire romain d’Orient des quatre premiers siècles de notre ère. Ils étaient hippiatres, du grec hippos, le cheval, et de iatros, le médecin, et œuvraient là où se trouvaient un grand nombre de chevaux, comme l’armée et la poste impériale, ou des animaux de grande valeur comme les chevaux de course. Cette vingtaine d’auteurs nous est connue par leurs lettres qui furent rassemblées au xe siècle dans un recueil, les Hippiatrica, une somme qui demeure encore de nos jours en enjeu d’études pour les philologues et les historiens de la médecine vétérinaire. Les plus célèbres d’entre eux ont pour noms : Apsyrtos de Pruse, un militaire qui vécut au ive siècle et produisit 121 lettres ; Pélagonius, hippiatre des écuries de course d’Arzygius à Byzance, vers 350 ; Théomnèste, militaire, vers 320 ; Chiron, du ive siècle ; Végèce, aristocrate de la fin du ive siècle qui rédigea une Mulomedicina en quatre parties qui devait marquer l’histoire de la médecine vétérinaire ; enfin Hiéroclès, un juriste du ve siècle. Ces thérapeutes du cheval recouraient à la saignée, aux purgations, à la polypharmacie, mettant en œuvre sur le cheval des moyens classiquement appliqués à l’Homme [1].
Le Moyen-Âge européen ne marqua aucune rupture avec les pratiques antiques, même si ce fut une période de profonde refonte de l’utilisation du cheval, et peu de textes nous sont parvenus sur un sujet alors assez trivial et peu digne de justifier le temps et l’énergie des copistes. Tout juste quelques textes méritent d’être cités, comme le Leech Book, en Angleterre, daté de 920, qui expose quelques traitements sommaires, la Physica d’Hildegarde de Bingen (1098 à 1179) qui recèle des recettes empiriques, des prières et des exorcismes, ou encore le De animalibus d’Albert le Grand (vers 1200–1280) qui reprit les quelques données présentes dans l’œuvre d’Aristote en leur adjoignant ses propres recettes. À côté de ces fragments disparates, quelques traités majeurs furent rédigés ; le premier est celui que Jordanus Ruffus, marescalus, c’est-à-dire responsable des écuries de l’empereur Frédéric II de Hohenstauffen (1194–1250) rédigea au xiiie siècle, le traité original le plus complet que connut le Moyen-Âge sur les soins aux chevaux. Il y décrivait un très grand nombre d’affections, essentiellement externes, visibles et abordables au premier contact de l’animal, avec des traitements pour certains très sensés et qui démontraient que l’auteur était un praticien de ces choses [2]. Des livres d’heures, des romans épiques, comme le Livre du Roi Modus et de la reine Ratio d’Henri de Ferrières (entre 1354 et 1374), et surtout des traités de chasse rendent compte au Moyen-Âge de quelques pratiques de soins d’animaux de valeur que sont le cheval, le chien et surtout le faucon. Le Livre de chasse de Gaston Phoebus (1389) recèle par exemple des informations sur les soins aux chiens. Le Phébus des deduiz de la chasse [3], qui sera publié en 1509, aborde précisément des maladies du chien comme la rage ou encore la gale. Les traités de fauconnerie, à l’image du De arte venandi cum avibus du même Frédéric II montrent l’attention dont ces rapaces pouvaient être l’objet [4].
3 La renaissance et le développement de l’équitation et de l’hippiatrie
C’est à la Renaissance que les choses devaient évoluer et préfigurer les évènements qui nous intéressent. La publication au xvie siècle, en France, de l’ouvrage de maréchalerie de Laurentius Rusius (1288–1347), un maréchal italien qui avait exercé à Rome, devait apporter dans notre pays un premier traité pratique, de grande qualité et fourmillant de détails pratiques comme, par exemple, plusieurs techniques de castration du cheval et une analyse typologique des coliques du cheval [5]. Mais, à côté de ces ouvrages d’hippiatrie pratique, la révolution vésalienne, fondée sur l’Homme, eut un effet direct sur les connaissances hippiatriques. La Fabrica que l’anatomiste André Vésale publia à Bale en 1543 amenait une double révolution. Tout d’abord, pour la première fois depuis Galien (iie siècle après J.-C.), une anatomie de l’Homme se fondait sur la dissection ; fustigeant les maîtres qui professaient du haut de leurs chaires, il tirait de ses propres dissections de nouvelles observations, dont certains montraient les erreurs de Galien, ou la dérive que les transcriptions successives et parfois indirectes avaient créées dans l’œuvre du médecin ayant exercé à Rome. Ensuite, Vésale illustrait son ouvrage de superbes planches, restées célèbres, dans lesquelles le cadavre dévoilait visuellement tous les détails de son anatomie.
Le cheval, animal de valeur, fut le premier à bénéficier de la transposition de ces connaissances de l’Homme à l’Animal. S’inspirant de ce traité, l’italien Carlo Ruini (1530–1598), sénateur de Bologne, publiait à Venise en 1598, une anatomie du cheval, l’Anatomia del Cavallo, ornée de belles planches, suivie d’un traité de pathologie moins original [6]. L’année suivante, Jean Héroard (1551–1628), médecin de formation et qui allait devenir médecin du dauphin, futur Louis XIII, publiait une Hipposteologie d’une grande précision et ornée de belles planches, aussi détaillées que réalistes [7]. Il est, à notre connaissance, le premier à avoir porté le titre de vétérinaire en France puisque des comptes du roi Charles IX le citent comme Médecin en l’art vétérinaire de la grande écurie du Roy. Ainsi s’immisçait dans ce domaine de l’anatomie du cheval des gens cultivés, d’extraction bien moins modeste que les simples maréchaux.
Ce nouvel engouement s’explique par le développement, à la même époque, de la pratique de l’équitation ; non pas l’usage chevaleresque du cheval, animal alourdi prisé pour sa vitesse et sa force de frappe, mais une utilisation toute en finesse où le cheval exécute des mouvements complexes et d’une grande beauté. Cet art du manège venait d’Italie et connut, dès la fin du xvie siècle, un grand succès dans la noblesse. La fin des guerres de religion, la sédentarisation de la noblesse, le développement de la vie de cour firent de ce passe-temps une passion et même une obligation pour les jeunes aristocrates. Au cours du xviie siècle, des académies ouvrirent leurs portes dans la plupart des villes du royaume et les jeunes nobles vinrent y apprendre les langues étrangères, le maintien, la danse, les mathématiques…, et l’équitation au contact des écuyers [8]. Servant aux entrées de villes lors des voyages princiers, accessoires valorisant la majesté royale dans quantité de tableaux et de sculptures figurant le roi, utilisés par dizaines pour la chasse ou encore les carrousels, les chevaux ne cessèrent d’accroître leur présence tout au long du xviie siècle dans les cercles de pouvoir, la taille des écuries du château de Versailles n’étant pas le moindre des artefacts de cette valeur.
Cette position d’animal de prestige du cheval en accrut la valeur financière des beaux spécimens, des animaux dressés ou aimés. Ces nouveaux professionnels, les écuyers, qui passaient tant de temps à former ces animaux et étaient souvent de fins lettrés, en vinrent naturellement à envisager les moyens de les soigner, dès lors qu’ils tombaient malades ou se blessaient. Cela conduisit à une nouvelle littérature marquée, en France, par Le parfait mareschal que publia en 1664 Jacques de Solleysel [9] et qui connut de multiples éditions. L’ouvrage était volumineux et recensait toutes les pratiques en matière d’élevage et de soins aux chevaux, en y ajoutant des considérations savantes tirées de la médecine de l’Homme, et notamment la fameuse théorie des humeurs qui, si elle était sous-jacente à la médecine du cheval depuis l’antiquité, n’avait jamais été formalisée pour cet animal. La publication de ce traité fondateur était suivie par celle de la traduction d’un traité anglais aux objectifs voisins, le Markham's masterpiece [10]. Progressivement, au xviie comme au xviiie siècle, la plupart des traités d’équitation incorporèrent des notions d’hippiatrie.
Deux catégories se trouvaient ainsi investies de cette question des soins aux chevaux : les maréchaux, praticiens depuis des temps immémoriaux et qui avaient au xviie siècle une élite exerçant aux petites écuries du Roi à Versailles ou dans les grandes villes, et les écuyers qui apportaient une culture de l’écrit et une théorisation de ces pratiques. De l’affrontement de ces deux catégories sociales allait naître, au milieu du xviiie siècle, la médecine vétérinaire moderne. Mais avant cela, d’autres évolutions allaient survenir.
Le xviiie siècle apporta bien d’autres raisons de créer le métier de vétérinaire. La vie de cour était souvent ennuyeuse et, à côté de cet Art du manège dans lequel s’affrontaient de jeunes nobles désœuvrés, la promenade à cheval ou en voiture devint un élément de la sociabilité des classes aisées. Les villes françaises connurent des modifications urbanistiques dévolues à ces pratiques, avec le développement des « cours », ces larges avenues destinées à la promenade dans des voitures tirées par des attelages faisant la fierté de leurs propriétaires. À Paris, si la place des Vosges témoigne encore de cette habitude des promenades, le cours-la-reine, qui longeait la Seine en partant des Tuileries, a aujourd’hui disparu ; il s’agissait d’une vaste avenue bordée d’arbres et comprenant un rond-point qui permettait aux attelages de se retourner [11]. Les chevaux, magnifiquement appareillés, faisaient honneur à leurs propriétaires, et quelle n’était pas la déception lorsqu’une belle paire de carossiers se trouvait désunie par la mort de l’un des deux.
Mais le xviie siècle vit aussi le développement de races d’animaux de compagnie. Petits épagneuls, bichons, petits lévriers vivaient aux côtés des hauts personnages [12], comme les tableaux des xviie et xviiie siècles le montrent ; les chats firent leur entrée dans les foyers [13], tous ces compagnons devaient être soignés, probablement par les médecins des familles.
Surtout, une épizootie de peste bovine fit de terribles ravages à partir de 1714 dans le royaume de France [14] ; les bovins mourraient en nombre et avec eux disparaissaient une source de lait, des revenus et surtout les précieuses fumures qui fertilisaient les terres destinées à la culture. Cette terrible maladie ne cessa dès lors de réapparaître de décennies en décennies, détruisant à chaque fois l’élevage bovin. Cela s’ajoutait à une situation catastrophique de l’agriculture française ; les moutons étaient par exemple mal entretenus, de tailles modestes, produisant très peu de laine, si bien que le royaume de France devait recourir à l’importation d’Espagne ou d’Angleterre. Une première doctrine économique apparut alors, nommée physiocratie, qui prônait le développement de l’agriculture pour permettre un développement démographique indispensable à l’obtention d’une main d’œuvre de qualité. Ce mouvement, initié dans les cercles les plus intimes de Louis XV, fit de la question agricole une problématique majeure. Soins aux chevaux, gestion des épidémies, comme la peste bovine ou la morve, une maladie du cheval alors très préjudiciable aux troupes de cavalerie, rationalisation des productions animales, autant d’éléments qui incitèrent Louis XV à répondre favorablement à la proposition d’un écuyer lyonnais, Claude Bourgelat (1712–1779), de créer une école vétérinaire dans cette ville.
4 Claude Bourgelat, un homme de réseaux
Claude Bourgelat était né à Lyon ; son père avait été échevin de la ville de 1706 à 1707 et cette fonction lui avait conféré la noblesse et des armes, trois perdrix sur fonds d’azur qui forment encore aujourd’hui un des quartiers des armoiries de l’École nationale vétérinaire d’Alfort [15]. On connaît peu la jeunesse de son fils Claude ; tout juste peut-on répéter à la suite de Grognier que : « Claude Bourgelat, après avoir fait d’excellentes études chez les jésuites, étudia le droit et fut reçu avocat de l’Université de Toulouse ; il suivit le barreau du Parlement de Grenoble, il s’y fit remarquer, gagna une cause injuste, rougit de son triomphe, il quitta pour toujours le métier d’avocat. Il entra dans les mousquetaires. » [16]. Où Bourgelat apprit-il l’équitation savante ? Grognier prétend qu’il suivit les cours des meilleurs maîtres d’équitation de Paris. Toujours est-il que Bourgelat obtint le 29 juillet 1740 du comte d’Armagnac, Grand écuyer de France, un brevet pour exercer la charge d’« écuyer du roi tenant l’académie d’équitation de Lyon ». Cette académie était prestigieuse par sa position dans Lyon. Claude Bourgelat occupait là, à 28 ans, une place qui le plaçait en vue. Qu’entendait-on par « académie » ? C’était, par essence, un établissement formant les jeunes nobles à leurs futures fonctions, une école des belles manières où les jeunes gentilshommes apprenaient les mathématiques, l’art de monter à cheval, à se battre, à manier l’épée, à danser et à jouer de la musique.
Bourgelat devait se faire mieux connaître en publiant des ouvrages qui connurent un grand succès. Le premier fut un traité d’équitation qui parut quatre ans après sa nomination. Ce Nouveau Newcastle fut d’abord édité en Suisse en 1744 [17], de façon anonyme, puis en France en 1747 [18], à Paris, sous le nom de Bourgelat. Ce traité fut apprécié et nul doute que Bourgelat en ait tiré un grand profit de notoriété. Puis, en 1750, Claude Bourgelat fit paraître un deuxième ouvrage qui devait le placer en vue dans le domaine de la médecine du cheval. Il s’agissait du tome premier des Elemens d’hippiatrique [19], le premier traité français dans lequel étaient abordées les connaissances indispensables à l’hippiatre, un ouvrage construit sous forme de dialogue entre un maître et son élève, une forme préfigurant l’enseignement. On y trouve la connaissance de l’extérieur du cheval, les défauts et qualités des différentes parties constituant le cheval, l’exposé des maladies qui peuvent survenir aux pieds, les critères de diagnose de l’âge du cheval et les « proportions géométrales » du cheval, un thème cher à Bourgelat qui cherchait à définir les canons de la beauté équine par des règles mathématiques. Il publia ensuite les deux volumes suivants respectivement en 1751 et 1753 ; Bourgelat y aborde l’anatomie, à l’exception notable de la région de l’abdomen et de ses viscères, avec un luxe de détails qui témoigne de l’application de l’auteur dans ce domaine de l’anatomie.
La parution des deux premiers volumes des Elemens d’hippiatrique lui avait valu son entrée comme membre correspondant à l’Académie des sciences de Paris. Il sortait dès lors du cadre étroit de la notoriété d’une ville de province pour s’exprimer au plan français. Bourgelat eut alors une participation significative à l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Le premier tome de l’Encyclopédie parut en 1751 mais Bourgelat ne signa son premier article qu’en 1755, dans le tome V, entrant ainsi dans le cercle des auteurs de l’Encyclopédie. Les 208 articles qu’il signa ne figurèrent que dans les tomes V, VI et VII, parus entre 1755 et 1757, et lui offrirent une tribune dont nous verrons par la suite comment il usa. Il garda de sa collaboration à cette somme une solide amitié avec d’Alembert.
En 1757, Claude Bourgelat fut nommé commissaire-inspecteur des haras du Lyonnais [15, p. 215]. Il devait ainsi visiter deux fois par an les étalons et les haras royaux de sa province, procéder au recensement des juments, surveiller la monte, les foires et les marchés. La fonction était bien rémunérée bien que la province soumise à l’autorité de Bourgelat pour la surveillance des haras fut l’une des plus petites de France.
Mais Bourgelat n’eut pas que ces contributions scientifiques. Il eut également des responsabilités dans le domaine de la gestion de l’écrit. Il devint censeur de la librairie de Lyon en 1759 [15, p. 227] et inspecteur l’année suivante. Le censeur était une personne à laquelle le pouvoir royal donnait la charge de lire les manuscrits et d’autoriser leur publication, ou de l’interdire si le travail renfermait des atteintes à l’autorité royale, la religion ou la morale. Bourgelat ne fut jamais très sévère. Il devint aussi inspecteur de la librairie de Lyon par l’arrêt du 20 janvier 1760 ; il devait enrayer les fraudes nombreuses qui se commettaient dans le commerce de l’imprimerie à Lyon en étant présent à l’ouverture des balles, ballots et paquets concernant les ouvrages d’imprimerie et en faisant des visites chez les libraires et les imprimeurs. De l’abondante correspondance qui reste à ce propos, il ressort que la fonction d’inspecteur de la librairie à Lyon n’était pas une sinécure et que Bourgelat s’y consacra avec zèle et dévouement. Il poussa le sens du devoir jusqu’à sévir contre ses amis [15].
5 Vers la création de la première école vétérinaire
Claude Bourgelat n’était pas le plus compétent des hippiatres mais il est certain que c’était un fin politique qui avait compris les attentes de son temps ; les propositions qu’il devait faire au Roi font la synthèse d’aspirations qu’il était à même de comprendre et d’utiliser. Homme savant, lettré inséré dans ce que nous nommerions aujourd’hui un réseau, il sut faire valoir tous les arguments cités pour amener la création d’un enseignement vétérinaire.
Habitué au dressage long et rigoureux du cheval, Bourgelat avait bien perçu le manque que constituait l’absence d’enseignement des soins aux chevaux. L’étude des maladies du cheval était très peu poussée et laissée entre les mains de gens souvent ignorants, ceux qu’on appellera les empiriques. Dès 1750, dans le discours préliminaire du premier tome de ses Elemens, il affirmait la nécessité de former des professionnels de la santé du cheval : « ceux qui se destinent à cultiver l’hippiatrique n’acquerront jamais le degré suffisant d’instruction, […] tant qu’on ne formera point d’établissement, qu’on n’ouvrira pas d’Écoles pour les instruire » [19, tome 1, p. XXIX]. Il suivait ainsi l’illustre Georges Leclerc de Buffon qui avait fait paraitre un an auparavant le quatrième tome de son œuvre encyclopédique, l’Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du cabinet du Roy, volume dans lequel il insérait la phrase justement citée comme préfigurant le développement de la médecine vétérinaire [20, pp. 256–258].
L’Encyclopédie allait ensuite lui offrir une tribune pour développer ses idées et, par quelques phrases disséminées ça et là dans des articles en principe anecdotiques, il distillait ce qui allait constituer le socle de son argumentation. Le premier credo était la nécessaire réforme des pratiques de maréchalerie et le rejet de certaines méthodes routinières et néfastes. L’exemple type en est la dessolure, une pratique ancestrale héritée de l’Antiquité et surtout un acte très fréquemment réalisé par les maréchaux, une sorte de panacée chirurgicale mise en œuvre pour de très nombreuses affections du pied du cheval. Sa réalisation si impressionnante impliquait la maîtrise du geste et une contention irréprochable d’un animal qui souffrait mille maux. Elle marquait l’esprit du commun, forçait le respect de gens peu à même de déceler dans cette maestria un acte barbare et inutile. Les soles ôtées aux chevaux martyrs étaient clouées, telles des trophées, aux portes des ateliers de maréchalerie, témoignant de la capacité du maître des lieux [21, p. 11]. C’est Genson, maréchal des écuries de la Dauphine, qui ouvrit le feu en déclarant, en 1754, dans l’article « Dessoler » du tome IV de l’Encyclopédie, que cette technique était « abusive & pernicieuse. » [22, p. 894], saillie qu’il renouvela dans son article sur le clou de rue publié en 1755 [23, p. 626]. Cela heurta ses confrères et c’est Ronden, maréchal ordinaire des écuries du roi, qui répondit à la trahison par une diatribe féroce contre ce maréchal et… Bourgelat, qui avait repris de 1755 à 1757 ce qui concernait la maréchalerie. L’article encloueure [24], précédant dans l’Encyclopédie le second écrit félon de Genson, avait été rédigé par le nouveau maître de l’hippiatrie, un sujet connexe que le maréchal aurait du traiter. Avant de démonter l’argumentaire de ses rivaux, Ronden ne manqua pas de marginaliser Bourgelat, supposé être auteur de ce Dictionnaire plus pour briller que pour apporter un éclairage de qualité sur des parties que sa condition ne lui permettait pas de connaître [25, p. 5]. Cette passe d’arme est l’une des nombreuses traces du conflit social qui couvait, cette lutte entre écuyers et maréchaux cherchant à dominer la question des soins aux animaux. Bourgelat apparaissait alors de fait comme une des figures de proue de la remise en cause des pratiques routinières.
Mais Bourgelat avait aussi conscience d’un phénomène très nouveau : le rapprochement inéluctable de l’Homme et de l’Animal. La création de l’Académie Royale des Sciences en 1666 avait induit le développement de la dissection des espèces animales et le corpus de connaissances s’accroissant, il devenait toujours plus évident qu’Homme et Animal était bâtis de la même façon et que leurs différences anatomiques ne relevaient que de variations de formes, s’inscrivant dans une continuité. L’ouverture des corps avait révélé la similitude de l’organisation du règne animal et, si l’homme s’y était taillé une situation prédominante, l’anatomie comparée menaça dès ses premiers balbutiements de le faire chuter de son piédestal. À cet égard, le Discours sur la nature des Animaux que publia Buffon dans le tome IV de son Histoire naturelle est révélateur : cherchant dans la structure la nature divine de l’Homme, il était contraint de conclure que cette étincelle ne résidait pas dans les spécificités anatomique de l’Homme mais, peut être selon lui, dans sa conscience du temps : « Ôtez à l’homme cette lumière divine, vous effacez, vous obscurcissez son être, il ne restera que l’animal ; il ignorera le passé, ne soupçonnera pas l’avenir, et ne saura même ce que c’est que le présent. » [20, p. 110]. Dans le domaine de la médecine, ces similitudes avérées étaient connues depuis longtemps et étaient abondamment utilisées. Dès l’époque romaine, et Galien pour ne citer que le plus connu des auteurs de ce temps, les animaux livraient leurs corps aux scalpels des anatomistes et médecins, l’anatomie humaine étant extrapolée des découvertes faites dans leurs entrailles. Les choses évoluèrent peu et André Vésale, pour ne citer encore une fois que le plus révolutionnaire des anatomistes de la Renaissance, pratiquait la dissection des animaux vivants pour chercher à comprendre dans cette masse palpitante la réalité de son fonctionnement. Bourgelat et ses contemporains savaient ce qu’ils devaient à ces analogies ; à cet égard le traité de Miotomie humaine et canine de René-Jacques Croissant de Garengeot [26] est révélateur de cet état d’esprit ; arguant de la facilité de se procurer des chiens, son ouvrage exposait les similitudes et différences des musculatures des deux espèces, espérant ainsi permettre d’user plus facilement du chien pour répéter des interventions ensuite destinées à l’Homme. La parenté entre l’animal et l’homme entrait dans les esprits et Bourgelat eut l’intelligence de mettre en avant l’intérêt pour l’Homme de développer la médecine vétérinaire, non seulement pour sauvegarder un cheptel précieux, mais encore pour que sa propre médecine en bénéficie. Ainsi écrivait-il, dès 1756, dans l’article Estranguillon du tome VI de l’Encyclopédie : « La science des maladies du corps humain présente à l’Hippiatrique une abondante moisson de découvertes & de richesses, nous devons les mettre à profit ; mais la Médecine ne doit pas se flatter de les posséder toutes : l’Hippiatrique cultivée à un certain point, peut à son tour devenir un trésor pour elle » [27]. Il devait réitérer plusieurs fois cette remarque dans ses écrits ultérieurs.
Les convictions de Bourgelat étaient telles qu’il commença par créer une école de maréchalerie à Lyon en 1760 [28, p. 34] avant que ses relations avec les intellectuels de son temps ne lui permirent de faire aboutir son rêve de créer une école vétérinaire. Un personnage politique eut une influence décisive dans le succès de cet homme en vue : Henri-Léonard Bertin, intendant de la généralité de Lyon de 1754 à 1757, devenu contrôleur général des finances en 1759, qu’il connut alors qu’il était en poste à Lyon. À l’origine, nous l’avons vu, Bourgelat ne s’intéressa qu’à l’espèce équine, ce qui parait normal compte tenu de sa fonction. C’est Bertin qui appuya ses idées auprès du roi en mettant en avant la pathologie et les soins aux bestiaux (bovins, ovins et caprins). Ce faisant, il donnait aux idées de Bourgelat une justification économique qui fut décisive pour son projet de création d’une école vétérinaire. In fine, le but de Bertin était essentiellement utilitaire et c’est probablement à lui seul qu’appartient l’idée de la fondation d’un enseignement ayant pour objet la médecine de toutes les espèces animales. Il soumit son idée de créer une école vétérinaire à Lamichodière, alors intendant de Lyon, dans une lettre datée du 13 juillet 1761 [29, p. 65]. On connaît la suite, l’arrêt du conseil d’État du 4 août 1761 autorisa Bourgelat à établir « à Lyon une école qui eut pour objet la connaissance et le traitement des maladies des bœufs, chevaux etc. ». Jamais, avant cette date, Bourgelat n’avait fait la moindre mention dans ses écrits des espèces bovines et ovines, quoique l’arrêt affirme, en exagérant, qui s’était « occupé depuis vingt ans de l’étude des maladies des bestiaux de toutes espèces ».
6 L’apparition du terme vétérinaire
La proposition par Bertin et Bourgelat du terme de « vétérinaire » est d’une extrême importance, un choix stratégique que notre habitude actuelle de ce vocable ne nous porte pas à apprécier pleinement. Nous avons vu comment la médecine des animaux était séparée durant l’antiquité entre le médecin des bêtes de somme, des ruminants, veterinarius, et celle de l’animal noble par excellence, le cheval, mulomedicus en latin. Au moyen âge, un terme supplémentaire devait apparaître, celui de mareschal, désignant le professionnel s’occupant de ferrer les chevaux et de les soigner quand ils sont malades ou blessés. Le terme de vétérinaire quant à lui a été repris à partir de la renaissance, lorsque la collection grecque des Hippiatrica a été traduite en latin et en français. C’est ainsi que, pour exemples, Jean Ruel lui donna le titre de Veterinaria medicina dans sa traduction latine de 1530 [30, p. 5], que Jean Massé lui donna le titre d’Art vétérinaire ou Grande maréchalerie dans sa traduction de 1563 en recourant dans le texte aux termes de la vétérinaire ou d’hippiatrie [30, p. 6]. Finalement, le terme de vétérinaire se référa à la médecine des animaux, tandis que celui d’hippiatrie en était une restriction à l’espèce chevaline. En choisissant ce terme de vétérinaire, Bourgelat en faisait un synonyme de zooïatrie, un vocable qui serait proposé ultérieurement, et marquait son allégeance au choix royal de considérer les animaux de l’agriculture, en même temps qu’il ménageait les susceptibilités de la corporation des maréchaux dont les prétentions se portaient seulement sur l’espèce équine.
7 L’ouverture de l’École de Lyon, l’échec de Limoges et la création de l’École de Paris
L’ouverture de I’École de Lyon eut lieu le 1er janvier 1762. Elle était installée dans un faubourg de Lyon, le faubourg de la Guillotière, dans les locaux très modestes d’une auberge, l’hôtellerie de l’Abondance, sur la grand-route du Midi, vers l’actuel numéro 93 de la grand-rue de la Guillotière. Le premier élève n’arriva à la nouvelle école que le 13 février ; le 27 du même mois, elle comptait cinq élèves déjà occupés à disséquer et à copier des cahiers [31, p. 13]. Ils devaient être 38 à la fin de l’année 1762, 52 en 1763, 88 en 1764, avant que la création de l’école d’Alfort ne limite cette croissance. Les conditions de recrutement étaient assez larges ; il n’y avait pas de limite d’âge et les élèves devaient simplement savoir lire et écrire. Les frais étaient généralement couverts par les provinces françaises ou les pays envoyant leurs élèves ; quelques uns, plus fortunés, s’acquittaient directement de ces frais. Ce système de bourses permis, dès le début, aux provinces de former des jeunes et de les rapatrier ensuite dans leurs terres d’origine.
L’habile promotion que Bourgelat en fit conduisit le roi à l’ériger en école royale en 1764, et à nommer Claude Bourgelat contrôleur général des écoles vétérinaires et commissaire général des haras du royaume en juin de cette année. Cette dernière fonction l’appelait à Paris et Bertin, dans une lettre du 16 mars 1765, l’invitait à former une école vétérinaire à Paris, destinée en particulier à former les professeurs devant enseigner dans les écoles que chaque généralité devait à terme avoir [32]. L’épisode de la création de cette école de Paris méritera d’être envisagé car il allait voir se déchaîner la bataille autour de cette conception élargie de la notion de médecine vétérinaire. Mais, avant d’évoquer ce point, il faut souligner que d’autres acteurs allaient s’impliquer dans ce mouvement de création des écoles françaises. Turgot, dès qu’il fut nommé intendant de la généralité de Limoges en 1761, porta ses efforts sur l’agriculture. Conscient de l’apport des savoirs vétérinaires, il envoya des élèves aux frais de son administration à la toute nouvelle école de Lyon. Le 18 février 1763, il écrivait à Bertin pour l’inviter à créer la seconde école en Limousin, arguant de ce que l’agriculture et l’élevage des bestiaux était la seule richesse de ce pays qu’il administrait. C’est là une particularité remarquable de Turgot d’avoir centré d’emblée son attention sur les ruminants, dépassant de loin le zèle résigné d’un Bourgelat qui évoquait plus les bestiaux par nécessité « politique » que par passion. La décision de créer l’école de Limoges fut décidé au « travail du Roi » du 24 novembre 1764 mais n’ouvrit effectivement ses portes qu’en février 1766. Il faut avouer que Bourgelat, déjà Inspecteur général, ne fit rien pour faciliter l’installation de cette école de province. Son esprit était probablement déjà à Paris et cette école, comme celle de Lyon, l’encombraient probablement. Il n’est à cet égard pas anodin qu’il ait demandé en 1765 le déplacement de l’école de Lyon à Paris, arguant de ce qu’elle ne survivrait pas à son départ, ce qui lui fut refusé [32] et qui se traduisit effectivement par une déshérence momentanée de l’école fondatrice. Quoi qu’il en soit, l’École de Limoges ferma ses portes en novembre 1768 [33].
Quant à l’École de Paris, sa création fut précipitée par les manœuvres de Philippe-Étienne Lafosse, le descendant d’une prestigieuse lignée de maréchaux parisiens, un jeune homme formé dans les meilleures écoles parisiennes et probablement encore plus savant que Bourgelat. Lafosse était alors soucieux de répondre au souhait du Duc de Choiseul de créer à Paris une école militaire d’hippiatrie pour les maréchaux des régiments de cavalerie. Alerté de ce projet par Bertin, Bourgelat précipita son projet en créant, en 1765, l’École royale vétérinaire de Paris, qui s’établit en 1766 à Alfort, à la confluence de la Marne et de la Seine. Il brisait le rêve de Lafosse. Le 27 décembre de la même année, Louis XV créait un « brevet de privilégié en l’art vétérinaire » aux élèves ayant accompli quatre années d’étude dans les écoles. La profession vétérinaire était née.
Le maréchal avait perdu face à l’écuyer, et son ennemi ne lui laissa jamais la possibilité d’intégrer le corps enseignant de ses écoles. Il ne put que se répandre en propos haineux dans l’ouvrage somptueux qu’il publia, le Cours d’hippiatrique (1772), semant d’innombrables notes de bas de page fustigeant l’incompétence d’un vainqueur qui, du reste, ne se donna jamais la peine de lui répondre [34]. Bourgelat mort, Lafosse poursuivit son travail de sape, profitant de la Révolution pour tenter de détruire l’École d’Alfort et de renvoyer ses élèves dans les ateliers de maréchalerie parisiens qui auraient assuré leur formation. Lafosse, techniquement plus compétent que Bourgelat, n’avait pas compris la vision novatrice de son adversaire et prônait un conservatisme qui aurait sacrifié les ruminants et ramené cette profession naissante dans les brumes de l’empirisme qui avait forgé les hippiatres.
8 La difficile insertion des vétérinaires dans les campagnes françaises
Les jeunes élèves qui fréquentèrent ces deux écoles, à leurs débuts, étaient généralement des fils de maréchaux ou de paysans, souvent très incultes, pouvant tout au plus lire et écrire. Ils devaient effectuer quatre années d’étude pour obtenir un brevet de privilégié du roi en l’art vétérinaire, le premier diplôme afférent à cette nouvelle profession. L’enseignement était dispensé par des maîtres réputés, comme Honoré Fragonard (1732–1799), Philibert Chabert (1737–1814) ou l’Abbé Rozier (1734–1793), très scolaire, en grande partie fondé sur la mémorisation de cahiers rédigés par Claude Bourgelat. Les connaissances vétérinaires étant encore dans leur enfance, notamment pour les ruminants, ces élèves furent formés sur le cheval et à l’aulne des savoirs du moment.
Ces premiers vétérinaires connurent d’extrêmes difficultés à s’implanter dans les campagnes. Les soins étaient traditionnellement dispensés par des empiriques, les maréchaux, et parfois des charlatans qui usaient de recettes empruntant à la magie ou aux rites religieux, un phénomène qui devait perdurer jusqu’au xxe siècle. Ces nouveaux professionnels, bien qu’issus du milieu rural, étaient suspects d’être peu compétents, incapables d’appliquer une médecine traditionnelle qui était l’attente des propriétaires, surtout pédants, eux qui avaient séjourné en ville. Paradoxalement, les vétérinaires, jusque dans la seconde moitié du xixe siècle, connurent de grandes difficultés pour trouver leur place. Il est vrai que le nombre de diplômés était dérisoire par rapport au nombre d’animaux à traiter et à leur dispersion sur le territoire. Ainsi, le Maine et Loire, un département d’élevage, ne comptait en 1814 que neuf vétérinaires diplômés pour plusieurs centaines d’empiriques. Et en 1868, le pays ne comportait que 2800 vétérinaires [35]. Les revenus étaient bas ; le travail difficile et obligeant à de grands déplacements. Le faible nombre de vétérinaires impliqués sur le terrain conduisit Napoléon à réformer, en 1813, l’enseignement vétérinaire et à scinder le diplôme en deux niveaux : le maréchal vétérinaire, trois années d’étude, et le médecin vétérinaire, cinq années. Le but étant d’accroître rapidement le nombre de professionnels, il créa en outre la possibilité pour certains médecins vétérinaires de former des apprentis qui devenaient des maréchaux experts diplômés, des empiriques reconnus en somme. Cela conduisit à la mise en place de véritables fabriques à empiriques, certains vétérinaires faisant commerce du diplôme. Une lutte s’organisa à partir de 1840, un moment où la concurrence entre les vétérinaires diplômés, dont la population n’avait cessé de croître, et les empiriques devint insupportable aux premiers. En 1841, ils obtenaient qu’aucun dédommagement de la mort d’un animal du fait d’une épidémie ne puisse être délivré par les pouvoirs publics si le propriétaire ne pouvait certifier qu’il avait appelé un vétérinaire diplômé au chevet des ces animaux ; cela était d’importance car cela obligeait les propriétaires à recourir à ce professionnel. Les vétérinaires autorisés à former des maréchaux experts furent recensés et les abus constatés. Surtout, en 1854, ils obtinrent que le terme vétérinaire soit attaché au diplôme. Ce combat ne devait s’achever que dans les années 1980 car il fallut attendre 1938 pour que les empiriques soient interdits d’exercice professionnel, les personnes en exercice pouvant terminer leur carrière [36].
9 La diffusion de l’enseignement vétérinaire
Plusieurs voies allaient conduire à la diffusion de cette nouvelle vision de la médecine vétérinaire. Les gouvernements européens voisins envoyèrent très vite des élèves suivre la formation française. Certains vinrent à Lyon, à l’image de Pieter Abildgaard qui créa l’école de Copenhague en 1771 [37, p. 314], d’autres à Alfort, comme par exemple l’italien Brugnone qui créa la première école étrangère, celle de Turin en 1769 [31, p. 692], certains même dans les deux écoles, comme furent formés ceux qui créèrent les écoles de Milan (1791) [31, p. 696] et d’Istanbul.
Il ne faut pas non plus oublier que ces écoles françaises étaient très nouvelles et très peu versées dans les espèces autres que le cheval, si bien que Lafosse gardait toute son aura ; de nombreux élèves passèrent donc aussi par l’atelier du célèbre hippiatre ; ainsi en est-il de ceux qui créèrent les écoles de Skara en 1775 [37, p. 314] ou de Vienne dans sa version définitive de 1777 [31, p. 694]. De la même façon, toutes les nouvelles écoles ne fondèrent pas leur activité sur une vision plurispécifique de cette médecine ; la première école de Vienne, créée en 1767 après que deux élèves jugés ineptes soient venus se former à Lyon [31, p. 694], fut d’abord une école d’hippiatrie avant qu’elle ne périclite ; celle de Madrid fondée en 1793 fut à visée militaire et portée sur le cheval.
D’autres écoles, collèges et facultés devaient être créées de façon totalement opportuniste, par des anciens élèves, français, des écoles vétérinaires françaises. Les plus connus sont probablement Charles Vial de Saint Bel, ancien élève de Lyon et d’Alfort, fondateur du Royal Veterinary College de Londres en 1792 [31, p. 697], Alexandre-François Liautard, ayant suivi son cursus à Alfort mais diplômé de Toulouse à la suite d’une sanction disciplinaire, fondateur en 1878 de l’American Veterinary College and Hospital à New-York [37, p. 316], ou encore Eugène Bergeyre, diplômé de Toulouse en 1850 et fondateur de la première institution d’enseignement vétérinaire du continent américain, celle de Mexico, en 1856 [38].
En quelques décennies, la plupart des états européens était dotée d’établissements d’enseignement vétérinaire et ces nouvelles institutions participaient elles-mêmes à la création de nouveaux établissements. Il en est ainsi, pour ne citer qu’un exemple, du Royal Veterinary College de Londres qui devait conduire à la création de l’école d’Edinburgh en 1823, elle même à l’origine de celle de Toronto en 1862 ou encore de Montréal en 1866 [37, p. 316].
10 Conclusion
Bourgelat avait fait émerger une nouvelle vision de la médecine des animaux fondée sur une formation pédagogique structurée. Si le cheval restait l’animal noble par excellence, les animaux de l’agriculture devenaient l’une des finalités de ce métier, en opposition avec les traditions hippiatriques des maréchaux. Son entregent, son sens de la communication, sa réputation européenne et l’ouverture des deux premières écoles aux élèves étrangers devaient assurer la diffusion dans toute l’Europe, et même dans les colonies, de cette vision rénovée. C’est probablement ce qui explique l’aura que ces écoles vétérinaires et leur créateur conservent dans le monde entier encore aujourd’hui.
Déclaration d’intérêt
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflits d’intérêts.