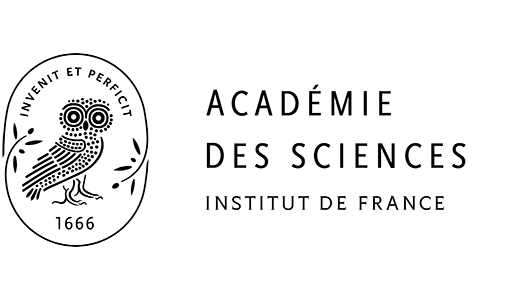Au terme de ces deux jours et demi de débats, une impression domine : l’ampleur de la révolution médicale et scientifique causée par les travaux sur les cellules souches au cours de ces dernières années. Nous vivions depuis deux siècles sur une vision relativement simple et, en quelque sorte, linéaire de l’embryogenèse et de la différenciation cellulaire. Au début de la vie se trouve l’œuf originel ; les toutes premières cellules sont totipotentielles : elles peuvent, en se différenciant, donner naissance à toutes les cellules de la centaine de tissus de l’organisme adulte ; mais, en se multipliant, elles se différencient de façon irréversible, perdant progressivement une partie de leur capacité de différenciation, et ne peuvent donner naissance qu’à un nombre de plus en plus limité de variétés de cellules, tout en perdant, parallèlement, une partie de leur potentiel de prolifération. Au terme de ce processus, on trouve des cellules fonctionnelles, différenciées, incapables de se diviser : par exemple, le globule blanc, le polynucléaire. Toutes les données sur l’embryologie, la pathologie des organes et des tissus, leur vieillissement par atrophie progressive semblaient être en faveur de ce schéma. Et voici qu’il est remis, brutalement, en question. Certes, depuis un demi-siècle, comme l’a rappelé François Jacob, on savait que, dans une certaine variété de cancers, le tératocarcinome, une seule cellule était capable, en se divisant, de donner naissance à une grande variété de tissus : on trouve, dans ces tumeurs, des dents, des poils, des cheveux. Mais cela ne surprenait pas outre mesure, car il s’agissait de cellules cancéreuses, anormales, dédifférenciées.
On connaissait, par ailleurs, l’existence des cellules souches. Par exemple, dans la moelle osseuse, environ une cellule sur 5000 est capable de se multiplier sans se différencier (du moins pendant plus d’une centaine de divisions) et donc de repeupler toute la moelle osseuse d’un organisme adulte, en étant à l’origine des différents types de cellules sanguines et lymphocytaires. De plus, les travaux effectués sur ces cellules avaient déjà permis d’étudier leurs propriétés et d’analyser les facteurs qui gouvernent de façon spécifique (par un système récepteur–ligand) la prolifération et la différenciation de chaque type de cellules. Par exemple, nous avions montré, à Villejuif, qu’il existait des facteurs agissant sur les cellules contiguës et d’autres capables de passer dans le sang et d’apporter une information, en tous les points de l’organisme, à des cellules d’un type déterminé, provoquant leur différenciation, leur multiplication ou, au contraire, arrêtant celle-ci, bref un ensemble remarquable de facteurs régissant la constance d’un tissu à l’état normal ou sa régénération après une agression. Ainsi, quelques minutes après l’irradiation de la patte d’une souris, l’ensemble des cellules souches hématopoïétiques de l’organisme réagit, en se différenciant, en migrant et en se multipliant (M. Tubiana, E. Frindel. J. Cell. Physiology. Regulation of pluripotent stem cell proliferation and differentiation 1, 13–21, 1982).
Ces études, in vivo et in vitro, avaient montré la puissance des mécanismes d’homéostasie et d’information, le rôle prépondérant de facteurs humoraux et la signification limitée de l’aspect morphologique, qui ne permet pas de distinguer les cellules souches des cellules plus différenciées ; mais elles n’avaient pas remis en cause le dogme de l’évolution irréversible vers une différenciation de plus en plus poussée des descendants des cellules souches, d’abord en progéniteurs, puis en cellules différenciées, donc l’incapacité de l’organisme à réparer les lésions liées à une pénurie en cellules souches. La transplantation d’organes semblait la seule voie permettant de remédier à ces insuffisances tissulaires. Or, elle ne peut être mise en œuvre que dans un nombre limité de situations pathologiques.
La conjonction de plusieurs découvertes est, depuis 1998, soit à peine depuis quelques années, à l’origine d’un changement de paradigme.
1. Tout d’abord, on a montré qu’au cours de la phase initiale du développement de l’embryon, les cellules gardent, ou peuvent récupérer, plus longtemps qu’on ne le pensait une capacité totipotentielle ou multipotentielle étendue et que de plus, on peut faire se multiplier ces cellules in vitro sans qu’elles perdent leur capacité de différencier vers un grand nombre de lignées. L’embryon devient une source potentielle de cellules capables de remplacer les cellules manquantes dans de nombreux tissus ou organes, puisque l’embryon humain vers 5–7 jours contient une centaine de cellules capables de proliférer in vitro et stables sur le plan chromosomique. Celles-ci sont pluripotentielles, mais, quand on les cultive, les conditions de culture peuvent provoquer et orienter la différenciation. Cependant, les facteurs spécifiques responsables de cet effet n’ont pas été identifiés. Un énorme travail reste donc nécessaire. De plus, il apparaît possible de modifier les caractères génétiques pendant la culture par des transfections, ce qui ouvre un autre champ d’investigation.
Les deux difficultés majeures que pose l’utilisation de ces cultures chez l’homme sont la possibilité de prolifération autonome, donc de cancérogenèse, après transplantation et la tolérance immunologique, car, après différenciation, ces cellules peuvent ne plus être tolérées.
Ces cellules embryonnaires sont usuellement obtenues à partir d’embryons issus de fécondation in vitro. Quand un couple recourt à ce mode de reproduction, un grand nombre d’embryons est produit, dont seuls quelques-uns sont ensuite implantés dans l’utérus maternel. Les autres sont conservés, à basse température, restant à la disposition des parents, au cas où ceux-ci souhaiteraient d’autres grossesses. Dans certains pays (par exemple le Royaume-Uni, la Suède, la Finlande), ces embryons peuvent, avec le consentement des parents, être utilisés pour des recherches spécifiques sous le contrôle d’une haute autorité. En France, la loi votée en première lecture par l’Assemblée nationale en janvier 2002 prévoit cette disposition.
2. Il existe, dans quelques tissus adultes, des cellules souches capables, dans certaines conditions, de se multiplier sans se différencier et même de se différencier vers d’autres tissus que ceux dans lesquels elles se trouvent. Ainsi, des cellules souches hématopoïétiques peuvent donner naissance à des cellules nerveuses. La limitation, progressive et que l’on croyait irréversible, du potentiel de différenciation, est, dans certains cas, vaincue sous l’influence de quantités suffisantes de certains facteurs de croissance.
La plasticité de ces cellules, c’est-à-dire leur capacité à régénérer d’autres tissus et à donner naissance à des lignées cellulaires ayant les caractéristiques du tissu dans lequel elles se fixent, est donc beaucoup plus grande qu’on ne le croyait il y a cinq ans. Néanmoins, des limitations commencent à apparaître : seule une faible proportion de cellules souches adultes semble avoir cette propriété, ce qui pourrait en limiter les possibilités d’utilisation clinique. Les recherches doivent être poursuivies pour étudier les facteurs influençant cette plasticité et les conditions de transdifférenciation. Mais il apparaît déjà que les cellules souches adultes ne pourront pas être utilisées dans toutes les situations cliniques, car leur plasticité et leur potentiel de prolifération sont limités.
Les autogreffes sont limitées par la nécessité de disposer d’un nombre suffisant de cellules souches, les hétérogreffes par l’incompatibilité immunologique. Trouver des donneurs « compatibles » est souvent difficile ; de plus, il faut administrer, pour éviter les rejets, des immunodépresseurs souvent très mal tolérés, toujours handicapant. On connaît bien ces problèmes avec les greffes de moelle.
3. En transférant le noyau d’une cellule adulte, différenciée, fonctionnelle, dans un ovocyte, on redonne à ce noyau la capacité de se diviser comme celui d’une cellule totipotentielle. La cellule ainsi formée peut donc donner naissance à tous les types de cellules présents dans un organisme, voire même à un organisme viable (la brebis Dolly), ce qui démontre la présence dans le protoplasme de l’ovocyte de facteurs capables de modifier le comportement du noyau.
Si on arrête, in vitro, la prolifération de cette lignée de cellules au stade de blastocyte, on dispose de cellules embryonnaires qui sont génétiquement et immunologiquement identiques à celles du sujet de qui provient le noyau. Elles sont donc parfaitement tolérées, comme l’ont confirmé le petit nombre d’expériences qui ont été effectuées. Celles-ci ont, en outre, montré la possibilité de modifier le génome pendant la culture ex vivo.
Cette technique nécessite l’utilisation d’ovocytes féminins, ce qui a fait craindre un commerce des ovocytes. Il faut se prémunir contre cette dérive, mais l’exposé du professeur P. Jouannet a montré la disponibilité d’un nombre d’ovocytes suffisant pour les recherches, grâce en particulier aux prélèvements sur les ovaires de pièces opératoires ou d’autopsie.
Les cellules obtenues par transfert nucléaire sont, pour l’instant, les seules qui échappent au risque de rejet immunologique. Elles donnent, par ailleurs, la possibilité d’obtenir un grand nombre de cellules provenant d’une tumeur ou d’un tissu atteint d’une maladie génétique, ce qui permettra des recherches sur les troubles biochimiques en cause et leur correction.
Ces trois catégories de cellules souches sont donc susceptibles d’être utilisées dans ce qu’on appelle la médecine régénératrice. Elles présentent des avantages et des inconvénients distincts. Préjuger des résultats de recherches à entreprendre, décider a priori que certaines sont préférables à d’autres, serait injustifié. Imaginons une escouade de Martiens arrivant sur Terre ; si on leur demandait comment, vu de Mars, se déplacent les terriens, ils répondraient : il y a quatre moyens de locomotion, la marche, la bicyclette, l’automobile et l’avion. Que penser du chef martien qui voudrait savoir lequel est le meilleur, celui qui doit être développé aux dépens de trois autres ? Nous sommes dans la même situation ; il est vraisemblable que dans chaque affection le choix du type optimal de cellule souche dépendra de nombreux facteurs, et que chacune de ces variétés aura des indications distinctes, qu’on ne pourra connaître qu’au terme de nombreuses expériences.
Chaque semaine, ou presque, depuis quatre ans, de nouvelles publications soulignent l’intérêt médical de ces divers types de cellules. Les exposés que nous venons d’entendre permettent d’espérer, dans un avenir plus ou moins lointain, des applications médicales dans quatre domaines :
- • les maladies neuro-dégénératives (maladie de Parkinson, sclérose en plaque, maladie d’Alzheimer, paraplégies d’origine virale ou traumatique, etc.) ;
- • les affections dues à un déficit cellulaire (diabète, certaines insuffisances hépatiques, déficiences immunologiques, etc.) ; si ces maladies ont été causées par un processus de destruction des cellules normales compétentes (maladies auto-immunes), il faut rechercher comment modifier les cellules injectées pour leur permettre de résister à ce processus ;
- • certains troubles de la sénescence, provoqués par l’appauvrissement des tissus en cellules souches (aplasie médullaire, etc.) ;
- • certains cancers, dont le traitement entraîne la destruction des tissus sains dans lesquels le cancer s’est développé.
C’est donc un nouvel et immense chapitre de la biologie et de la médecine qui s’ouvre. Il n’est pas étonnant que, face à ces vastes perspectives, le public soit saisi de vertige, partagé entre l’espoir de guérison de nombreuses maladies et la peur de transgression, entre le fantasme d’une jeunesse éternelle, grâce à cette régénération des tissus usés ou vieillis, et la crainte de voir l’homme devenir un « apprenti sorcier », fabriquant des « Frankenstein ». C’est à dessein que j’utilise ces deux expressions issues de la littérature du XIXe siècle pour souligner la permanence de ces réactions.
De fait, à chacune des grandes révolutions scientifiques de la médecine et de la biologie, on retrouve mêlés et opposés ces mêmes sentiments.
Au XVIe et au début du XVIIe siècles, c’est la redécouverte de l’anatomie, la dissection des cadavres qui soulève espoirs et craintes. Vésale, le père de l’anatomie moderne, arrive au sommet des honneurs, mais, un jour, au cours d’une autopsie, un muscle se contracte sous la pointe de son scalpel. Accusé d’avoir disséqué un vivant, il est traduit devant un tribunal qui, à Madrid, le condamne à mort. Mais il est le médecin personnel de Charles Quint et celui-ci le gracie en lui demandant, comme condition du pardon, un pèlerinage en Terre Sainte. Au retour de Jérusalem, Vésale périt dans un naufrage. Or, sans le renouveau de l’anatomie, il n’y aurait pas eu, quelques décennies plus tard, Harvey et la découverte de la circulation du sang, donc la naissance de la physiologie.
Au XVIIIe siècle, l’inoculation de la variole, puis la vaccination, suscitent, à nouveau, de violentes controverses. Il faut être fou, disent certains, pour introduire dans un organisme une maladie, afin de protéger contre cette maladie ; ils ne comprennent pas la grandeur des horizons qu’ouvre le succès de ce geste, perçu comme un défi au bon sens.
Au milieu du XIXe siècle, quand Semmelweis, ce génial accoucheur viennois, veut obliger ses collègues à se laver les mains avant de passer de la salle d’autopsie à celle d’accouchement, la réprobation est quasi unanime. Il n’arrive pas à vaincre leurs préjugés et, chassé de son service, il meurt misérablement dans un asile. Quelques années plus tard, Pasteur s’attaque au dogme de la génération spontanée, contre lequel s’était brisé Semmelweis. Bien qu’il se fonde sur des expériences menées avec une grande rigueur scientifique, il doit au sein même de notre Académie de médecine lutter pendant vingt ans contre ceux qui pensent que la maladie est « en soi, de soi », avant d’imposer l’antisepsie et l’asepsie.
Au XXe siècle, les progrès de la biologie moléculaire sont entourés des mêmes craintes et refus. L’introduction, dans les bactéries, d’ADN humain pour leur faire fabriquer des protéines humaines provoque un recul. Comme l’a rappelé Irving Weissman, nombreux sont alors ceux qui tentent de faire interdire cette technique. Or, celle-ci a permis de fabriquer des médicaments qui ont sauvé des centaines de milliers de vies humaines. L’utilisation de la PCR en médecine légale fut aussi d’abord vécue comme scandaleuse ; on craignait que cette possibilité d’identifier un individu, grâce à une trace de salive sur une enveloppe, ne menace les libertés individuelles ; aujourd’hui, on se réjouit de cette technique qui a permis de confondre des tueurs en série et d’innocenter des dizaines de suspects.
Ainsi, depuis quatre siècles, la peur des innovations a pris le masque tantôt de la religion, tantôt de la logique et du bon sens, tantôt de la science elle-même. Il serait donc triste que, pour la première fois dans l’histoire de la médecine, l’abord rationnel ne prédomine pas et que le mythe « Frankenstein » l’emporte sur celui de la « fontaine de jouvence ». Arrivé à ce point, je ne résiste pas au plaisir de faire une citation : « En rapprochant deux espèces qui ne sont pas faites pour aller ensemble, on pourrait créer des espèces nouvelles qui proliféreraient de façon désordonnée et envahiraient l’univers. » Cette phrase n’a pas été écrite à propos de l’ADN recombinant mais, plus de vingt siècles auparavant, par Pline l’Ancien dans son Histoire naturelle, à propos des greffes végétales que l’on commençait à réaliser dans les environ de Naples. Heureusement, les agriculteurs de Campanie continuèrent à greffer des arbres fruitiers sur des variétés sauvages.
Ceci ne signifie, bien entendu, pas que toutes les découvertes soient opportunes ou n’aient que des conséquences bénéfiques. Depuis la légende de Prométhée, nous savons que tout progrès est ambivalent ; on peut, avec le feu, se chauffer, cuisiner ou allumer un incendie. Comme le dit la Bible : « C’est avec le même airain que l’on forge la lame des glaives et le soc des charrues. » D’où l’importance de la dimension éthique de ces problèmes. Celle-ci a été longuement discutée au cours de ce colloque. C’est la responsabilité de l’homme de veiller à ce que l’on fabrique plus de charrues que d’épées, ce qui, globalement, a été généralement le cas au cours de l’histoire. Et il est heureusement plus aisé, comme l'a dit Lady O’Neil, d’empêcher quelques fous de développer le clonage reproductif, à la fois coûteux, inefficace et plein de risques pour le fœtus, que d’interdire la fabrication des armes.
Sur le plan éthique, les remarquables exposés des orateurs (Lady O’Neill, D. Pellerin, A. Fargot-Largeault) ont analysé trois questions.
1 La réification et commercialisation de tissus humains
On rejoint là les débats concernant le don d’organe pour transplantation. L’expérience de la transfusion a montré que le don volontaire et gratuit n’évite pas les risques sanitaires. On ne réduit ceux-ci que par la mise en œuvre des règles de santé publique fondées sur l’analyse de données biologiques, donc l’accroissement des connaissances.
Pour éviter les dérives commerciales il faut des règles strictes et une surveillance rigoureuse des centres de recherches. Il est compréhensible que certains malades refusent ce type de traitement, comme ceux (peu nombreux à vrai dire) qui ont refusé une transplantation rénale ou une transfusion sanguine. Mais ces refus individuels ne sauraient justifier une interdiction globale.
2 L’instrumentalisation des embryons humains
Elle fait de ceux-ci des moyens, alors qu’ils devraient avoir la dignité de personnes potentielles. Remarquons tout d’abord que le moment où l’embryon acquiert la dignité d’une personne varie selon les religions (voir l’exposé de Marianne Minkovski). On peut discuter le statut des embryons créés in vitro pour les besoins de la fécondation. La loi permet la destruction au bout de cinq ans des embryons surnuméraires inutilisés. Utiliser ces embryons, voués à la destruction, pour des recherches susceptibles de sauver la vie d’êtres humains ne paraît pas contraire à l’éthique. C’est ce qui a été reconnu par le Parlement anglais (Chambre des communes et Chambre des lords) et par l’Assemblée nationale, lors du vote, en janvier 2002, du projet de loi sur la bioéthique, sous la condition d’un consentement éclairé des parents et d’un encadrement étroit de ces recherches dans les quelques laboratoires où celles-ci seraient autorisées.
Il faut, d’ailleurs, noter qu’il serait paradoxal de s’opposer à l’utilisation de ces embryons surnuméraires pour la recherche, alors que l’on vient d’allonger le délai pendant lequel est autorisé l’interruption volontaire de grossesse.
3 Le risque de dérive vers un clonage reproductif
Ce risque ne concerne que les transferts dans l’ovocyte du noyau d’une cellule souche somatique. En effet, les premières étapes du clonage reproductif et de ce transfert (parfois improprement appelé clonage thérapeutique) sont les mêmes. Mais comme l’ont souligné les débats, il est relativement aisé d’encadrer ces recherches et d’empêcher une telle dérive. Faire un clonage reproductif nécessite des infrastructures coûteuses. Pourquoi ceux disposant des capitaux et des compétences conduiraient ces recherches dans des pays où elles sont interdites, alors qu’il existe tant de pays au monde où rien ne s’y oppose ? À la limite, il serait même plus simple pour eux de les faire sur des bateaux naviguant sur les eaux internationales. De plus, exclure ces recherches en France, sous prétexte que les interdictions prévues par la loi y seraient inopérantes, témoignerait d’un singulier manque de confiance envers l’efficacité des lois dans notre pays. Si nos législateurs pensent qu’une loi n’est respectée que lorsque le public y adhère, l’objectif devient d’expliquer la loi et sa légitimité plutôt que d’y renoncer.
En réalité l’attitude négative est fondée sur l’idée que d’autres pays effectuent ces recherches sur le transfert nucléaire et que, si celles-ci aboutissent, il sera temps alors d’autoriser cette production, de même qu’on s’est opposé à la création de lignées de cellules embryonnaires, mais qu’ayant pris conscience du handicap que cela représente pour nos chercheurs, on autorise leur importation. Une telle attitude révèle une incohérence entre les buts (faire de la France un des pays leaders dans le monde en biotechnologie) et les moyens (interdire certaines recherches, parce que la France est un pays où le respect de la loi est aléatoire).
Parmi les pays scientifiquement avancés, plusieurs autorisent ces recherches (en Europe, la Grande Bretagne, la Suède, la Finlande), mais toujours en les encadrant étroitement et en limitant le nombre de laboratoires où elles sont autorisées.
En terminant, je voudrais citer Canguilhem, un des prédécesseurs de Mme Fagot-Largeault, qui disait que la principale règle d’éthique pour un médecin est de soigner les malades et de tenter de les guérir. L’objectif fondamental, aujourd’hui, que l’on se place du point de vue éthique ou scientifique, me paraît être de rechercher comment parvenir, le plus rapidement possible, à faire bénéficier les malades, les personnes âgées, de ces immenses progrès qui se profilent dans un avenir qui, selon les efforts effectués, sera plus ou moins lointain.
Ce que nous avons appris pendant ce colloque confirme les immenses possibilités de ces techniques, mais souligne aussi les formidables difficultés qu’il faudra résoudre dans les années et les décennies à venir. Certes, d’une part, des résultats très encourageants ont été obtenus : ainsi, après une paralysie des membres inférieurs provoquée chez la souris par une infection virale, l’injection de cellules souches a montré que celles-ci étaient capables de migrer le long de la moelle épinière, de se fixer au niveau de la lésion, puis, en se multipliant et se différenciant, de rétablir la continuité fonctionnelle et de faire régresser la paralysie. Mais, dans d’autres expériences, on a observé, comme on pouvait le craindre, que des cellules souches s’autonomisent et se transforment en cellules malignes. D’innombrables problèmes se posent donc. Quels sont ces facteurs contenus dans un ovocyte qui font que le noyau d’une cellule différenciée redevient totipotentiel ? Quels sont les facteurs contenus dans un milieu conditionné qui orientent la différenciation et la prolifération ? Comment obtenir, in vitro, un nombre suffisant de cellules souches parvenues au bon niveau de différenciation et disposant d’un potentiel de prolifération et de différenciation suffisant pour redonner aux tissus secourus (foie, cœur, pancréas, poumon, système immunologique, etc.) le nombre de cellules dont il a besoin ? Comment contrôler leur évolution ? Éviter le risque de cancérisation ? Éviter que les facteurs qui ont détruit les tissus de l’organisme malade ne détruisent ces cellules transplantées ? Comment utiliser ces méthodes contre la sénescence ? Quelles sont les affections susceptibles d’être traitées ainsi et comment trouver les bons modèles animaux pour tester ces possibilités, notamment en ce qui concerne les affections neuro-dégéneratives ?
Qui pourrait prendre la terrible responsabilité, au nom de considérations éthiques, dont on vient de voir qu’elles sont discutables, et de peurs largement mythiques, de refuser de telles recherches in vitro et chez l’animal ? Comment, tout en tenant compte de ces craintes, accepter que les chercheurs français soient exclus de ces recherches, condamnés à être les spectateurs impuissants de recherches effectuées en Amérique, en Grande-Bretagne, en Hollande ou en Suède ?
Comprendre a toujours été un des besoins les plus profonds de l’esprit humain ; mais au désir de savoir s’est toujours opposée la peur du changement qu’apporte la connaissance. Seule l’éducation est capable de réduire la crainte de l’innovation, crainte qui peut être exploitée à des fins politiques, commerciales ou idéologiques. En France, ces craintes sont particulièrement fortes. Nous payons là les conséquences de l’absence de culture scientifique, en particulier en biologie, chez une grande partie des cadres français, qui ne réalisent pas l’importance de la révolution biologique que nous vivons depuis un demi-siècle et qui sous-estiment les conséquences que celle-ci aura dans tous les domaines.
Je suis de ceux qui croient profondément que, grâce à l’éducation, à l’information et à la mise en place de dispositifs appropriés de contrôle et de surveillance, ces réticences pourraient être surmontées. La communauté scientifique ne doit pas se laisser aller à taxer les uns d’imprudence, les autres de conservatisme. Nous devons tous ensemble chercher comment concilier deux impératifs moraux : d’une part, limiter la souffrance, les angoisses des futurs malades, donc ne pas laisser échapper la possibilité de traitements salvateurs et, d’autre part, éviter que la tentation des profits à venir ne mette en cause le respect de la dignité et de l’intégrité de toute personne humaine.
La médecine régénératrice a devant elle d’immenses perspectives, mais il ne faut pas dissimuler l’ampleur de la tâche ni ses difficultés : elles demanderont beaucoup de temps et d’effort. Raison de plus, aurait dit le maréchal Lyautey, pour commencer sans tarder. Cependant, les obstacles prévisibles conduisent à une autre considération éthique : ne pas donner des espoirs prématurés et illégitimes aux malades et à leurs familles. Il ne faut, ni leur cacher les difficultés, ni supprimer leur espérance. Il faut parler vrai. Il y a là un problème de communication, qui touche lui aussi à l’éthique et dont la solution est particulièrement difficile, car elle requiert un partenariat confiant entre les scientifiques, les médecins, les médias, et le public. Mais ceci est une autre histoire.