A côté de nombreux rapports au gouvernement et à bien d’autres instances, François a écrit plus d’un livre de vulgarisation au cours de sa longue carrière. Il en puisait la matière dans sa culture scientifique encyclopédique et ses innombrables relations dans le milieu de la science — et au-delà. Ceci lui permettait de resituer les grandes avancées de la biologie contemporaine dans leur contexte humain. Aucun n’est plus révélateur de sa personnalité que le dernier qu’il a publié, De la pénicilline à la génomique, sous-titré : Portraits et Rencontres. Non que le principe en soit différent des précédents : c’est toujours une histoire de la science construite par des hommes, qu’il a vécue. Mais parfois, au détour d’une page, il esquisse des traits de son propre portrait. Peut-être est-ce dû au fait que lorsque le livre fut publié, François avait passé 90 ans et se sentait autorisé à baisser un peu la garde. Ainsi (p. 50), quand il avoue son admiration pour l’acteur Harold Lloyd et le décrit avec beaucoup de justesse comme « un personnage sérieux à l’extrême, dénué de tout sens pratique et horriblement maladroit ». François se trouvait-il quelque affinité avec le grand Harold ? Ou lorsque Jacques Attali lui avoue (p. 162) qu’il n’a pas « l’esprit de consensus », au contraire de lui, François, (et que, d’un point d’interrogation, François feint de s’en étonner). Qui pourrait oublier les talents de diplomate de François ?
J’ai rejoint le laboratoire de François en 1975. Jean-Michel Louarn, mon professeur de génétique à l’Université de Toulouse, d’où je venais, m’avait recommandé à lui. Je l’ai rencontré à la fin d’un de ses cours au Collège de France et me suis présenté à lui. Il m’a dit, avec un fin sourire qui démentait ses propos : « On m’a dit beaucoup de mal de vous ! » Et il m’a donné rendez-vous à son laboratoire, à l’Institut Pasteur, pour le 24 avril suivant. Quand je suis arrivé, il y régnait une grande effervescence. Tout le laboratoire était réuni dans le bureau de François, pour sabler le champagne ! Geneviève Antolini, sa secrétaire, me prit par le bras et me confia que c’était l’anniversaire de ses 50 ans, avant de m’entrainer dans la fête. Quelle entrée en matière ! Après cet accueil plus que chaleureux, je fus présenté à Michel Jacquet, de retour des USA, qui cherchait un étudiant et m’accueillit dans son groupe naissant. Ainsi, le 1er juillet, je commençai mon travail de thèse dans le laboratoire de François.
Malgré ces commencements joyeux, je peux avouer que les débuts furent difficiles. Comme l’écrit Michel Morange à propos de François Jacob, « le passage aux eucaryotes était prématuré … Les 10 premières années de transition des procaryotes aux eucaryotes furent difficiles » [1]. Ces difficultés qui frappaient François Jacob affectaient également François Gros. Je ne crois pas que cette transition était prématurée. Manquait surtout une réflexion profonde sur les outils qui étaient nécessaires à sa réalisation, et qu’allait apporter quelques années plus tard le génie génétique. Fautes d’outils, on s’en remettait à des stratégies désespérées qui avait peu de chance d’aboutir. Il me fut confié le projet de transcrire la chromatine isolée de cellules en culture, transformées par le virus du polyome, par une polymérase exogène, et de détecter parmi les produits de transcription des séquences virales. C’était un projet à quitte ou double : le succès aurait conduit à la gloire ; mais si on échouait, on n’avait rien appris et il ne restait qu’à recommencer … jusqu’au succès. De plus, j’étais très isolé sur ce sujet. C’était une thématique nouvelle et marginale dans le laboratoire de François, qui se consacrait essentiellement à l’étude de la myogenèse, et dans une moindre mesure, à l’analyse des propriétés du ribosome. Malgré tout, je réussis un jour à détecter au compteur à scintillation un faible signal au-dessus du bruit de fond, ce qui me permit de publier les résultats [2] et de soutenir une thèse de 3e cycle [3].
Mais on ne restait jamais longtemps isolé dans le laboratoire de François, tant s’y succédaient de nombreux postdocs de toutes nationalités. Arriva bientôt du Beatson Institute à Glasgow un étonnant postdoc à l’abord chaleureux, Nabeel Affara. C’était un jeune chercheur court et rond, extraverti, originaire du Moyen-Orient par filiation mais écossais de culture, et communiste militant (ce qui devait conduire à des frictions idéologiques). Il venait pour développer des projets de cinétique d’hybridation de l’ARNm à son ADNc dans des cellules de différentes natures, dans divers états de différenciation. Cette méthodologie ingénieuse fournissait des informations globales sur l’expression génétique dans ces cellules, et obligeait à des analyses rigoureuses — toutes démarches exaltantes grâce auxquelles je commençai à renouer avec une réflexion scientifique bien ancrée. Nabeel ne tarda pas à m’entrainer dans son sillage. Il avait une capacité unique pour mobiliser des cohortes de jeunes chercheurs dans la chambre froide où, pendant de longues heures, couverts d’anoraks plus ou moins protecteurs, nous grattions d’énormes boîtes de Pétri pleines de cellules à confluence ; après centrifugation préparative, on isolait des polysomes que Nabeel qualifiait avec exubérance « d’extraoooordinaires », qui étaient la récompense de la célérité de notre travail collectif. Plusieurs publications parurent sur le sujet dans des journaux de grande notoriété [4] ; je fus co-auteur de certaines [5, 6]. Grâce à Nabeel, j’acquis un assez fort accent écossais, que je prisais fort et gardais quelques temps, ainsi qu’un vocabulaire anglais vernaculaire, à manier prudemment, mais que j’utilisais sans beaucoup de discernement.
Ce mouvement pris fin à la fin de 1978, avec le départ de Nabeel pour Glasgow et de Michel Jacquet pour l’université de Paris XI à Orsay. Simultanément, Margaret Buckingham commençait à rassembler autour d’elle une escouade de jeunes chercheurs, dont j’étais, dans la perspective d’isoler par les techniques du génie génétique désormais accessibles des ADNc et des gènes du programme myogénique. En même temps, le département ouvrait, dans les soubassements de son bâtiment, un laboratoire P2 tout à fait fonctionnel, et installait en face un ordinateur Data General (le premier de cet Institut), grâce auquel nous allions bientôt pouvoir assembler les contigs issus de nos travaux de séquençage. Début mai 1980, Adrian Minty (un postdoc de François) et moi-même réalisions la première synthèse d’un ADNc à partir d’ARN de cellules myogéniques [7], ce qui ouvrait la voie à des décennies de travaux sur la myogenèse. Mais déjà, Margaret prenait son autonomie ; François Gros, inquiet de voir la biologie se réduire à une technologie (« nous n’allons pas devenir les tâcherons du génie génétique », m’a-t-il déclaré, un jour que je lui présentais avec un enthousiasme excessif les données de séquence que je venais d’acquérir), ne s’impliquerait pas dans ce travail de génétique moléculaire, et insensiblement, nos rapports se raréfiaient. En même temps, lui qui avait toujours été extrêmement occupé (assumant la direction de son unité et celle de l’Institut Pasteur en même temps que sa chaire au Collège de France) prenait maintenant un rôle de conseiller auprès de François Mitterrand puis de son Premier ministre, et disposait de peu de temps pour des discussions à bâtons rompus. Nous gardâmes des rapports de confiance, d’estime et d’amitié. Mais je cessai de pratiquer la science au quotidien avec lui.
J’ai retrouvé François beaucoup plus tard, près de ma retraite, quand mon laboratoire ferma et que je fus logé dans le « quartier des retraités » à l’Institut Pasteur, en même temps que Didier Montarras, mon camarade de recherche de longue date chez François. Il se trouva que François disposait d’un bureau face au mien. Il y venait assez peu, préférant l’Académie des sciences, mais quand il passait, il manquait rarement de nous inviter à déjeuner, Didier et moi. C’était toujours le même rituel, depuis que je le connaissais : il sortait son petit carnet noir, avachi, écorné, retirait ses lunettes pour mieux voir et nous proposait une date. Nous avons fait ainsi le tour des restaurants agréables du quartier. Là, François parlait sans réserve de sa vie, de ses expériences passées ou récentes. Ainsi, il nous livra qu’il avait, enfant, contracté la fièvre typhoïde, et ce que cela signifiait dans les années 30, avant l’apparition des antibiotiques, ces antibiotiques auxquels il allait consacrer les premières années de sa carrière. Un jour de grande chaleur, il retira sa veste et nous confia que « dans le monde d’où il venait », un homme demandait l’autorisation de le faire s’il y avait des femmes à sa table. Ainsi, à petites touches, il nous révélait le monde quasi-proustien dans lequel s’étaient déroulées sa jeunesse, puis sa vie adulte. Il s’étonnait de nos réserves sur les progrès médicaux qu’allaient apporter les cellules souches. Non que lui fût d’un enthousiasme sans frein ; ceci n’était pas dans son tempérament. Mais il attendait de nous, « les jeunes », des stratégies audacieuses qui auraient dépassé celles qu’il élaborait lui-même.
Ce fut une période d’échanges riches et profonds, certainement la plus libre de mes relations avec François.
Déclaration d’intérêts
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leurs organismes de recherche.
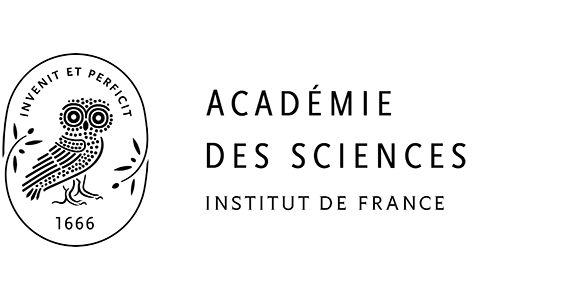



 CC-BY 4.0
CC-BY 4.0