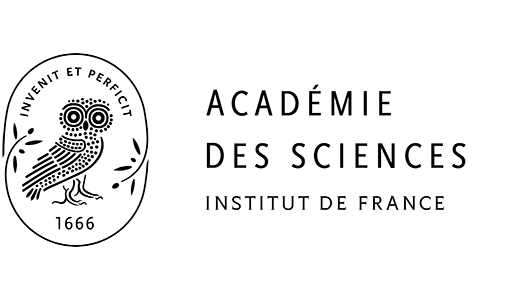Première partie
Étienne-Émile Baulieu : Merci à tous les orateurs. Je crois que cette séance a été très instructive et permet de poser des questions complémentaires auxquelles je vous appelle.
Nicole Le Douarin : J’ai une question pour Patrick Berche au sujet de la variole. Quelle est la politique en France vis-à-vis du vaccin ?
Patrick Berche : La politique du plan Biotox a pour objectif d’avoir à disposition environ 5 millions de doses, visant, dans un premier temps, à traiter les cas contacts et le personnel médical, dès l’apparition des premiers cas, afin de circonscrire le foyer initial. Il n’a pas été envisagé à ma connaissance de politique de vaccination de l’ensemble de la population, ce qui est l’option actuellement retenue aux États-Unis. Dans ce pays, l’objectif est de préparer 260 millions de doses, c’est-à-dire suffisamment de doses pour vacciner la population entière en cas d’attaque et de dissémination de la maladie.
Nicole Le Douarin : Quand a-t-on cessé de vacciner les enfants ?
Patrick Berche : En France, depuis 1985. Aux États-Unis, depuis 1972. Une inoculation induit une protection de 5 à 10 ans. Deux ou trois inoculations donnent 20 à 30 ans de protection. Les personnes vaccinées une seule fois ne sont plus protégées aujourd’hui, celles vaccinées deux fois avant 1985 pourraient être encore protégées pendant quelques années, tout au plus. Il faut garder à l’esprit qu’il y a un tribut à payer pour les vaccinés : les accidents de vaccination et certaines souches du virus de la variole peuvent entraîner des varioles mortelles chez les vaccinés.
Étienne-Émile Baulieu : M. Binder ?
Patrice Binder : Je ne vous répondrai pas sur le programme de santé publique. Je pense que le professeur Bricaire a plus d’éléments que moi. Effectivement, si la stratégie n’est certainement pas de vacciner l’ensemble de la population, il se pose de toute façon le problème de relancer la fabrication du vaccin et de la relancer dans des conditions up-to-date. Je rejoins ce que disait Henri Korn tout à l’heure à propos du contrôle : on n’a plus d’installations respectant les normes d’aujourd’hui pour fabriquer ce type de vaccin. Donc cela suppose la reconstruction d’installations, ce qui entraîne des coûts élevés, car les conditions de bonne pratique de fabrication sont exigeantes.
Étienne-Émile Baulieu : Coûts élevés, de quel ordre de grandeur ?
Patrice Binder : Aujourd’hui, je suis incapable de dire à combien reviendrait la fabrication des millions de doses qui seraient nécessaires si on devait le faire. Une étude industrielle doit, je pense, être en cours. Nous avions fait une évaluation pour le ministère de la Défense, il y a quelques années, lorsque nous avions envisagé et posé la question à des industriels ; c’était de l’ordre de 100 millions de francs uniquement pour les besoins de la défense.
Étienne-Émile Baulieu : Est-ce sous la responsabilité du ministère de la Défense que devrait se faire ce programme ?
Patrice Binder : En termes de vaccins et de médicaments, le ministère de la Défense a une politique qui est d’adopter tous les produits et médicaments qui sont agréés par le ministère de la Santé et par les autorités de santé du pays. Donc, le ministère de la Défense n’a aucunement l’intention et d’ailleurs n’a pas la capacité de mettre au point de nouveaux médicaments. En revanche, participer à un effort de mise au point de médicaments parce que nos besoins sont communs, c’est bien évident.
Pascale Cossart : J’ai une question pour Patrick Berche au sujet de la persistance du virus de la variole dans l’environnement. On a parlé des spores de Bacillus anthracis, des spores de Clostridium botulinum, de la toxine, qui étaient stables ; j’aimerais avoir un commentaire sur la persistance du virus de la variole dans l’environnement.
Patrick Berche : Le virus peut persister plusieurs semaines dans l’environnement ; la maladie peut être propagée par toutes sortes de supports inertes, telles que couvertures, mouchoirs ou linges en contact avec des varioleux. De plus, il demeure une crainte hypothétique de ré-émergence accidentelle de la variole par manipulation de cadavres morts de variole et enterrés dans le froid sibérien. On pense que le virus pourrait persister dans ces conditions. Cependant, bien qu’on puisse l’observer au microscope, il n’a pu être cultivé. Au cours de l’exhumation de restes humains de patients qui seraient morts de variole dans des cimetières de zones tempérées, le virus n’a pas pu être isolé. Donc, il y a un danger environnemental possible, surtout associé à la manipulation de cadavres morts de variole et enterrés dans les régions froides.
Pascale Cossart : Sous quelle forme les virus sont-ils transmis dans les linges ? Dans des cellules ou à l’état pur ?
Patrick Berche : Il s’agissait de virus provenant de patients qui étaient couverts de pustules, donc de virus libres et associés à des cellules cutanées.
Intervenant non identifié : Pour le Dr Popoff, en ce qui concerne le botulisme, quelle est la dose de botulisme qui peut provoquer une intoxication, sachant que c’est le produit le plus toxique ? Deuxièmement, quelle est la résistance de la toxine, dans l’eau chlorée en particulier, puisque l’on indique que, pour « s’en débarrasser », on peut surchlorer l’eau ?
Michel-Robert Popoff : La dose létale de toxine botulique est estimée entre 100 ng et 1 μg pour une personne adulte. Ce sont des estimations. Il doit y avoir certainement des variations d’individu à individu. En ce qui concerne la résistance de la toxine, il s’agit d’une protéine thermolabile, contrairement aux spores qui, quant à elles, sont thermorésistantes. Elle est thermolabile : un chauffage autour de 60–70 °C pendant 20 min suffit donc pour détruire ou inactiver la toxine. Elle est effectivement sensible aux oxydants du type chlore. On a montré avec M. Binder que des doses de 0,3 mg l–1 de chlore libre étaient suffisantes pour détruire la toxine. De ce fait, le taux de chlore dans les réseaux d’eau potable a été remonté. Le taux de 0,3 mg par litre est effectivement suffisant pour détruire la toxine botulique, à condition qu’il s’agisse de toxine purifiée. Si la toxine est administrée sous forme de complexe – ce qui est beaucoup plus facile à produire d’un point de vue bioterroriste –, il faut savoir que les surnageants de culture qui contiennent les complexes botuliques sont très riches en protéines et absorberaient une grande quantité de chlore. Il faudrait des quantités de chlore beaucoup plus importantes pour arriver à 0,3 mg l–1 de chlore libre ; c’est là, un petit peu, toute l’ambiguïté de la situation actuelle.
Étienne-Émile Baulieu : Merci. Henri Korn ?
Henri Korn : Je voudrais demander à Michèle Mock ou à Patrick Berche quelles sont aujourd’hui les manipulations génétiques plausibles, je parle de celles qui sont les plus envisageables, qui rendraient encore plus difficile la détection et éventuellement la prévention dont nous avons parlé ce matin ? Et quelles seraient les compétences nécessaires éventuelles pour ce genre de manipulation ?
Michèle Mock : En ce qui concerne Bacillus anthracis, le charbon, pour parler en termes de détection, je rappelle que j’ai parlé d’exosporium, qui est la structure la plus externe de la spore ; celle-ci porte des antigènes de surface spécifiques, qui pourraient être enlevés génétiquement sans modifier les autres propriétés connues. Donc, on ne détecterait plus les spores de Bacillus anthracis via les anticorps spécifiques. On peut aussi envisager, au niveau des marqueurs utilisés, d’avoir certains marqueurs qui ne seraient plus présents, parce que, dans le cas de Bacillus anthracis, on peut faire des manipulations génétiques assez facilement. D’où l’intérêt d’avoir des systèmes de détection qui ne soient pas forcément affichés. Il y a sûrement intérêt pour chaque pays à avoir des marqueurs qui lui sont propres et qu’il ne révèle pas s’il veut être capable de détecter l’origine du bacille. Autres dangers, dans le cas d’anthracis, pour augmenter la virulence, certains pourraient être tentés d’augmenter sa résistance aux antibiotiques, d’autres d’introduire d’autres gènes dans Bacillus anthracis. Ces manipulations nécessitent des moyens et des personnels très spécialisés.
Patrick Berche : Pour la variole, je l’ai évoqué dans mon exposé. On peut théoriquement manipuler le monkey-pox virus par exemple, en lui ajoutant certains gènes spécifiques du virus de la variole, absents dans le virus de la vaccine (il y a environ 57 gènes candidats). On pourrait ainsi obtenir un monkey-pox virus très contagieux, à la différence des souches sauvages de ce virus, très peu contagieuses naturellement. Mais on ne voit pas très bien l’intérêt de manipuler génétiquement le virus de la variole, du fait de sa dangerosité extrême. Les Russes auraient réalisé de multiples passages chez l’animal, mais on ne sait pas sur quel animal et dans quelles conditions. Enfin, le virus de la vaccine pourrait aussi être rendu dangereux en ajoutant certains gènes provenant du virus de la variole, lui conférant des propriétés nouvelles. La difficulté est l’incertitude des résultats : comment tester la contagiosité et la virulence de ces souches pour l’homme, puisqu’il n’existe aucun modèle animal pour le virus de la variole, c’est-à-dire aucun animal sensible au virus, incluant les primates. Une des rares chances qu’on ait avec ce virus, c’est qu’il n’existe pas de réservoir animal connu. En revanche, le virus monkey-pox possède des réservoirs animaux, tels que les écureuils et les singes. Ce virus peut donc être testé, mais son génome n’a pas été séquencé à ma connaissance.
Étienne-Émile Baulieu : Merci. Guy Ourisson ?
Guy Ourisson : J’ai une question pour M. Berche, une question de chimiste. Vous avez mentionné très brièvement l’existence de produits inhibiteurs. Alors on débouche sur quelque chose du genre antibiothérapie. Est-ce qu’il y a des choses précises à ce sujet ?
Patrick Berche : À ma connaissance, pour le virus smallpox, il n’existe pas d’antiviraux ayant démontré leur efficacité. En revanche, pour la vaccine, il semblerait, mais il s’agit de publications assez anciennes, que certains antiviraux, comme la Ribavirine, soient actifs. Ces molécules sont toxiques et ont pu être utilisées dans des cas de vaccine généralisée avec un certain succès. La maladie ayant disparu en 1977, on a très peu de recul sur les antiviraux actifs contre le virus de la variole. Le seul traitement de la variole dont l’efficacité semble documentée aujourd’hui est la vaccination dans les quatre jours qui suivent l’exposition au virus, pendant la phase d’incubation.
Étienne-Émile Baulieu : M. Robert Naquet ?
Robert Naquet : Il existe des modifications génétiques qui ont été faites sur le mouse-pox et qui ont entraîné des morts, alors que la maladie est généralement très bénigne ; cela a attiré l’attention il y a deux ans de comités éthiques internationaux sur ce sujet. Le deuxième point sur lequel je voudrais poser une question, c’est qu’on n’a pas parlé de réserves de botuline. Or, le botulisme est utilisé aujourd’hui en thérapeutique humaine. Donc, s’il y a des réserves de botuline dans certains endroits, est-ce qu’il serait possible d’y avoir accès et de l’utiliser à des fins bioterroristes ?
Michel-Robert Popoff : En matière de botulisme, c’est vrai que la toxine botulique est actuellement utilisée à titre thérapeutique. Il y a des laboratoires producteurs de toxine botulique pour cet usage. Il y a eu récemment une alerte concernant un achat assez important de toxine botulique. On s’est demandé si c’était véritablement à usage thérapeutique. Mais les doses qui sont dans les conditionnements à usage thérapeutique sont extrêmement faibles et sont loin de la dose mortelle. La toxine botulique est un poison très violent, comme on l’a vu, mais c’est aussi un médicament très sûr, parce que l’intervalle entre la dose thérapeutique et la dose létale est très important, au moins d’un facteur 1000. À propos des réserves de toxine botulique : oui, il y a effectivement des laboratoires qui travaillent sur le botulisme ou qui préparent la toxine botulique, mais Clostridium botulinum est une bactérie de l’environnement et on peut imaginer que des laboratoires, en prétextant des recherches épidémiologiques, d’investigation ou autres, isolent des souches de Clostridium botulinum et les utilisent à des fins bioterroristes. Cependant, isoler, conserver la souche, faire des cultures et produire la toxine sont des manipulations de bactériologie de base, qui requièrent un minimum de professionnalisme, un peu comme ce qu’on nous a exposé pour la peste.
Étienne-Émile Baulieu : M. Naquet ?
Robert Naquet : On a parlé des arbovirus. On a mentionné qu’il en existait beaucoup dans la nature et qu’il y a des risques terribles pour les soldats ou pour les chercheurs d’attraper ces maladies lorsqu’ils vont faire des recherches en Afrique ou même au pôle Nord. Est-ce qu’on prévient les militaires ou toute personne risquant d’être en contact des précautions à prendre au cas où ils devraient aller dans de tels endroits ? On sait très bien que les tiques donnent la maladie de Lime, dont on n’a pas parlé aujourd’hui ; cette maladie est quand même une maladie dangereuse.
Étienne-Émile Baulieu : M. Berche, je sais que vous pouvez répondre à ces questions, mais on va garder les considérations un peu plus transversales d’organisation pour la deuxième partie, pour répondre à M. Naquet. M. Binder ?
Patrice Binder : Effectivement, j’aborderai les questions de M. Naquet tout à l’heure dans l’exposé que je ferai. Pour ma part, j’avais deux questions : une question pour Michèle Mock à propos du charbon, sur le vaccin. Quels sont les travaux en cours sur ce vaccin ? Y a-t-il plusieurs options ? Et qu’en est-il de la vaccinothérapie, puisqu’on est dans un contexte d’usage exceptionnel ? Un petit peu comme pour la variole, ne pourrait-on pas envisager « l’usage du lendemain » ? La deuxième question est pour Michel-Robert Popoff sur le botulisme à propos d’alternatives thérapeutiques possibles au sérum antibotulique, qui pose des problèmes de fabrication. Des antiprotéases ou des inhibiteurs de l’activité elle-même de la toxine seraient-ils envisageables ?
Michèle Mock : Pour le charbon : où en est-on, à l’heure actuelle, en ce qui concerne le vaccin ? Vaccin animal ou vaccin humain ? En fait, c’est un choix à faire, puisque, si on considère que naturellement l’homme se contamine via les animaux, l’essentiel est de vacciner les animaux par le vaccin vivant. Cela permet d’une certaine façon de contrôler le charbon. Si maintenant on se place dans le contexte du bioterrorisme que l’on a vécu récemment, là, la situation est différente, et il faut envisager un vaccin humain. Celui qui existe est basé sur le PA (antigène protecteur), un composant des toxines. En termes de prévention, on l’a vu, il n’est pas très efficace, puisqu’il ne cible pas du tout l’aspect infection ou multiplication des bactéries ; à ce titre, en termes de développement, on a effectivement pu montrer (ce sont des travaux qui ont été faits au laboratoire) que, si on ajoute des spores tuées à PA, on augmente considérablement son efficacité et on arrive à des protections qui sont proches de celles que l’on observe avec le vaccin vivant. Ce dernier, en fait, apporte sans doute tous les éléments nécessaires pour contrôler à la fois l’infection et la toxémie. C’est une voie de recherche. On peut ainsi envisager d’identifier les antigènes de la spore et aussi de mieux comprendre les mécanismes de l’immunité. Cependant, à court terme, on pourrait dire qu’en cas d’urgence on pourrait adjoindre des spores tuées à PA et qu’on augmenterait beaucoup l’efficacité du vaccin. Ce sont des choix à faire. En ce qui concerne l’aspect thérapeutique, on peut penser qu’en complément des antibiotiques, on pourrait vacciner avec une préparation de PA seul. En effet, dans le cas du charbon pulmonaire, il a été montré que les spores peuvent persister longtemps au niveau du poumon. Il est possible qu’une protection contre les toxines, en complément de l’antibiothérapie, puisse suffire si la maladie devait se redéclencher. Un autre moyen serait une immunothérapie par anticorps monoclonaux. Mais, en ce qui concerne la vaccination humaine, il n’y a pas de vaccin qui marche. Jusqu’à présent, on pouvait considérer que les maladies des trieurs de laine (au départ, c’est pour eux qu’avait été conçu le vaccin) ayant disparu, on n’en avait plus besoin. Mais, si on se place dans une volonté de prévention du bioterrorisme, il faut effectivement améliorer un vaccin à usage humain.
Alain Carpentier : Je voudrais poser une question sur des chapitres qui n’ont pas été abordés, en particulier sur la peste, dont on nous a dit qu’elle était la plus pathologique. Vous avez parlé, Mme Carniel, de vaccination, et vous nous avez dit que la vaccination actuelle avait un effet protecteur de courte durée et qu’elle présentait des effets secondaires. Pouvez-vous en dire un peu plus et s’il y a eu des progrès récents réalisés ?
Élisabeth Carniel : Effectivement, les vaccins les plus efficaces sont les vaccins vivants atténués qui ont été développés à Madagascar par Girard et Robic. Ce vaccin a permis de diminuer fortement la mortalité et la morbidité observées lors de la première campagne de vaccination, où il avait fallu que l’armée intervienne avec les médecins pour que la population se laisse vacciner, c’est-à-dire que les complications secondaires en étaient tellement importantes que cela en limitait beaucoup l’utilisation. Il y a un an, quand j’ai participé à un séminaire à Toulon, une personne s’est levée dans l’assemblée et m’a dit: « Voilà, je suis de Madagascar. Mon père est mort de la peste, et moi, j’ai failli mourir de la vaccination ». Donc, en fait, on sait, de nos jours, grâce à des travaux notamment faits au laboratoire, que ce bacille a perdu un îlot de pathogénicité et qu’en fait, si on injecte ce bacille à des personnes qui ont une surcharge en fer naturelle (thalassémie, hémochromatose, anémie hémolytique), on peut provoquer une peste identique à la maladie naturelle. On voit donc clairement que ce vaccin n’est pas utilisable de nos jours. Il n’est pas envisageable de l’utiliser pour la population actuelle.
Alain Carpentier : Il faut sans doute peser les risques respectifs. Vous parlez d’un cas de complication après vaccination, mais quel est le risque réel de complications et quelle est l’efficacité réelle des vaccins aujourd’hui ?
Élisabeth Carniel : Il faut savoir que ces vaccins ne protègent pas des formes pulmonaires. En cas d’attaque bioterroriste par aérosols, ces vaccins ne seraient pas efficaces. Donc, cela limite leur utilisation. Ils ont quand même été utiles et, je suis d’accord avec vous, tant qu’on n’avait pas d’antibiotiques, il valait mieux courir les risques d’une vaccination que de mourir de la peste. Mais, de nos jours, où les antibiotiques sont efficaces, il vaut mieux recourir aux antibiotiques. Nous qui, au laboratoire, manipulons de grandes quantités de bactéries très pathogènes, nous ne sommes pas vaccinés.
Étienne-Émile Baulieu : M. Dercourt ?
Jean Dercourt : Je voudrais revenir sur la question que posait Mme Cossart, parce que je suis géologue. Peut-on songer à réactiver volontairement des formes sporulées d’organismes dangereux ? Je pense au charbon, en raison des difficultés qu’il y a eu pour purifier cette île écossaise où les Anglais avaient travaillé activement sur le bacille du charbon. Car l’idée qui pourrait germer serait de disposer de formes dormantes, qu’on laisserait dormir quand on voudrait les laisser dormir, et qu’on réactiverait durant les périodes de guerre. Vous avez cité le charbon. Y a-t-il d’autres espèces qui aient des formes pathogènes dormantes susceptibles d’être réactivées, et connaît-on les modes de réactivation ?
Michèle Mock : C’est une question intéressante, mais je voudrais revenir sur la notion de « dormance ». On dit que la spore est dormante tant qu’elle ne rencontre pas le mammifère. Mais elle n’a pas besoin d’être « réactivée ». La composition des sols peut certes influencer le temps de conservation des spores : dans certaines conditions, dans certains sols, on sait qu’elles peuvent survivre plusieurs dizaines d’années ; mais, à partir du moment où elles sont dans des conditions qui leur conviennent, la réactivation est immédiate. Telle spore, qui dormait depuis dix ans, va pénétrer dans le mammifère et, en l’espace de quelques minutes, va tout de suite entrer en germination et déclencher la maladie. Il y a certainement au cours du temps une perte de spores, qui vont tout de même se trouver détruites dans l’environnement, mais, tant que la spore est en dormance, elle est préservée et s’active de la même manière, même si elle dormait depuis dix ans.
Jean Dercourt : Il n’y a que le charbon qui ait des formes de dormance ?
Michèle Mock : Non, c’est pareil chez d’autres microorganismes sporulants. C’est ce qui permet aux spores de survivre. Dans le cas du charbon, la question intéressante est qu’on pense qu’il pourrait même y avoir un verrou qui empêcherait la spore du charbon de germer dans un environnement autre que celui du mammifère, à l’inverse d’autres Bacilli proches, par exemple les Bacilli cerei, qui sont capables d’effectuer des cycles dans l’environnement, dans les eaux. Dans le cas de la spore du charbon, on a l’impression qu’en fait, si elle se met à germer dans l’environnement, elle va être détruite, ou en tout cas ne donnera pas un cycle complet. B. anthracis possède peut-être un verrou pour la germination dans l’environnement, mais il a des récepteurs extrêmement spécifiques pour sentir le mammifère. C’est vraiment là une voie de recherche.
Intervenant non identifié : Qu’en est-il des Clostridia ?
Michel-Robert Popoff : Le déterminisme de la sporulation n’est pas bien connu chez les Clostridia. Ce sont des bactéries qui dans l’environnement sont, soit sous forme de spores quand les conditions ne sont pas favorables, soit sous forme végétative, c’est-à-dire en phase de multiplication bactérienne. Les Clostridia sont des bactéries de l’environnement. Ils participent dans l’environnement à la décomposition de la matière organique, qu’elle soit d’origine végétale ou d’origine animale. Parmi ces Clostridia, certains produisent des toxines. Le botulisme, comme les autres maladies à Clostridia, sont un accident de rencontre entre l’homme ou l’animal et ces bactéries de l’environnement.
Étienne-Émile Baulieu : Question à M. Deubel. A-t-on les éléments actuels pour faire relativement facilement le diagnostic des maladies arbovirus ?
Vincent Deubel : Je n’ai pas traité cette question, car je pensais que ce thème n’était pas à l’ordre du jour. Merci de l’avoir posée. Je pense effectivement qu’on a des moyens de faire les diagnostics des grandes pathologies et de pouvoir diagnostiquer tous les arbovirus pathogènes par inoculation de prélèvements biologiques à des souris ou à des cellules en culture. Cela prend environ une semaine. En revanche, par des moyens techniques modernes, comme la PCR, on peut identifier l’agent en moins de 24 h. Au départ, une pathologie, comme vous l’avez vu, peut correspondre à plusieurs types d’agents. Il faut donc que l’on ait une grande panoplie de sondes : il est certain que les puces à venir nous aideront beaucoup pour réaliser un diagnostic très rapide et spécifique permettant d’identifier l’agent.
Étienne-Émile Baulieu : Cela est-il encore à faire ?
Vincent Deubel : Oui, mais des travaux de recherche sont en cours.