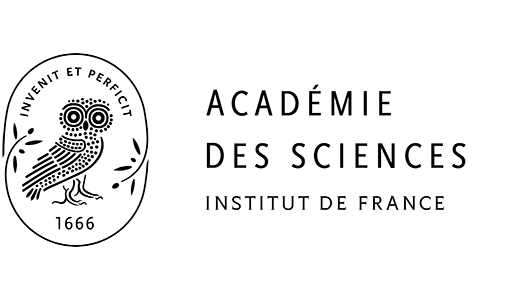Deuxième partie
Étienne-Émile Baulieu : Je remercie les orateurs pour leurs présentations, à la fois réfléchies, rapides et bien préparées. Mesdames, Messieurs, la discussion de cette seconde partie est maintenant ouverte. M. Levy ?
Jean-Paul Levy : J’ai une question très générale pour M. Bricaire et pour M. Binder. Quelles ont été les réactions des autres pays européens ?
Patrice Binder : Je n’ai pas la réponse directe.
François Bricaire : En ce qui concerne les autres pays européens, je dois reconnaître qu’il n’y a pas eu beaucoup d’actions communes et d’échanges qui nous permettent de répondre de façon satisfaisante, et c’est dommage, à votre question. Je voudrais dire simplement qu’on a eu un certain nombre de précisions, en raison de ce qui s’est passé en Allemagne. Les difficultés de diagnostic rapide pour le clinicien nous avaient amenés à réfléchir sur la question : comment aller plus vite ? On nous avait cité l’exemple des Allemands, en nous disant qu’ils avaient des techniques plus rapides pour avancer dans la détection du bacille. Avec cette technique rapide, ils ont fait une annonce un peu prématurée, qui s’est révélée fausse, et il leur a fallu « battre en arrière », ce qui est toujours très mauvais sur le plan psychologique au niveau d’une population. Peut-être Mme Mock pourra-t-elle compléter ma réponse, mais je pense que c’est à peu près le seul échange réel qui ait eu lieu. On commence maintenant à mettre en place au niveau européen des échanges entre les différents pays qui ont été concernés par l’action bioterroriste récente.
Patrice Binder : Juste pour compléter : effectivement, chaque pays a travaillé, dans l’urgence, en interministériel à l’intérieur de ses frontières. Actuellement, nous commençons à avoir des contacts avec les Britanniques et les Canadiens pour échanger l’expérience acquise. Je pense que c’est à la lumière de ce retour d’expérience qu’il faudra regarder quels sont les insuffisances et les moyens de mieux faire la prochaine fois, s’il y a une prochaine fois, ce que personne n’espère.
Étienne-Émile Baulieu : Mme Mock, vous voulez ajouter quelque chose ?
Michèle Mock : Je voulais dire que nous avions quelques contacts aussi avec les Britanniques. Il semble qu’ils n’aient pas tout à fait réagi de la même façon, à savoir que, inondés de prélèvements, ils ont fait un pré-tri de ces derniers. Ils ont fait un tri entre ce qui pouvait être vraisemblable et ce qui n’était pas vraisemblable. C’est un autre choix.
Patrice Binder : Cette question a effectivement été discutée. Il y a un problème d’afflux des échantillons ; on avait proposé de faire ce pré-tri, mais les autorités de sécurité civile nous ont expliqué qu’elles ne pouvaient pas demander aux postiers, aux policiers et aux gendarmes de faire un pré-tri : ils ne sont pas compétents pour cela.
Étienne-Émile Baulieu : M. Naquet ?
Robert Naquet : La mise en place de réseaux proposée par M. Grimont et par M. Binder est très intéressante. Vous avez mentionné les P3. On a mis en place un réseau de P3. On sait à peu près aujourd’hui quels sont les P3 libres, mais peut-on les bloquer immédiatement ? Parce que, supposez que j’aie moi un P3 qui soit plein de bactéries ou d’autre chose, est-ce que je pourrai le mettre immédiatement à disposition en cas de besoin de recherches sur le charbon ou sur autre chose ?
Patrice Binder : Je crois que je peux répondre à cette question. Effectivement, quand le plan Biotox a été élaboré, le scénario que nous avons rencontré, comme par hasard, n’était pas exactement de ceux qui avaient réellement été envisagés. En effet, le plan Biotox a d’abord été conçu pour faire face à des colis suspects multi-contaminés, que ce soit par un agent biologique, chimique ou radioactif : un faible nombre d’échantillons à traiter, mais potentiellement très dangereux. Nous sommes arrivés exactement à la situation inverse : des allégations très nombreuses et une faible probabilité de contamination par un agent connu... tout en devant considérer comme étant possiblement contaminés les lettres, colis et envois adressés aux laboratoires. Cela a mobilisé, dans un premier temps, les deux laboratoires militaires qui, dans le plan Biotox, constituent ce que Patrick Grimont décrivait comme des centres de concentration, ce que j’appelle quant à moi « le premier échelon ». Premier échelon : on fait un tri, on regarde, c’est dangereux ou non, et ensuite on envoie dans les laboratoires d’analyse plus spécialisés. Ces laboratoires ont été très vite saturés. C’est là que l’on se rend compte des limites de la méthode, car ces laboratoires de recherche ont bloqué toute leur activité, alors qu’il s’agissait seulement de leur confier une mission annexe et occasionnelle. J’imagine que c’est le même problème qui s’est présenté dans les neuf autres laboratoires civils qui ont été très vite désignés par le ministère de la Santé pour prendre en charge, par zones de défense, ces prélèvements. Aujourd’hui, il faut que la réflexion aille vers la définition de structures dédiées, qui fonctionneraient essentiellement pour des entraînements et qui seraient activables à côté de structures existantes. Alors, combien en faut-il ? Comment faut-il les construire ? Avec qui faut-il les armer ? Ça, c’est un autre problème. Ce qui est certain, c’est que dès l’instant où l’on est submergé par un grand nombre d’échantillons, un grand nombre d’analyses à faire, on ne peut plus faire appel à des structures existantes.
Étienne-Émile Baulieu : M. Blaudin de Thé ?
Guy Blaudin de Thé : Colonel Binder, vous êtes responsable du service « Recherches » du service de santé des Armées. Pouvez-vous nous dire quelles sont, en dehors des priorités que vous avez définies (recueil des données, des stocks et coordination des actions), vos priorités de recherche dans vos propres laboratoires et en collaboration avec les laboratoires de recherche publics ?
Patrice Binder : Tout ce qui a été dit fait partie des priorités de recherche. En matière d’agents, ce sont rigoureusement ceux qui ont été décrits dans la première partie, donc je n’y reviendrai pas. La priorité placée dans les vaccins est nettement moindre chez nous que chez certains de nos partenaires. C’est une option que nous avons prise, compte tenu de nos possibilités et de nos capacités de recherche, par rapport aux recherches sur les traitements, en particulier les traitements antiviraux, qui sont considérés comme prioritaires. Nous n’avons pas la même politique que les Anglo-Saxons concernant la prévention larga manu par la vaccination contre les agents des armes biologiques. Nous avons à cet égard une politique plus conservatrice, plus prudente : des vaccins, oui, mais des vaccins plutôt dans une option de vaccinothérapie. D’autres priorités concernent des recherches sur les poly-infections, parce qu’on peut se poser la question suivante : si un acte de bioterrorisme survenait au milieu d’une épidémie de grippe, aurait-on le même nombre de malades ou verrait-on celui-ci augmenter dramatiquement ? Cela peut être évoqué pour d’autres infections. En somme, nos priorités sont les suivantes : thérapeutiques, diagnostic rapide, recueil de données. Concernant les agents infectieux, ceux qui ont été évoqués sont pertinents.
Étienne-Émile Baulieu : Jean Rosa ?
Jean Rosa : Quels sont les dispositions légales quant aux prélèvements sur des individus ? Autrement dit, si quelqu’un refuse d’être prélevé, la loi permet-elle de passer outre à la notion éthique de l’inviolabilité de la personne humaine, ou pas ?
François Bricaire : Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question, parce qu’au point de vue légal, je ne sais pas. Comme je vous l’ai montré, je dirai d’abord que l’essentiel est de faire un diagnostic sur la source. Donc, cela ne nécessite pas un prélèvement humain et, à partir de là, je dirai que dans le contexte d’une action bioterroriste, les prélèvements deviennent relativement annexes et n’ont d’autre but que de confirmer une notion clinique. En ce qui concerne le charbon, j’ai même montré que, finalement, on ne tenait pas à faire des prélèvements au niveau de la porte d’entrée, qui est la narine, car ce prélèvement présente un certain nombre d’inconvénients. Je m’excuse : je suis conscient de ne pouvoir répondre parfaitement à votre question.
Jean Rosa : Je veux juste aller un peu plus loin. Et si quelqu’un refuse d’être vacciné ou d’être soumis à un traitement préventif ? Je parle, par exemple, d’un terroriste suicidaire, qui ne veut pas que l’on diminue la virulence du germe dont il est porteur. Est-ce que la loi permet de l’obliger à se faire prélever, à se vacciner ou à se traiter ?
Intervenant non identifié : Autrefois, certains vaccins étaient décrétés obligatoires. Maintenant, il n’y a plus de vaccin obligatoire. On se contente de les conseiller.
Étienne-Émile Baulieu : Vous voulez dire que parmi les nouveaux vaccins que l’on fait, aucun n’est obligatoire et ne sera obligatoire ?
Même intervenant non identifié : Je pense que dans la mentalité actuelle, il devient difficile de rendre obligatoire une thérapeutique, même préventive, dans une société qui porte plainte dès qu’il y a un effet secondaire qui pose problème. Il faudrait responsabiliser une partie au moins de la population.
Étienne-Émile Baulieu : Ou de la classe politique ?
Même intervenant non identifié : En période terroriste, qui peut être assimilée à une période de guerre, la loi prévoit de passer outre, mais j’avoue que je ne sais pas vraiment.
Étienne-Émile Baulieu : Sur cette question toujours, Henri Korn ?
Henri Korn : J’avais évoqué très rapidement, au début de cette séance, le fait qu’il y ait toute une série de problèmes législatifs nouveaux, qui vont être évoqués, par exemple, au cours de nos réflexions au Conseil scientifique de la défense ou lors de réunions publiques. Il y a eu toute une journée consacrée à ce sujet, lors de laquelle plusieurs d’entre vous étaient présents. Il y a la question que vient de poser Jean Rosa, il y en a une autre qui a été évoquée très brièvement par un orateur, quand il parlait des risques que pouvaient comporter certains vaccins et la possibilité, à ce moment-là, de se retourner contre l’État. Il y a toute une réflexion à faire, dont je ne peux que souligner l’urgence, parce que, une fois de plus, on va se poser la question quand il sera trop tard ou quand on aura le couteau sous la gorge. Binder voudrait dire un mot là-dessus.
Patrice Binder : Je crois que c’est un problème très important, qui a été au cœur du débat sur les fameux « syndromes de la guerre du Golfe ». Comment autoriser l’usage de produits, de médicaments qui n’ont pas reçu encore les autorisations de mise sur le marché 〚AMM〛 ? Je fais référence à l’exemple de la pyridostigmine. La mise en œuvre du plan Biotox a apporté un plus significatif à cet égard, dans la mesure où les fiches thérapeutiques qui ont été écrites par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSPS) permettent de déroger quelque peu à un emploi qui n’est pas strictement dans la ligne de ce qui est prévu dans les AMM pour faire face à des situations d’exception. C’est extrêmement important pour nous, au ministère de la Défense. Qu’est-ce qui s’est passé avec la pyridostigmine ? On nous a reproché 〚aux armées〛 d’avoir utilisé de la pyridostigmine dans des conditions opérationnelles pour prévenir des risques d’intoxication chimique et, en quelque sorte, de l’avoir fait hors AMM. De ce fait, on aurait peut-être intoxiqué des personnes avec un médicament qui, par ailleurs, est utilisé largement en thérapeutique !!! Aujourd’hui, l’établissement de fiches, en concertation avec les autorités de santé publique, devrait permettre de simplifier les démarches et d’accroître la transparence pour des autorisations d’usage exceptionnel en situation de crise. De toute façon, obtenir une AMM pour faire face à des intoxications par produit chimique de guerre risque de se heurter à d’importantes difficultés, les circonstances d’applications étant très particulières. Donc, je pense que la coopération qui s’est installée entre le ministère de la Défense et le ministère de la Santé pour l’établissement de fiches thérapeutiques est un progrès significatif, qui répond en partie aux problèmes posés par les autorisations légales.
Jean Rosa : À l’heure actuelle, les dispositions du Code de la santé publique (articles 601 et 602) ne sont pas adaptées, nous le savons très bien, et, compte tenu du sacro-saint principe de précaution qui risque de tout bloquer, je crois qu’il conviendrait d’insister et de ne pas se contenter de la politique de l’autruche que représente quand même un petit peu le système de fiches que Binder vient d’évoquer.
Patrice Binder : Très franchement, ce n’est qu’un pis-aller.
Alain Carpentier : Il y a une manière de répondre à Jean Rosa. Dans la pratique médicale actuelle que vivent quotidiennement médecins et chirurgiens, il n’est pas question d’imposer quoi que ce soit à quiconque. Par exemple, le dépistage du virus du sida, même pour la protection des personnels, est impossible sans l’autorisation du malade lui-même. Donc, selon les dispositions actuelles, rien ne permet d’imposer à quelqu’un un dépistage et, a fortiori, une thérapeutique préventive. Peut-être faudrait-il changer cela dans le cas de menaces terroristes où l’intérêt général doit l’emporter sur la préférence individuelle. C’est une décision politique. En revanche je voudrais poser une question scientifique à M. Grimont. Il nous a dit qu’il était devenu très facile d’identifier un agent pathogène. Je cite, de mémoire : « Je peux vous identifier quelque chose même qui n’existe pas ou qui n’a pas été identifié auparavant, même une bactérie inconnue, et ce en l’espace de quelques heures ». Mais regardez ce qui s’est passé aux États-Unis. Deux mois après l’envoi des premières enveloppes, on vient tout juste de savoir que le germe en cause venait d’un laboratoire américain ! Alors comment expliquez-vous cela, ce retard considérable pris à l’identification de ce germe aux États-Unis ?
Patrick Grimont : Oui, je l’explique par le fait que les laboratoires ont utilisé des méthodes bactériologiques classiques. S’ils n’avaient aucune connaissance du bacille du charbon, ils ont tourné en rond, ils l’ont refilé à un autre laboratoire, qui a fait pareil.
Intervenant non identifié : Mais non !
Patrick Grimont : Comment ?
Même intervenant non identifié : Ils n’ont simplement pas dit la vérité tout de suite !
Patrick Grimont : Ça, c’est autre chose !
Alain Carpentier : Mme Mock veut réagir.
Michèle Mock : Je pense qu’ils n’ont pas eu de problème d’identification. Ils ont tout de suite dit que c’était du charbon. Ensuite savoir d’où venait la souche, comment elle avait été fabriquée, ça, c’est une autre histoire.
Alain Carpentier : C’est ma question : l’identification de la souche et donc son origine.
Michèle Mock : Précisément, ça ne peut pas être fait en direct très rapidement. Même si on a une technique de première identification moléculaire rapide, je crois que ça dépasse largement cette question. Cela relève d’un génotypage moléculaire élaboré et maîtrisé par peu de laboratoires.
Alain Carpentier : Deuxième question plus ou moins liée à la précédente : admettons que demain les mêmes menaces bioterroristes se présentent... En avons-nous tiré les leçons ? J’étais aux États-Unis à l’époque. J’ai vécu la panique invraisemblable qui a saisi le peuple américain. Tout le monde voulait faire analyser, qui des enveloppes, qui des paquets, qui des locaux ou autres systèmes de ventilation. On nous a dit qu’on pouvait faire des diagnostics rapides, mais si, du jour au lendemain, vous aviez un afflux considérable de demandes, comment serait géré le problème ?
Patrick Grimont : C’est ce dont on doit discuter. C’est la question de savoir comment rendre mobilisables pas mal de laboratoires et de gens. C’est sûr que c’est la saturation qui bloque tout le système. Vous pouvez avoir les meilleures méthodes qui soient ou des PCR qui rapidement identifient le bacille du charbon, s’il y a trop de prélèvements qui arrivent et pas assez de personnes pour faire le boulot... tout se bloque.
Alain Carpentier : Voilà sans doute une recommandation à faire aux différents organismes responsables : organiser la réponse à ce genre de situation. Mme Carniel ?
Élisabeth Carniel : Juste une chose pour le diagnostic rapide de la peste, dont je n’ai pas parlé du tout. Il y a un test qui a été développé entre les Instituts Pasteur de Madagascar et de Paris : c’est une bandelette qu’on trempe dans l’échantillon et dont on a le résultat en quelques minutes. Donc là il, on n’a plus le problème de l’engorgement d’échantillons.
Intervenant non identifié : Je voulais savoir si la mise en œuvre de menaces bioterroristes crédibles relève de la très haute technologie ou, au contraire, de technologies peut-être extrêmement frustes. Si elles sont accessibles à des États ou éventuellement à des groupes, voire à des individus ? Ma deuxième question est de savoir si la littérature scientifique générale peut contribuer à la diffusion de la menace bioterroriste et de connaître ce que doit faire la communauté scientifique pour éventuellement freiner cette diffusion. Ma troisième question concerne les équipements : y a-t-il des machines, voire des logiciels, qui permettraient effectivement à des groupes ou à des États de préparer des menaces bioterroristes ?
Étienne-Émile Baulieu : Alors, messieurs ?
François Bricaire : Je peux peut-être intervenir sur la diffusion de l’information. Vous avez tout à fait raison de souligner que le fait de diffuser les informations sur Internet ou dans des revues scientifiques pourrait constituer une aide considérable pour les bioterroristes s’ils manquaient d’imagination. C’est pour cela qu’il ne faut pas que dans nos écrits nous indiquions les idées qui pourraient nous venir pour faire telle ou telle construction génétique ou pour « améliorer » un agent déjà très dangereux Donc, je suis d’accord avec vous, il faut absolument trouver des moyens, en particulier freiner la diffusion sur Internet. Mais je sais que le gouvernement américain se penche sur cette question. Peut-être même faudrait-il empêcher l’accès, par exemple, au gène du virus de la variole. Il y a deux ou trois jours, en prévision de cette conférence, je suis allé regarder sur Internet : tout est disponible, on peut recopier des virus séquencés jusqu’ici, ce qui me semble extrêmement dangereux.
Étienne-Émile Baulieu : Claude Hélène ?
Claude Hélène : On a beaucoup parlé des bactéries et des virus, qui avaient déjà un potentiel toxique important. On a peu parlé, ou pas du tout, de virus respiratoires du type RSV ou, pourquoi pas, la grippe. Je veux dire : quels sont les dangers qu’il y aurait à avoir des virus de ce type-là, manipulés relativement simplement pour y introduire une toxine, et quel est l’état actuel de la réflexion ?
Intervenant non identifié : Ce genre de manipulation se ferait d’abord sur des animaux de laboratoire, avec des tests qui ne correspondent pas forcément à ce qu’on peut trouver chez l’homme. Un virus virulent pour le singe ou pour la souris n’est pas forcément un virus virulent pour l’homme. Donc, il faudrait encore que les bioterroristes testent la virulence de ces nouvelles souches sur des hommes.
Étienne-Émile Baulieu : Guy Ourisson ?
Guy Ourisson : Depuis ce matin, nous avons à plusieurs reprises entendu parler de la dangerosité de la vaccination antivariolique. Comme il n’y a pas beaucoup d’adolescents parmi nous, je suppose que nous sommes tous à 100 % vaccinés. On ne nous a pas demandé notre avis et cela a été fait quasiment à la naissance, et ensuite à l’école. Quel est vraiment le danger ?
Intervenant non identifié : Je crois que je peux répondre. Cela fait à peu près deux encéphalites pour 100 000 vaccinations. Quelque chose comme cela.
Étienne-Émile Baulieu : Chez l’adulte ou chez l’enfant ?
Même intervenant non identifié : J’ai calculé pour 60 millions de Français, 60 morts environ d’encéphalite vaccinale. Le risque est de un sur un million.
Alain Carpentier : Avant de terminer, j’ai une question pour M. Levy. Il y a quelques semaines, j’ai lu dans le Lancet que les États-Unis entreprennent des études avec le vaccin antivariolique classique, mais dilué, pour voir s’il conserve des effets vaccinaux suffisants avec des effets nocifs moindres. Qui peut nous éclairer un peu là-dessus ?
Patrick Berche : Ce que je sais, c’est qu’ils essaient de l’utiliser à faibles doses, à dilution du dixième environ, avec l’idée que, comme dans le cas de la variolisation, le faible inoculum va induire une immunité cellulaire ainsi qu’une protection et va produire moins d’effets toxiques. De plus, le fait que les stocks soient anciens est peut-être un bien, parce qu’on sait que les vaccins à la limite de la péremption ou au-delà sont moins dangereux en terme d’encéphalite.
Étienne-Émile Baulieu : Vous voulez dire un mot ?
Michel Rey : Je connais un petit peu ce problème, parce que j’ai contribué à la suppression de la vaccination antivariolique en France. Je voudrais rappeler que si l’on a eu une campagne efficace d’éradication de la variole dans le monde, c’est à cause de l’incitation des Américains. Ils avaient fait le calcul des effets secondaires et de ce que cela leur coûtait en dollars. Ils ont lancé en 1967 cette campagne de vaccination, non pas par motivation philanthropique pour débarrasser les pays en voie de développement de cette maladie, mais pour arrêter la vaccination aux États-Unis. La question que je me pose est : comment vont-ils gérer les effets secondaires d’une vaccination de masse de la population américaine après avoir été les incitateurs de la suppression de cette vaccination dans le monde ?
Étienne-Émile Baulieu : On restera sur cette interrogation. Nous vous remercions d’avoir assisté à cette séance. Nous essaierons de publier à la fois les textes et les questions, ce qui sera très utile pour l’information de nos concitoyens.