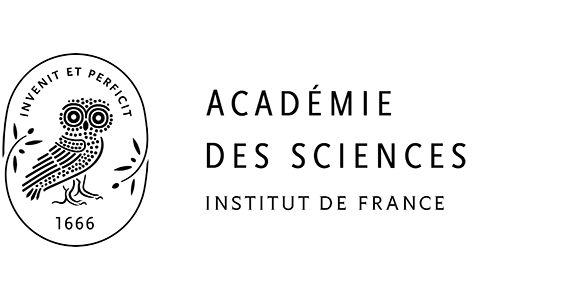1 Introduction
La peste est une zoonose affectant les petits mammifères, essentiellement les rongeurs. Sans aucune intervention humaine, la maladie évolue sous la forme d'enzootie rythmée par des épizooties dans des foyers naturels qui sont généralement bien répertoriés, mais qui peuvent toutefois s'étendre [1].
Cette caractéristique ainsi que l'importance du nombre et des espèces jouant le rôle de réservoirs fait que la maladie peut être contrôlée, mais nullement éradiquée [2]. La peste est ainsi endémique dans de nombreux pays d'Afrique, dans l'ex-Union soviétique, dans de nombreuses régions des continents Américain et Asiatique.
Aujourd'hui, la répartition de la peste coïncide avec ses foyers géographiques naturels (Fig. 1).

Distribution mondiale de la peste animale et humaine en 1998.
Le bacille de la peste (Yersinia pestis) peut également infecter l'homme et se transmettre de l'animal à l'homme par l'intermédiaire de vecteurs, c'est-à-dire d'insectes hématophages infectés (notamment certaines espèces de puces). Cette transmission se fait par contact direct, soit par inhalation, soit, plus rarement, par ingestion de matières infectieuses [3].
Chez l'homme, la peste est une maladie d'une extrême gravité, qui peut se manifester sous trois formes cliniques : bubonique, septicémique et pulmonaire. En l'absence de traitement, et donc pour les périodes historiques, les taux de létalité sont très élevés (de 30 à 70% dans la forme bubonique et de l'ordre de 100% dans la forme pulmonaire) [4].
L'isolement et la caractérisation de Y. pestis par les méthodes bactériologiques traditionnelles demandent, en pratique, de 10 à 15 jours et nécessitent des infrastructures qui sont absentes sur de nombreux terrains d'intervention.
Dans le but de réduire la létalité ainsi que de limiter la diffusion de la maladie, un test de diagnostic rapide (RDT) de la peste a été développé par les instituts Pasteur de Madagascar et de Paris et a été évalué sur le terrain dans plusieurs pays africains. Ce test permet de détecter, par immunochromatographie, l'antigène F1 spécifique de Y. pestis jusqu'à un seuil de 0,5 ng/ml en 15 min [5].
Depuis 2004, le RDT peste a été utilisé pour la détection de l'antigène F1 de Y. pestis dans les restes humains anciens. Cette recherche avait pour but d'utiliser cette nouvelle technique d'identification afin d'établir plus facilement et plus systématiquement un diagnostic rétrospectif de l'infection pesteuse [6,7]. Quatre sites archéologiques du Sud-Est de la France ont été retenus dans le cadre de cette recherche. Ces séries ostéo-archéologiques sont issues de trois sites des Bouches-du-Rhône, le cimetière des Fédons à Lambesc (1590), le charnier du couvent des capucins à Martigues (1720–1721) et la fosse de l'Observance à Marseille (1722). Comme en témoignent les archives historiques, ils constituent tous trois des sites d'inhumations mis en place en urgence, lors d'épidémies de peste (Fig. 2).

Squelettes de victimes de la peste exhumés du site de Martigues (couvent des capucins de Ferrières).
En ce qui concerne le quatrième site, dit de la « butte aux Herbes » (Draguignan, Var), ni les sources historiques, ni les documents d'archives ne nous ont aidés à cadrer chronologiquement la mortalité de ces individus avec un contexte épidémique. Au départ, seule la présence de chaux au contact direct des squelettes nous a fait retenir l'hypothèse d'une volonté de faire disparaître au plus vite les cadavres ; nous avons donc soupçonné un décès dû à une maladie infectieuse.
2 Matériels
Le matériel que nous avons utilisé est représenté par les os et/ou les dents de 18 individus adultes et subadultes provenant des sites d'inhumations précédemment cités :
- • épidémie de 1590 à Lambesc, Bouches-du-Rhône (cimetière des Fédons, échantillons testés : FED SP 56 US 199, FED SP 79 US 283, FED SP 87 US 318) [8] ;
- • épidémie de 1649–1650 à Draguignan, Var (la « butte aux Herbes », échantillons testés : VRAC1, VRAC1∗, VRAC1∗∗, VRAC2, VRAC2∗∗) [9] ;
- • épidémie de 1720–1721 à Martigues, Bouches-du-Rhône (tranchées du couvent des capucins de Ferrières, échantillons testés : RAY 1001, RAY 1003, RAY 1004, RAY 1007, RAY 1012, RAY 1013, RAY 1021, RAY 1028) [10] ;
- • rechute épidémique du printemps 1722 à Marseille, Bouches-du-Rhône (fosse de l'Observance, échantillons testés : OBS 22, OBS 61) [11,12].
Par ailleurs, les os et les dents de 18 individus adultes et adolescents provenant de l'église des Cordeliers de Briançon ont été utilisés comme témoins négatifs. Ces inhumations sont contemporaines de la fin du Moyen Âge et du début de l'époque Moderne. Sur ce site, à aucun moment, la documentation historique ou la lecture des faits archéologiques n'a pu laisser supposer un décès de ces individus dans le cadre d'une crise démographique, et notamment pas dans un contexte d'épidémie de peste.
3 Méthodes
3.1 Le test de diagnostic rapide de la peste
Il s'agit d'un test immuno-chromatographique qui utilise deux anticorps monoclonaux anti-F1 de Yersinia pestis (Mab B18-1 et Mab G6-18) qui ont été produits à l'institut Pasteur. La ligne de contrôle est constituée par IgG de chèvre anti-souris affinité-purifié.
Les tests par bandelettes utilisés au cours de cette recherche ont été produits et fournis par l'institut Pasteur de Madagascar avec deux fioles d'antigène F1 purifié de Y. pestis.
3.2 Lecture des résultats
Après une durée de 10 à 15 min suivant l'application du test, la lecture des résultats est possible. Si le résultat est positif, deux lignes roses apparaissent sur la bandelette (au-dessus la ligne de contrôle et au-dessous la ligne F1 positive). Si le résultat est négatif, seule la ligne supérieure de contrôle apparaît.
3.3 Prélèvements des tissus anciens
La spongieuse de l'os et la pulpe dentaire ancienne ont été utilisées comme sources potentielles d'antigène F1. Des études préalablement publiées ont démontré que des résultats satisfaisants peuvent être obtenus en utilisant les deux types de tissus [13–16].
Pour l'application du RDT peste sur l'os ancien, nous avons utilisé de la partie spongieuse. L'ablation de la corticale se fait en utilisant des pointes de fraise (Kavo Intramatic Lux 2) montées sur un micromoteur qui tourne à 9000 tours/min.
Le prélèvement de la spongieuse se fait manuellement, moyennant une curette. Pour chaque échantillon testé, 50 mg de spongieuse ont été prélevés, puis broyés en une fine poudre.
Pour l'application du RDT peste sur la pulpe dentaire ancienne, nous avons utilisé le même protocole, simplement précédé par les phases suivantes de décontamination du matériel : lavage avec une solution de NaOCl 50%, lavage à l'eau bidistillée, séchage avec des compresses stériles, exposition sous un rayonnement ultraviolet durant 30 min sur chaque face.
Les incisions des dents ont été pratiquées sur toute la longueur de la dent en regard de la pulpe, sans jamais l'atteindre, et en utilisant des disques en carborundum mono-usage (Separatori extra sottili flessibili non inquinanti per ceramica, Reddish Stone, Italie), montés sur pièce à main par l'intermédiaire d'un mandrin stérile.
La pulpe a été récupérée, en condition de stérilité, en utilisant des pointes de fraise Meisinger (no 012, 014, 016, Meisinger, Neuss, Germany) montées sur un micromoteur (Dremel MultiPro, 125 W) qui tourne à 10 000 tours/min dans des tubes Eppendorf stériles de 2 ml. En moyenne, 7,5 mg de poudre par dent d'adulte et 13 mg de poudre par dent de subadulte ont été récupérés [17].
3.4 Tests préliminaires
Le test de diagnostic rapide est un test qualitatif indiquant la présence ou l'absence de l'antigène F1. Vingt microlitres de solution mère de antigène F1 ([AgF1] = 2,5 μg/ml) ont été reconstitués en 180 μl de solution physiologique stérile.
Des dilutions successives de l'antigène F1 (, , , , , ) de la suspension de la spongieuse d'os et de la pulpe dentaire ancienne ont été faites pour déterminer la dilution limite susceptible donner un signal visible dans chaque échantillon. Ainsi, la quantité d'Ag F1 initialement présente dans chaque échantillon ancien testé a été extrapolée.
Au préalable, des quantités décroissantes (3, 1,5 et 0,75 μl) de AgF1 ont été soumises au protocole pour la préparation des échantillons (série de trois cycles de congélation/décongélation, sonication, congélation/décongélation, incubation, centrifugation), dans le but de vérifier si l'Ag F1 supportait ces séries de manipulation sans se dénaturer. La lecture des résultats s'est faite après 15 min.
Un second contrôle a été effectué en prenant trois échantillons de poudre d'os négative (échantillon utilisé : Talus A, 50 mg de poudre pour chaque fiole) et en rajoutant des quantités décroissantes (3, 1,5 et 0,75 microlitres) de l'AgF1 purifié. Ainsi, le matériel a été traité selon le protocole et le surnageant a été utilisé pour faire le test.
Cela nous a permis d'obtenir un échantillon « positif » ancien en vérifiant, parallèlement, que l'AgF1 n'avait pas été dénaturé pendant la manipulation et qu'aucune substance présente provenant du sédiment entourant la sépulture n'avait causé d'inhibition de la réaction. La lecture des résultats s'est faite après 15 min.
3.5 Protocole
Cinquante milligrammes de spongieuse ont été reconstitués dans 200 μl de solution physiologique stérile (NaCl 0,9%, pH = 4,5–7), soumis à trois cycles successifs de lyse par congélation en azote liquide et décongélation en eau bouillante, passés aux ultrasons pendant 15 min et enfin soumis à un quatrième cycle de congélation/décongélation.
Les suspensions ont été laissées durant 24 h environ à une température de 4 °C, puis centrifugées à 5000 rpm pendant 15 min à température ambiante. Le surnageant a été utilisé pour l'application du test.
Le même protocole appliqué sur l'os ancien a été utilisé pour l'application du RDT peste sur la pulpe dentaire ancienne.
Les tests effectués sur l'os et la pulpe dentaire ont été répétés à cinq reprises pour chaque échantillon testé, afin de garantir la reproductibilité des résultats obtenus ; la lecture des résultats s'est faite systématiquement après 15 min.
4 Résultats et discussion
Les résultats issus de notre recherche confirment l'identification de l'antigène F1 de Yersinia pestis, au moyen du test de diagnostic rapide de la peste, dans les restes humains anciens de douze individus (67%) exhumés de nos quatre sites archéologiques [17]. Dans ces échantillons, les concentrations détectées de l'antigène F1 étaient comprises entre 5 et 0,625 ng/ml (Tableau 1).
Numéro de référence des échantillons testés, les résultats du test de diagnostic rapide de la peste appliqué sur la spongieuse de l'os et sur la pulpe dentaire et les concentrations d'antigène F1 détectées. FED = Fédons (Lambesc), VRAC = la « butte aux Herbes» (Draguignan), RAY = couvent des capucins de Ferrières (Martigues), OBS = fosse de l'Observance (Marseille) ; / = os ou dents non disponibles ; ? = résultat douteux ; [AgF1] = concentrations de l'antigène F1 exprimées en ng/ml dans les échantillons testés
| Échantillons | RDT os | [AgF1] os | RDT dents | [AgF1] os |
| FED SP56 US199 | négatif | absent | négatif | absent |
| FED SP79 US283 | positif | 0,625 ng/ml | positif | 2,5–1,25 ng/ml |
| FED SP87 US318 | positif | 0,625 ng/ml | positif | 0,625 ng/ml |
| VRAC 1 | positif | 2,5–1,25 ng/ml | / | / |
| VRAC 1∗ | positif | 2,5 ng/ml | / | / |
| VRAC 2 | positif | 2,5–1,25 ng/ml | / | / |
| VRAC 1∗∗ | / | / | positif | 1,25–0,625 ng/ml |
| VRAC 2∗∗ | / | / | négatif | absent |
| RAY 1001 | ? | 0,625–0,312 ng/ml | négatif | absent |
| RAY 1003 | positif | 0,625 ng/ml | ? | 0,625–0,312 ng/ml |
| RAY 1004 | ? | 0,625–0,312 ng/ml | négatif | absent |
| RAY 1007 | positif | 1,25–0,625 ng/ml | négatif | absent |
| RAY 1012 | positif | 1,25–0,625 ng/ml | négatif | absent |
| RAY 1013 | positif | 0,625 ng/ml | négatif | absent |
| RAY 1021 | ? | 0,625–0,312 ng/ml | négatif | absent |
| RAY 1028 | ? | 0,625–0,312 ng/ml | négatif | absent |
| OBS 22 | positif | 0,625 ng/ml | positif | 0,625 ng/ml |
| OBS 61 | positif | 0,625 ng/ml | positif | 5–2,5 ng/ml |
Quatre individus sur 18 (22%) ont donné un résultat douteux à la détection de l'antigène F1 du bacille de Yersin. Nous avons choisi d'interpréter ces résultats comme non positifs, étant donné que la concentration d'antigène F1 détectée était légèrement inférieure au seuil de détection du test (concentrations comprises entre 0,625 et 0,3125 ng/ml, valeur moyenne approximative de 0,48 ng/ml).
Deux individus sur 18 (11%) étaient négatifs à la détection de l'antigène F1 du bacille pesteux. Pour finir, 100% des échantillons utilisés comme témoins négatifs ont confirmé leur négativité vis-à-vis de l'antigène de la peste.
Nous soulignons, à ce propos, que nous avons remarqué, chez les immatures comme chez les adultes testés, des différences de concentrations de l'AgF1 de Yersinia pestis au niveau de la spongieuse d'os et de la pulpe dentaire ancienne.
Nous avons détecté, chez les immatures (FED SP56, FED SP79, FED SP87, OBS 22, OBS 61) des concentrations d'AgF1 du bacille pesteux plus marquées par rapport à celles détectées au niveau de la spongieuse du même individu, à l'inverse des individus adultes, chez lesquels nous avons trouvé des concentrations plus marquées de Ag F1 au niveau de la spongieuse de l'os et des concentrations plus réduites, voir absentes, au niveau de la pulpe ancienne.
Nous interprétons ces différents résultats en fonction des modifications structurales de l'organe pulpo-dentinaire, qui sont âge-dépendantes et entraînent un affaiblissement de son potentiel physiologique [18]. Compte tenu de la réduction progressive des dimensions de la chambre pulpaire et, en même temps, de la disparition progressive du réseau capillaire périphérique, nous expliquons les différences de concentrations de l'AgF1 que nous avons détectées au niveau de la pulpe dentaire des immatures et des adultes. Les différences de concentration de l'antigène F1 au niveau de la spongieuse d'os chez les sujets en croissance et les adultes peuvent s'expliquer par une minéralisation moins importante des ossements des immatures et, par conséquent, par une moins bonne conservation des pièces osseuses [19].
Comme nous l'avons dit précédemment, le seuil de détection du test, chez le vivant, est de 0,5 ng/ml et les concentrations de l'antigène F1 détectées dans les échantillons que nous avons testés étaient comprises entre 5 ng/ml et 0,625 ng/ml. Cela signifie que le seuil de 0,5 ng/ml du RDT peste est suffisant pour garantir une première diagnose de l'infection pesteuse, même sur les restes humains anciens, et témoigne de la grande sensibilité et de la spécificité du test.
Dans un souci de confrontation des méthodes disponibles et de validation de nos résultats, nous avons souhaité comparer nos résultats avec ceux obtenus lors d'autres études et sur la base de techniques différentes. Ainsi, pour deux sites retenus lors de notre approche (le cimetière des Fédons et la fosse de l'Observance), le contexte d'épidémie de peste, largement mis en évidence par les archives historiques et les faits archéologiques, a également été confirmé par PCR [13].
Plus spécifiquement, pour deux individus, l'échantillon FED SP 87 des Fédons et le OBS 61 de l'Observance, les résultats que nous avons obtenus au moyen du test de diagnostic rapide de la peste coïncident avec les résultats positifs acquis par PCR [13].
L'identification de la nature pesteuse de l'infection dans les sujets exhumés du site de Martigues a eu lieu, en aveugle, en utilisant deux techniques différentes (RDT peste et « PCR suicide ») dans deux laboratoires distincts, l'un en Italie et l'autre en France [20]. Il en est de même pour le site de Draguignan (Fig. 3).

Résultats du test de diagnostic rapide de la peste (RDT) appliqué sur la spongieuse de l'os de trois échantillons et sur la pulpe dentaire d'un échantillon provenant du site de Draguignan (la « butte aux Herbes») : de gauche à droite, positivités des échantillons VRAC1, VRAC1∗, VRAC2 (os) et VRAC1∗∗ (pulpe) à l'antigène F1 de Yersinia pestis.
Les résultats obtenus sur le site de Draguignan apparaissent particulièrement intéressants, car les documents d'archives ne nous permettaient pas de cadrer chronologiquement ces inhumations avec un contexte épidémique. Seuls les faits archéologiques le laissaient soupçonner (inhumations multiples et simultanées, présence de chaux au contact des squelettes et pièces de monnaies du milieu du XVIIe siècle).
La double confirmation de la cause du décès, d'une part par la détection de l'antigène F1 spécifique de Yersinia pestis au moyen de l'RDT peste et, d'autre part, par l'identification de fragments spécifiques de l'ADN de Yersinia pestis, permet de poser un diagnostic de certitude sur l'étiologie d'une maladie qui fait l'objet de nombreuses controverses parmi les chercheurs et selon les périodes considérées [21,22].
Bien que plusieurs auteurs aient identifié des fragments d'aADN de Y. pestis dans les restes humains anciens de sujets décédés pendant les première et seconde pandémies [13,14,16,20,23], d'autres soutiennent que l'étiologie de l'agent pathogène responsable de ces grandes épidémies du passé demeure encore insuffisamment démontrée, à cause d'un manque de reproductibilité des résultats [21,22].
Dans le cas de Y. pestis, à partir de l'analyse de la pulpe dentaire, l'équipe des Profs D. Raoult et M. Drancourt, de la faculté de médecine de Marseille, a non seulement pu identifier, sur des sujets décédés durant les première et seconde pandémies, des fragments de aADN (gènes pla et gplD) de Y. pestis, mais est également parvenue à en isoler le biotype, en l'occurrence le biotype Orientalis [13,14,20,23].
À l'inverse, les équipes des Profs M.B. Prentice, T. Gilbert et A. Cooper n'ont pas réussi cette mise en évidence. Les études conduites par T. Gilbert et al. sur 108 dents appartenant à 61 victimes exhumées de cinq sites de pestiférés du Nord de l'Europe n'ont pas permis d'amplification de fragments de l'aADN spécifique de Y. pestis [21,22,24].
Les discordances entre les résultats positifs obtenus par M. Drancourt et son équipe et les résultats négatifs auxquels sont parvenus T. Gilbert et al. peuvent avoir deux origines. D'une part, il est possible que la négativité des résultats de l'équipe anglaise soit due à des difficultés de conservation de l'aADN de Yersinia pestis, elles-mêmes liées à un contexte taphonomique moins favorable sous des latitudes plus septentrionales. Il convient toutefois de noter que cette hypothèse a souvent été évoquée, sans jamais être réellement vérifiée.
D'autre part, il est envisageable que cette absence de résultat soit due au choix du matériel retenu pour étude, c'est-à-dire l'utilisation d'un mélange de dentine et de pulpe dentaire. Effectivement, selon M. Drancourt [25], la pulpe, tissu mou bien vascularisé, est un matériel tout à fait approprié pour ce type de recherche. Il a été ainsi démontré que des pathogènes viables (Coxiella burnetii) peuvent être détectés dans la pulpe dentaire d'animaux infectés au laboratoire, alors qu'ils sont en phase septicémique. En revanche, il n'y a pas de travaux similaires disponibles à partir de l'étude de la dentine.
Pour finir, il convient de rappeler ici que certains auteurs envisagent l'hypothèse selon laquelle un pathogène autre que Y. pestis a pu être à l'origine de la « mort noire » [22,25].
Pour autant, l'amplification de fragments d'aADN du bacille de Yersin est une technique qui s'avère reproductible, comme le montrent les travaux d'I. Wiechmann et de G. Grupe. Cette équipe allemande a mis en évidence la présence de Yersinia pestis à partir de l'étude de la pulpe dentaire de squelettes retrouvés dans une sépulture bavaroise du VIe siècle, c'est-à-dire contemporaine de la première pandémie pesteuse [16].
5 Conclusions
La validation d'un nouvel outil diagnostique tel que le test de diagnostic rapide de la peste pour la détection de l'infection pesteuse sur des restes anciens revêt une importance non négligeable, notamment lorsque les données archéologiques et les sources historiques sont lacunaires, voir absentes.
Étant donné que cette méthode a un faible coût par rapport à celui des techniques de biologie moléculaire, on peut envisager de l'utiliser quasiment en routine sur la totalité des individus exhumés d'un site, ou tout du moins sur l'ensemble des structures funéraires (différentes fosses à inhumations multiples) qui peuvent être présentes sur une nécropole et qui bien souvent posent de nombreuses questions.
Par ailleurs, comme nous l'avons montré précédemment, la détection antigénique de Yersinia pestis dans les échantillons que nous avons testés vient confirmer les résultats obtenus par PCR. Cette confirmation constitue une des réponses possibles à la demande de plus en plus fréquente de nombreux collègues archéoanthropologues et microbiologistes, dont le souhait est que l'obtention d'un résultat positif soit le fruit d'un travail réalisé en aveugle (double-blind studies) par deux laboratoires sur un même échantillon, et ce avec des techniques similaires, ou, au contraire, sur la base d'approches différentes [26,27].
Nous proposons en effet d'utiliser cette nouvelle méthode d'immunodétection au cours des études entamées pour la détection de la peste dans les restes humains anciens comme méthode complémentaire aux techniques de biologie moléculaire actuellement disponibles. Notre complémentarité est évidente : si nous pouvons identifier la présence de Yersinia pestis à moindre coût et sur de nombreux individus, nous ne pouvons, à la différence des techniques de biologie moléculaires, typer la souche responsable.
Les études multidisciplinaires conduites sur plusieurs séries archéologiques provenant de différentes régions et de divers contextes chronologiques pourront ainsi nous aider à mieux comprendre la prévalence, les phénomènes évolutifs et la biologie de Yersinia pestis et, parallèlement, à mieux appréhender les itinéraires de diffusion de ce très haut pathogène aujourd'hui réémergent [28].
Remerciements
Les auteurs souhaitent remercier Mme Anna Trisciuoglio et M. Alberto Peluso pour leur précieuse collaboration. La recherche conduite par le Dr R. Bianucci a été réalisée grâce au soutien financier de la Compagnia di San Paolo.