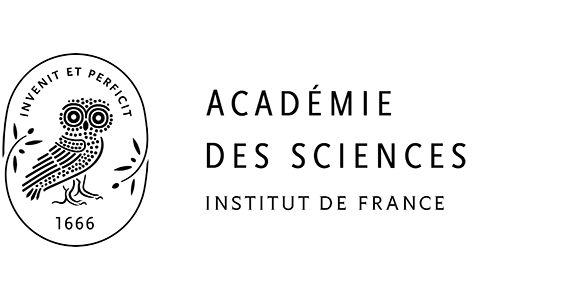En 1974, Charles Galperin organisait à Paris un colloque intitulé « Biologie et devenir de l’homme ». Ce colloque avait pour thème central l’analyse des « nouveaux pouvoirs de la science et des nouveaux devoirs de l’homme » dans le domaine des procréations médicalement assistées, de l’agriculture, de la démographie et des questions environnementales.
En effet, la biologie s’est développée de façon spectaculaire au cours du xxe siècle et, en tant que science du vivant, elle couvre des domaines de recherche très vastes, qui vont du niveau moléculaire, en passant par la cellule, l’organisme, jusqu’à celui de la population et de l’écosystème. Ces différentes formes du vivant font l’objet d’analyse de disciplines spécifiques : écologie, botanique, embryologie, génétique, microbiologie, biologie moléculaire, cellulaire, développementale ou médicale, etc. La liste est très longue et elle souligne l’importance que revêt l’étude du vivant pour l’homme. Dans ses aspects microscopiques, elle renvoie au déterminisme, aux modes de fonctionnements des corps et à l’hérédité des caractères ; d’un point de vue individuel et populationnel, elle analyse les rapports de l’homme avec son environnement, son histoire évolutive, les rapports d’équilibre et de déséquilibre écosystémique ; enfin, alliée à la technique, la biologie développe des ambitions thérapeutiques et mélioratives.
La biologie moléculaire, en particulier, a suggéré à l’homme de nouveaux pouvoirs. Son âge d’or débute en 1944, avec la découverte par Oswald Avery, Colin MacLeod et Maclyn McCarty de la nature chimique du support de l’hérédité portée par les chromosomes : l’acide désoxyribonucléique (ADN). Pour synthétiser une protéine, l’ADN est transcrit en acide ribonucléique (ARN) qui est ensuite traduit en protéine, ouvrant ainsi la voie à la compréhension du fonctionnement des systèmes cellulaires et organismiques des corps. Cette découverte a stimulé l’alliance entre la génétique et la médecine dans les années 1950 et a initié de nouvelles possibilités thérapeutiques et prédictives. Le développement de la cytogénétique humaine et, en particulier, toutes les découvertes de la fin des années 1950 sur l’existence de 46 chromosomes, les syndromes multigéniques et les anomalies chromosomiques ont été un moteur déterminant pour le développement de la biologie médicale.
Ensuite, à partir des années 1960, les recherches en biologie se sont technicisées. Ainsi, des cultures de cellules (fibroblastes) sont désormais possibles à partir d’une biopsie peu invasive de la peau (1960), de lymphocytes (1960) ou de cellules amniotiques (1966). La production de lignées cellulaires impliquant des fragments spécifiques de chromosomes devient également réalisable. De plus, les techniques de marquage et de coloration des chromosomes se développent, facilitant ainsi l’observation des anomalies chromosomiques1. En 1960, la responsabilité des trisomies 18 et 13 dans les avortements spontanés est engagée. Le dépistage génétique a conduit à la dépénalisation de l’avortement dans de nombreux pays entre 1965 et 1975 et, réciproquement, le débat sur la légalisation de l’avortement en cas d’anomalie génétique grave avérée a, par exemple, stimulé la création de huit centres de génétique en Belgique [1]. Enfin, avec les techniques de coloration des chromosomes, une cartographie physique très détaillée des gènes humains est désormais possible. L’activité disparate et internationale du séquençage des gènes a été canalisée par l’organisation régulière d’ateliers (workshops) – onze entre 1973 et 1990 –, les Human Gene Mapping Workshops. Lors de la première réunion en 1973 à Yale, aux États-Unis, il n’y avait pas de cartes, et une seule page suffisait à recenser les quelques loci assignés à des chromosomes spécifiques. L’année suivante, les chromosomes X et 1 avaient des cartes détaillées et, en 1975, on était en possession de la première carte globale des chromosomes, avec la position des gènes marquée sur un caryotype en bandes schématisé.
On comprend donc que le colloque « Biologie et devenir de l’homme » (1974) ait été organisé dans une période d’effervescence et de curiosité quant aux nouveaux pouvoirs de la science que semblaient suggérer les récentes découvertes moléculaires en biologie. De fait, les pouvoirs potentiels des technosciences biomédicales – alliance de la biologie, du médical et de la technique – sont nombreux, et ils ouvrent des voies multiples au questionnement éthique. Le colloque que nous avons organisé à Bruxelles – en collaboration avec Charles Galperin, Anne Fagot-Largeault et Pierre Daled –, quarante ans après celui de 1974, s’inscrit dans la continuité des questions et des anticipations soulevées cette année-là. Comment les technosciences biomédicales se sont-elles développées ? Quelles promesses offraient-elles, quel bilan peut-on faire de leur parcours jusqu’ici, vers quoi vont-elles évoluer ?
Au cours de ces deux journées, nous avons invité les participants à poser un regard philosophique sur ce devenir des technosciences biomédicales. Ils y ont été invités par des orateurs d’horizons divers : des philosophes, des historiens, des médecins et des biologistes. Ils se sont intéressés aux recherches menées notamment en biologie du développement, en biologie synthétique, en neuroscience et en postgénomique. Quels sont les nouveaux pouvoirs – et leurs limites – que ces domaines de recherche en plein essor offrent à la psychiatrie, à la psychochirurgie, aux thérapies cellulaires, à la médecine prédictive ?
Après deux articles introductifs sur l’histoire de la conférence de 1974 et les débuts de la bioéthique – par Charles Galperin et Pierre Daled – Anne Fagot-Largeault nous propose une analyse prospective du devenir de la bioéthique.
Ce devenir est intimement lié aux nouveaux pouvoirs permis par les développements récents en biologie moléculaire : sur les cellules souches, en génomique, postgénomique, génie génétique, médecine prédictive ou encore biologie synthétique. Ils seront développés dans la deuxième partie de ces Actes par François Gros, Laurence Perbal, Michel Morange, Pascal Nouvel, Alex Mauron, Nicole Le Douarin, Georges Chapouthier et Jean-Yves Goffi. Les limites techniques sont sans cesse repoussées et les normes éthiques doivent répondre de manière cohérente aux enjeux associés : séquençage massif des gènes, modification des gènes, création synthétique de la vie, enjeux de la bio-informatique, émergence d’une science participative, amélioration morale, sélection prénatale, reproduction médicalement assistée, etc.
La bio-neuroscience n’est pas en reste et le cerveau humain n’a pas encore dévoilé tous ses secrets. La troisième partie montrera – grâce à Vincent Pidoux, Bernard Baertschi, Étienne-Émile Baulieu, Jean-Claude Dupont, Manuel Correia, Michel Le Moal, Jean-Antoine Lepesant – que les modèles d’analyse évoluent, et leurs limites également : imagerie médicale, psychochirurgie ou psychiatrie. Comprendre le cerveau est et restera le grand plus défi des biologistes, des médecins et des philosophes.
L’ensemble des questions abordées invite à s’interroger dans une perspective humaniste sur « l’histoire du futur », selon le mot de Waddington, et sur la nature humaine, notamment sur ses limites corporelles ou cérébrales. Certains scientifiques et philosophes transhumanistes défendent aujourd’hui un progressisme prométhéen de transformation de la nature humaine par la technologie. Cet optimisme est cependant loin d’être partagé par tous ceux qui réfléchissent sur la transformation technoscientifique de l’homme. Cette utopie technoscientifique ayant pour objectif l’« amélioration » de l’être humain s’appuie sur les pouvoirs nouveaux de la biomédecine. La dilution des frontières entre médecine thérapeutique classique et médecine d’amélioration constitue une des caractéristiques principales de la biomédecine du xxie siècle. Dans la biomédecine contemporaine, les nouveaux médicaments et technologies thérapeutiques peuvent être utilisés, non seulement pour soigner le malade, mais aussi pour améliorer ou augmenter certaines capacités humaines. Cette évolution représente un changement de paradigme dans la pratique médicale. La volonté des transhumanistes de modifier l’homme a évidemment suscité des débats animés. Depuis une quinzaine d’années, de nombreux philosophes et scientifiques se sont penchés sur le thème des technologies d’amélioration. La problématique transhumaniste est vaste. Elle concerne d’abord toutes les techniques matérielles d’amélioration ou d’augmentation (enhancement) de l’homme, et cette perspective se situe volontiers dans le prolongement de l’humanisme des Lumières, en se réclamant d’un positionnement éthique. Mais l’homme « amélioré ou augmenté », c’est-à-dire « transformé », peut s’éloigner toujours davantage des conditions de l’homme naturel « cultivé » ordinaire. Le transhumanisme peut ainsi verser, brutalement ou imperceptiblement, dans le posthumanisme. Le posthumain a conceptualisé le transhumanisme en accordant au préfixe « trans » toute sa portée vectorielle de « passage vers ». Un passage qui n’est jamais terminé ou qui débouche sur une rupture, un « au-delà ». Lorsqu’il vise des qualités posthumaines ou des capacités dépassant de beaucoup le maximum accessible à tout être humain actuel, le transhumain est un humain de transition cherchant à transcender son humanité. Dans cette perspective, la nature humaine apparaît comme un travail en cours, comme un chantier peut-être à jamais inachevé [2].
1 En bandes fluorescentes (1969), coloration au Giemsa (1971) ou hybridation in situ en fluorescence (1990).